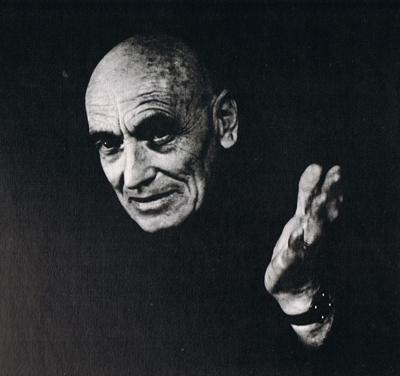Réflexions sur la santé et la maladie
Dans cette suite de réflexions ayant la santé pour thème commun, l'auteur évoque divers effets d'ordre psychologique et moral du triomphe d'une médecine fondée sur l'idée du corps machine.
Espérance de vie
Il s'agit plutôt d'une espérance de durée. Mais pourquoi durer? La durée n'a de sens qu'en tant que lieu de l'accomplissement. Un instant de plus? Oui, mais lequel? Il ne suffit pas d'être près de sa fin pour être près de son accomplissement. «La vie, en effet, est la chute d'un corps», disait Valéry. Il arrive parfois qu'une autre vie monte dans le corps qui tombe, mais cela tient du miracle. Le plus souvent, le corps tombe en chute libre.
Les jours du plus pitoyable des mortels demeurent pourtant sacrés. Ils sont encore et malgré tout le lieu de ces bonheurs d'occasion qui, si misérables qu'ils soient, font partie du royaume du bien, lequel s'étend, indivisible, depuis la satisfaction la plus élémentaire jusqu'à l'illumination la plus «sublime».
Il existe cependant un point au-delà duquel les conditions de la durée sont incompatibles avec celles du bien. Ce point limite, c'est le moment à partir duquel tout plaisir naît empoisonné parce que le malade n'a plus assez de toute sa conscience pour assumer son état.
Quand ce moment est venu, tout effort pour prolonger la durée devient un attentat contre la vie. L'attention que le corps mérite désormais n'est plus celle que l'on accorde à une promesse, mais celle qui se prolonge dans un souvenir.
«Ce n'est plus lui qu'elles soignaient (il n'était plus, il les avait quittées) mais son souvenir le plus proche, son corps.»
«On se représente difficilement aujourd'hui le prestige dont jouissaient la médecine et les médecins dans la société matérialiste d'il y a trente ans. Le «bon docteur» remplaçait le prêtre, disait-on, et la haute influence morale et sociale appartenait aux maîtres du corps, aux dispensateurs des traitements et régimes.»
«Sauvez-moi de moi-même».
Tels sont les mots que Dostoïevsky met dans la bouche du chrétien dépossédé de lui-même par les inquisiteurs. Mais, contrairement aux apparences, ce qu'il y a de tragique dans ce rapport de maître à esclave, ce n'est pas tant le pouvoir excessif de l'inquisiteur que la complicité du fidèle avec sa propre servilité. «Il n'y a pas, nous dit Dostoïevsky, d'angoisse plus profondément ancrée au coeur de l'homme que le besoin de trouver à qui il pourrait sacrifier au plus vite la liberté que, malheureuse créature, il a reçu en naissant.»
Les docteurs de la médecine ont remplacé les docteurs de l'Église, mais le même cri de la même angoisse est toujours proféré: sauvez-moi de moi-même! S'il vivait aujourd'hui, Yvan Karamazov dirait, en s'adressant aux médecins: Rendez-nous notre souffrance, rendez-nous notre mort, rendez-nous notre autonomie biologique, la liberté de gouverner notre corps comme nous l'entendons.
Les Occidentaux, du moins une partie d'entre eux, ont repris possession de leur âme à partir de la Renaissance, plus précisément, à la suite de la Réforme protestante et de la révolution cartésienne. Mais, pour prix de cette audace, ils semblent avoir été amenés, par la force des choses intérieures, à abandonner leur corps et leur psychisme aux inquisiteurs de la santé.
Charybde, Scylla, sauveurs des âmes, sauveurs des corps. «Il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde, poursuit Dostoïevsky. Même après la disparition des dieux les hommes se prosterneront devant de nouvelles idoles.» Même après la disparition des médecins.
La liberté n'est pas dans l'indépendance, toujours utopique d'ailleurs, mais dans l'équilibre entre nos diverses dépendances.
Fuite dans la maladie.
Flucht in die Krankheit. C'est l'un des thèmes favoris de Nietzsche. Le même Nietzsche écrivait: «Que votre amour soit de la pitié pour des dieux souffrants et voilés!» De nouveau la souffrance! Mais, cette fois, elle est logée au fond de l'être, loin du corps et loin du moi, là où nous commençons à sentir notre radicale faiblesse. Ce sentiment, lorsqu'il est pur, nous dispense de fuir dans la maladie. Mais pour l'éprouver, il faut aimer et être aimé. À défaut d'être aimé pour notre faiblesse, nous voulons nous faire aimer pour nos faiblesses.
Et nous réussissons presque trop bien. Tu es malade? Comme je t'aime! Soyez sains, soyez beaux, soyez vivants et vous ferez le vide affectif autour de vous. Tombez malades, et vous serez dévorés de sympathie. C'est le syndrome de «Ia femme éternelle en quête d'une douleur à bercer». Le moi trouve plus de satisfaction dans la condescendance que dans l'admiration qu'il accorde. On aime mieux faire le bien qu'être mis en sa présence.
Le «rappel» des générations.
Lu dans le Magazine Newsweek: «Her doctors claim her prospects for a healthy future are good. But there is no guarantee». Il s'agit d'une jeune fille qui risque fort d'être atteinte d'un cancer parce que sa mère, au moment où elle la portait, a pris, pour être sûre de mener sa grossesse à terme, une certaine hormone qui s'est avérée cancérigène pour l'embryon. (Le cancer produit par cette hormone peut se déclarer des années après la naissance.)
Pourra-t-elle s'en tirer? There is no guarantee. Le ton sur lequel cette phrase est dite nous ferait croire que la jeune fille aurait dû normalement naître avec une immunité garantie contre le cancer et, pourquoi pas, contre la mort. Certaines voitures ne sortent-elles pas de l'usine immunisées contre la rouille? L'assimilation du corps humain à la machine est telle qu'on forcera bientôt l'appareil médical à rappeler des générations d'enfants avariés, comme on force certains fabricants d'automobiles à rappeler des modèles défectueux.
La folie des responsabilités.
Je peux tout, dit Descartes, à condition que je procède avec méthode; en conséquence, ajoute Jean-Paul Sartre, je suis responsable de tout. Raisonnement irréprochable. Et notre responsabilité, de fait, s'accroît de jour en jour; car, grâce aux médias, nous possédons l'oeil de Dieu qui voit tout.
Malheureusement, les limites de notre puissance nous sont révélées en même temps que la multitude des problèmes à régler. Nous nous sentons de plus en plus responsables et de plus en plus impuissants. Nous voyons trop pour ce que nous pouvons.
Il y a la folie des grandeurs; il y a aussi la folie des responsabilités: un délire de persécution qui est l'envers de l'ivresse prométhéenne, un fatalisme agité qui est la rançon d'un interventionnisme débridé.
L'une et l'autre de ces attitudes nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, d'éprouver cet amor fati qui est la définition même de la sagesse ... Il est bon de regarder un infirme avec sympathie sans être bourrelé de remords profanes à la pensée que notre science ne fera sans doute aucun miracle pour lui. Aussi longtemps que la mentalité actuelle subsistera, nous ne pourrons échapper au remords qu'en regardant les malheureux d'un oeil de plus en plus impersonnel. Tant que nous ne serons qu'une contrefaçon du Dieu créateur, nous ne pourrons être qu'une caricature du Dieu rédempteur.
Médecine, déménagement et révolution.
Je suis fatigué, je suis déprimé: «je suis veuf, je suis seul et sur moi le soir tombe ... » Ce doit être cette cloison du nez, qui est déviée depuis ma naissance. Il me semble que tout irait mieux si je la faisais redresser. L'air frais ferait irruption dans mon corps, comme l'ozone après l'orage. Je retrouverais une ardeur créatrice que je n'ai jamais eue. Je ne serais plus du tout le même.
En pareilles circonstances, d'autres personnes éprouvent le besoin de déménager. Il en est même qui deviennent révolutionnaires: après ce ne sera plus du tout la même chose!
Il semble bien cependant que c'est l'appareil médical qui profite le plus de la situation. Cet état de fait a d'ailleurs un effet stabilisateur appréciable: il limite les migrations saisonnières et détourne vers les buts pacifiques des ardeurs dépressives déjà engagées sur la pente révolutionnaire. À ce propos, le professeur Henri Pradal n'hésite pas à écrire ce qui suit:
«Les tranquillisants apparaissent donc comme des agents extrêmement efficaces de stabilisation sociale, puisqu'ils déconnectent les personnes et tissent autour d'elles une gangue immatérielle mais parfaitement isolante et protectrice. Atténuant les pressions critiques, assouplissant la rigidité des comportements, réduisant à presque rien les impatiences et les revendications, les tranquillisants font plus, pour le maintien de ce qui est, que toutes les forces d'information et de police. L'absence d'activités créatrices, la disparition des motivations par la responsabilité, l'orientation de tous les efforts vers l'acquisition d'objets ou de "signes" de puissance, l'obsolescence accélérée de ce qui est acquis de haute lutte obligeant au renouvellement incessant et à l'innovation à tout prix, tout cela contribue à la consommation exponentielle des pilules de "bonheur" et nous conduit tout droit à un "meilleur des mondes" à la Huxley.»
Il faut savoir dételer! En termes philosophiques, cela signifie: il faut donner congé à la volonté. N'hésitons pas à répéter ces lieux communs. Toujours s'assumer, toujours dire: «je veux, je vais,» toujours poursuivre un objectif, même dans les loisirs (le culte du record), même dans l'amour (qu'est-ce que la sexualité, sinon l'amour doté d'objectifs précis?), cela est suicidaire. Il faut s'oublier: dans l'ivresse cosmique ou amoureuse, dans l'extase, dans l'admiration, dans les larmes, dans la saveur, dans les odeurs, dans les gestes rituels, dans les fêtes saisonnières, dans tout ce qui nous permet de disparaître sans perdre notre identité.
Nous sommes enlisés dans les sables desséchés de la volonté. Non parce que nous aurions trop de volonté, mais parce que trop peu de choses nous permettent de nous oublier dignement.
Convenons d'appeler grâce tout ce qui nous libère de la volonté, tout ce qui, sans efforts de notre part, nous nourrit, nous inspire et nous élève. Nous avons le choix entre une telle grâce et les pseudo-miracles de la médecine, de la migration et de la politique.
Le cosmonaute.
Pendant que le cosmonaute marche sur la lune, l'appareil médical contrôle les battements de son coeur. Ce héros de méthode est un homme branché: des fils et des ondes lui tiennent lieu de sens et de racines.
Voilà un thème pour bandes dessinées qui devrait être au coeur de la réflexion actuelle. Le cosmonaute est l'archétype de notre époque. Il est l'équivalent pour nous de ce qu'était l'homme juste pour Platon, le saint pour le Moyen-Âge, l'honnête homme pour le XVIle siècle, l'homme enraciné pour les romantiques. Dans nos sociétés, le «check-up» régulier n'est-il pas le «status symbol» le plus recherché? Or, être en «check-up», n'est-ce pas être branché? Comme le cosmonaute ...
C'est un ordinateur qui apprend au cosmonaute qu'il a besoin de nourriture ou de sommeil. Ce sont aussi des machines qui donnent à l'homme en «check-up» l'ordre de faire de l'exercice et l'autorisation de se sentir bien. Pour entrer en soi-même, on a désormais besoin d'une carte perforée.
Mais la carte la mieux perforée ne fait pas disparaître toutefois l'angoisse que nous éprouvons quand nous descendons dans ce pays étranger et hostile que, par un abus de langage manifeste, nous appelons notre corps. Cette angoisse est la rançon du doute méthodique. Nos sens nous trompent, dit-on! Maintenant notre raison nous obsède.
Est-il bien vrai que nos sens nous trompent? Oui, s'il s'agit de connaître objectivement; non, s'il s'agit seulement de vivre et de mourir. Descartes lui-même écrit:
«Or cette nature m'apprend bien à fuir les choses qui causent en moi le sentiment de la douleur, et à me porter vers celles qui me communiquent quelque sentiment de plaisir, mais je ne vois point qu'outre cela elle m'apprenne que de ces diverses perceptions des sens nous devions jamais rien conclure touchant les choses qui sont hors de nous, sans que l'esprit les ait soigneusement et mûrement examinées. Car c'est, ce me semble, à l'esprit seul, et non point au composé de l'esprit et du corps, qu'il appartient de connaître la vérité de ces Choses-là.»
Mais quelles que soient les concessions qu'il fasse ici à la nature, Descartes est bien celui qui a dessiné la première ébauche du cosmonaute. Le doute dont il frappe les sens externes devait logiquement finir par miner ce sens commun qui, selon lui, nous permet de connaître l'état et les besoins de notre corps, car ce que nos sens gagnent ou perdent dans notre rapport avec le monde profite ou nuit à notre rapport avec nous-mêmes.
Le cosmonaute, le mot le dit, est un déraciné. C'est pourquoi il ne peut pas se fier à ses sens, C'est l'enracinement qui fait de nos sens, externes et internes, une source de vérité et de fécondité. Pour découvrir un paysage, il faut y prendre racine. Il ne suffit pas d'y passer. Nos désirs et nos besoins sont encore plus difficiles à découvrir que les charmes secrets d'un paysage. Nous n'en percevons même pas le contour lorsque nous nous contentons d'être de passage en nous-mêmes.
Il est bien clair que tout conspire encore à faire de nous des cosmonautes. Les voyages sur la lune ont certes eu l'effet libérateur d'une catharsis, mais notre idéal véritable, celui dont témoignent nos choix économiques et politiques,est toujours, et plus que jamais peut-être, de remplacer les racines par des fils et l'autonomie de l'être vivant par l'inertie de la chose administrée. Le seul autre idéal cohérent et consistant qui subsiste encore, l'idéal de l'homme enraciné, est surtout folklorique. Il a des aspects réactionnaires qui ne conviennent pas du tout à nos esprits «résolument tournés vers l'avenir». Pourquoi faire fond sur les sens et s'abandonner religieusement au destin - ce sont là deux attitudes inséparables - quand, pour éliminer la souffrance, on dispose de méthodes plus efficaces et moins humiliantes.
Si nous nous détournons un jour du meilleur des mondes, ce ne sera donc pas de plein gré, mais parce que nous nous heurterons à des obstacles matériels insurmontables. Ces obstacles, nous commençons déjà à les apercevoir. Les systèmes de santé et d'éducation sont devenus si coûteux que nous devons renoncer à les «perfectionner». Les pays riches et puissants d'aujourd'hui sont trop populeux et trop démocratiques pour pouvoir accéder au meilleur des mondes. Cette réussite suprême ne serait possible qu'à l'échelle d'un tout petit pays ayant tous les autres peuples de la terre à son service.
C'est donc pour des raisons économiques que nous sommes condamnés à changer d'idéal. C'est pour équilibrer les bubgets que nous devons faire appel aux poètes et aux philosophes de l'enracinement. Il a fallu que New York fasse faillite pour que l'on admette qu'elle n'est plus une ville humaine. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire que la nécessité dicte aux peuples leur idéal.
Il faudrait cependant, pour être conséquent, retrouver le sens de la gratuité. Les restrictions budgétaires et la propagande ne pourront que contraindre l'angoisse à s'extérioriser par de nouvelles soupapes. Les véritables messagers de l'autonomie biologique et spirituelle sont les êtres authentiquement sensibles et religieux. Le sens passe par les sens. La paix par l'abandon.