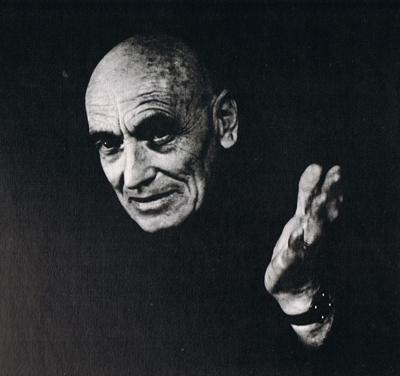La fin des illusions sur la culture
Tôt ou tard, soutient pourtant George Steiner, il faudra s'arrêter. Le fait qu'il ait intitulé son étude sur la culture Dans le Château de Barbe-Bleue indique clairement la radicalité de son doute. En notant le fait que la ville de Weimar, à laquelle tant de souvenirs culturels sont rattachés, se trouve à côté de Buchenwald, il s'était auparavant rendu à l'évidence que non seulement la culture n'enferme pas de remèdes préventifs contre les apocalypses rendues plus efficaces par la technique, mais qu'il faut plutôt la ranger parmi les causes de ces malheurs.
- «Pour la première fois, écrit Steiner, la foi souveraine dans le progrès chancelle. Ce que j'ai à l'esprit dépasse de loin les préoccupations courantes du monde scientifique quant à l'environnement, l'argent, l'emploi irréfléchi des substances chimiques dans l'organisme. Le vrai problème est de savoir s'il faut persister dans certaines recherches, si la société et l'esprit humains, à leur stade actuel d'évolution, pourront supporter les vérités à venir.[...] Jacques Monod a formulé publiquement la question que tant d'autres posaient en privé: faut-il persévérer si la génétique doit divulguer, sur la différenciation des races, des secrets dont la portée morale, politique et psychologique nous déborde?» (George Steiner, Dans le château de Barbe-Bleue, Seuil, Coll. Folio-essais, Paris 1986, p. 152).
Quand l'infini paraît, Dieu s'est évanoui.
O science! absolu qui proscrit l'inoui!
L'exact pris pour le vrai.
(Victor Hugo, Dieu., l'Intégrale/Seuil, poésie, tome 3, p. 447)
Parmi les causes lointaines de la barbarie contemporaine auxquelles Steiner s'est arrêté, il en est une qui doit retenir notre attention, parce qu'elle a un rapport direct avec les manipulations d'images et de symboles que les nouvelles techniques de communication et d'information rendent possibles. «C'est chez Sade, écrit Steiner, et aussi chez Hogarth, que le corps humain, pour la première fois, est soumis méthodiquement aux opérations de l'industrie. Les tortures, les postures grotesques imposées aux victimes de Justine et les Cent vingt journées, établissent, avec une logique consommée, un modèle de rapports humains, fondé sur la chaîne de montage et le travail aux pièces. Chaque membre, chaque nerf est déchiré ou tordu avec la frénésie impartiale et glacée du piston, du marteau pneumatique et de la foreuse. Le corps n'est plus qu'un assemblage de parties, toutes remplaçables par des "pièces détachées". La multiplicité, la simultanéité des outrages sexuels offrent une image minutieuse de la division du travail à l'intérieur de l'usine» (ibid., p. 91).
Qu'est-ce qui autorise Steiner à voir dans un aspect de l'oeuvre de Sade, elle-même plutôt marginale somme toute, une préfiguration sinon une cause des tortures des camps de concentration? Ayant compris que tout se tient dans une culture et que par suite, rien n'est innocent, Steiner nous rappelle que la dérive vers la barbarie prend la forme d'un glissement dans les mentalités, glissement dont on peut apercevoir les premiers signes dans la littérature. Aussi bien que dans l'architecture.
Il existe à proximité de Leipzig en Allemagne un monument érigé en 1913 pour commémorer une victoire décisive contre les armées de Napoléon un siècle plus tôt, de même que pour souligner la puissance de l'Allemagne de l'époque. L'être humain se sent diminuer au fur et à mesure qu'il se rapproche de ce monument, colossale masse de pierre, démesurée à tous égards. On ne peut pas penser un tel monstre sans y voir la préfiguration du stade de Nuremberg, de même qu'une volonté d'abaisser l'être humain au point où l'on trouvera bientôt normal de le considérer comme une bête de laboratoire.
L'amour selon le marquis de Sade est l'exact équivalent du monument de Leipzig. Par le seul fait que cet amour existe, il confirme la désacralisation de l'être humain, légitimant ainsi l'habitude, déjà parvenue à un stade avancé, de le traiter comme une chose
Certes, les êtres humains n'ont pas attendu de visiter le monument de Leipzig ou d'être exposés aux produits de l'imagination de Sade pour prouver qu'ils sont capables de devenir tortionnaires. Le mal est si bien enraciné en nous, nous devrions le savoir, qu'il nous faudrait éviter de détourner de leur destination première, qui est de le contenir, des choses comme l'art et la littérature.
Et que savons-nous de l'imaginaire, de la façon dont les nourritures symboliques agissent sur lui et en lui? N'est-ce pas à la tendresse et à la compassion présentes dans des statues comme celles de Donatello et dans toutes celles, de même inspiration, qui ornent les églises romanes, n'est-ce pas dans ce mince voile, posé sur la violence de ses instincts, que l'Homme européen a pu imposer une limite à sa barbarie, limite trop faible certes pour contenir tous les accès de fureur, mais assez forte pour susciter des oasis de civilisation en de nombreux lieux et sur de longues périodes? Chaque oeuvre d'art où l'on ne retrouve pas sous une forme ou sous une autre la compassion de Donatello, et la mesure humaine, provoque une déchirure dans le voile de douceur qui tempère nos instincts. Quant aux oeuvres qui en exaltent carrément la violence, le seul fait que nous n'ayons pas le réflexe de les détruire ou de les interdire, indique que nous n'estimons pas dangereuse la force du mal qui est en nous.
Les oeuvres de Sade n'indignent plus personne aujourd'hui, tant on a l'habitude d'en retrouver l'inspiration à la télévision, dans les vidéos, dans la musique et maintenant sur Internet. Pour proliférer, elles tirent parti des progrès techniques, comme les parasites profitent de la croissance de leur hôte pour se multiplier. La pornographie, la violence, la réduction de l'être humain à l'état de chose et de machine, toutes les images avilissantes de l'Homme sont à ce point associées dans les faits et les esprits aux nouvelles techniques de communication que nous accueillons contenus et contenants avec le même sentiment de fatalité: on n'arrête pas le progrès!
Phénomène encore marginal au moment où Steiner y voyait un signe annonciateur des horreurs des camps de concentration, la célébration du sadisme est désormais un phénomène quotidien et universel. À quelles horreurs faut-il donc s'attendre?
Quelles raisons avons-nous de tolérer les signes-causes de ces horreurs dans nos médias? Ils ne correspondent à aucune nécessité et ils ne peuvent en devenir une que dans la mesure où ceux qui en font leur pain quotidien vivent dans un monde qui est déjà un enfer pour leur âme, en attendant d'en devenir un pour leur corps.
La conception de la liberté qui légitime cette situation à nos yeux n'est pas d'un niveau plus élevé que les spectacles tolérés. Il s'agit de ce que Descartes appelle la liberté d'indifférence, le plus bas degré de liberté selon lui, le plus haut étant celui que confère la connaissance qui dispense de choisir. Cette liberté d'indifférence est elle-même l'une des retombées de la technique. Nous ne pourrions pas refuser les horreurs sadiques sans nous retourner en même temps contre le progrès technique et la conception de la liberté qui y est associée. Comme cette liberté d'indifférence, le mot le dit, est caractérisée par l'absence de raisons de choisir une chose plutôt qu'une autre, elle ne peut s'affirmer qu'en rendant plus manifestes l'arbitraire et l'indétermination qui constituent son élément. D'où cette morale du pourquoi pas? qui préside à la conception des contenus de nos médias.
Parce que les actes qu'on y pose sont sans conséquences, le virtuel ouvre un champ illimité à la liberté d'indifférence, qui s'affirme par la surenchère dans ses audaces à défaut de s'élever dans la connaissance, une connaissance qui lui donnerait un sens, mais en la limitant. Vu sous cet angle, le virtuel est le paradis du sadisme: on peut impunément y trancher le corps de sa victime en autant de petits morceaux que l'on voudra. La morale officielle et le droit sont respectés, puisque la liberté de l'autre n'est pas entravée.
Pour ce qui est de l'essentiel: les atteintes à l'imaginaire, seuls quelques penseurs comme George Steiner semblent s'en soucier. Remarquons à ce propos que les images et les scènes les plus avilissantes sont peut-être celles dont on se méfie le moins parce qu'elles font partie de l'actualité scientifique. Tout le monde estime normal et correct qu'à la fin du bulletin de nouvelles, une femme ouvre ses jambes au milieu de l'écran pour permettre à son médecin reproducteur d'introduire l'ovule fécondée dans son utérus.
Les images ainsi objectivées du corps de la femme et des gestes de l'amour sont la règle dans le milieu symbolique des enfants aussi bien que des adultes. Certes, on peut soutenir qu'une représentation plus poétique de la femme et de l'amour ne sont pas plus incompatibles avec les médias actuels qu'avec les vitraux, la pierre et les couleurs du Moyen Âge et de la Renaissance. Et ainsi, il n'est peut-être pas tout à fait inutile de réfléchir sur les conditions dans lesquelles une haute inspiration pourrait réenchanter les représentations de l'être humain et de ses amours, dans les médias qu'il a lui-même conçus. Mais l'inspiration de Donatello, si elle est encore possible, peut-elle être reconnue dans un monde où ce n'est pas du soleil intérieur, invisible et transcendant, mais des réalisations extérieures de l'Homme que l'on attend lumière et énergie?