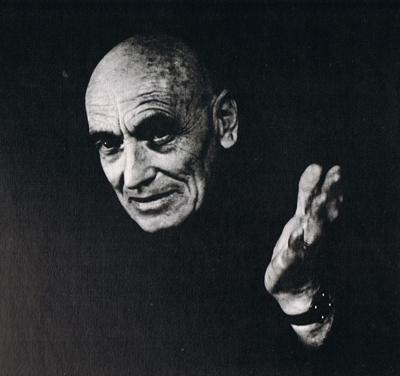Un pacte agricole pour le Québec
Au cours des derniers mois, j’ai participé à de nombreuses discussions sur l’agriculture et l’agro-alimentaire, j’ai lu des textes, consulté je ne sais combien de sites Internet. Dans notre premier numéro sur la question, La planète agricole, paru en juin 2001, j’ai fait état du vertige que j’éprouvais devant la complexité du problème. Aujourd’hui, après avoir fait mon profit de notre dernier numéro et poursuivi mes recherches et ma réflexion, je suis frappé par le fait que les solutions paraissent simples, et le sont effectivement, dès lors que l’on s’élève au niveau des fins de l’agriculture et que l’on s’efforce d’accorder à chacune sa juste importance.
Je me livre à cet exercice dans les pages qui suivent. Ma première conclusion, dont j’ai également fait état dans le précédent numéro, était que l’agriculture raisonnée, telle que l’on commence à la pratiquer en France, est la voie à suivre pour le Québec. On la définit ainsi sur le site Farre.org :
- Répondant aux critères du développement durable, l’Agriculture raisonnée prend en compte de manière équilibrée les objectifs économiques des producteurs, les attentes des consommateurs et le respect de l’environnement. Les cultivateurs sont chaque jour plus nombreux à mettre en application les principes de bon sens et les savoir-faire d’une philosophie qui s’appuie à la fois sur l’expérience accumulée par les générations précédentes et les connaissances et techniques les plus récentes.
Au risque d’abuser du bon sens, je veux rappeler les fins de l’agriculture et raisonner sur la façon d’attribuer à chacune sa juste importance. Étant donné qu’il s’agit d’un raisonnement, je n’ai pas à me soucier des conditions concrètes dans lesquelles les autorités publiques du Québec ou du Canada pourraient prendre des décisions en rapport avec les recommandations que je fais. Cela ne veut toutefois pas dire que je sous-estime la réalité et l’importance de ces conditions. Il se peut que telle recommandation, que l’on pourra juger bonne en elle-même, entre en contradiction avec le traité de l’Alena ou avec les règles de l’organisation mondiale du commerce. Ceux qui feront leur une telle recommandation comprendront qu’ils doivent, pour assurer son application, s’engager dans un débat international.
J’aurais malgré tout hésité à publier mon texte si un livre intitulé La terre, les paysages et notre alimentation1 ne m’avait rassuré sur la pertinence de mes raisonnements. L’auteur de ce livre, Luc Guyau, appartient en effet à une catégorie sociale à qui l’on ne peut pas reprocher de manquer de réalisme en matière d’agriculture: il est le président de la FNSEA (Fédération nationale des exploitants agricoles), l’équivalent français de l’UPA québécoise. «Je pense, écrit-il dans l’introduction, que notre avenir d’agriculteurs passe plus, désormais par un échange avec nos concitoyens que par la seule défense d’intérêts corporatistes.» S’adressant au consommateur, il précise sa pensée: «Dans les années 60, on voulait que les agriculteurs produisent en grande quantité des aliments standards et peu coûteux. Aujourd’hui, par-delà les produits alimentaires de base, votre exigence est faite de paysages, de cadre de vie, de services, de sauvegarde de l’environnement et du patrimoine, de produits de terroir, de sécurité alimentaire, et parfois même de rêve et de souvenir.»
La fin des dogmes en agriculture
Comme la plupart des pays du monde, le Québec doit décider du sort de son agriculture. L’adhésion inconditionnelle au modèle productiviste ne peut plus désormais tenir lieu de politique agricole
À partir de la décennie 1950, centralisation, capitaux, science, technique, productivité, rationalité, tous ces grands mots formaient le cortège de la modernisation. Et ce cortège, il fallait le suivre. Depuis ce temps, en agriculture comme en de nombreux autres domaines, on oppose le moderne au traditionnel avec, bien entendu, un préjugé favorable au moderne. Les petites écoles ont disparu en même temps que les petites coopératives, les petites épiceries, les petites boucheries… traditionnelles.
Au cours des deux dernières décennies, il s'est toutefois produit une série de phénomènes qui, sans nous ramener à une tradition impossible à recréer, pourraient réserver quelques surprises désagréables aux obstinés de la modernité.
Dans tous les domaines, la modernisation a bénéficié de la foi que les gens avaient dans la science, elle-même considérée comme condition du progrès. C'était l'époque où bien des disciplines, perçues auparavant comme des arts, l'éducation par exemple, se sont donné une image de science: les facultés des sciences de l'éducation sont apparues à ce moment-là.
Heureusement, l'esprit critique était déjà à l'œuvre et bien des innovations, qui semblaient être de purs produits de la science et de la raison, sont apparues comme des phénomènes sociaux et culturels contenant leur part de mythe, d'irrationnel, comme ceux des époques précédentes.
Au cours de la décennie 1970, les silos dans les fermes apparaissaient aussi modernes (et donc nécessaires)que les avions dans le ciel. Pourtant, on connaissait déjà des techniques qui ne coûtaient rien: des monticules recouverts de plastique par exemple, mais aucune de ces techniques n'avait la puissance symbolique de ces grands phallus blancs ou bleus dominant le paysage.
Tout le monde sait qu’il entre au moins autant de science dans l’agro-écologie que dans la recherche à la Monsanto. On pourrait même dire, en paraphrasant un mot célèbre de Pascal: peu de science éloigne de la nature, beaucoup de science en rapproche. Quand, par exemple, la science des associations entre plantes aura atteint sa maturité, une certaine agriculture productiviste, encore fondée sur la chimie de Von Liebig (1803-1873) paraîtra obscurantiste.
Si l’agriculture industrielle a perdu le monopole de la scientificité, elle conserve, objectera-t-on, celui de la productivité. Elle est une ignorance rentable. Mais même sur ce plan, il n’y a plus d’unanimité ni parmi les experts, ni dans le grand public. Comme nous l’avons démontré dans notre dernier numéro, on ne pourra se prononcer de façon rigoureuse sur cette question que lorsqu’on se sera entendu sur une méthode pour prendre en compte les coûts environnementaux et sociaux de l’agriculture productiviste.
Nous vivons en ce moment la fin des dogmes en agriculture. C’est là un facteur d’instabilité, mais aussi une occasion idéale pour notre société civile et notre gouvernement de reprendre le contrôle d’une situation qui avait été abandonnée à la fatalité de ce qui apparaissait comme le Progrès.
Il se trouve que la marche vers ce progrès a coïncidé avec les intérêts et les politiques de l’UPA à un point tel que ce syndicat jouit aujourd’hui d’un pouvoir bien supérieur à celui du Mapaq. Comment redonner le pouvoir politique aux citoyens et au gouvernement en cette matière?
Les fins de l’agriculture
Nous reviendrons sur cette question cruciale. Il importe auparavant de faire un détour par les principes. Aujourd’hui comme hier, il faut assigner à l’agriculture des fins et veiller à ce que ces fins se composent entre elles de façon appropriée.
On peut ramener à six les fins de l’agriculture:
A. Nourrir… les êtres humains… les animaux de compagnie et les animaux de la ferme.
B. Régénérer… le sol
C. Respecter… les êtres vivants, leur intégrité et leur diversité
D. Réunir… les gens
E. Embellir… les paysages
F. Réjouir... les paysans
Nourrir…
«Les Américains scrutent leur assiette pour y déceler d’éventuels poisons; pour nous l’aliment doit être un bouquet de saveurs que nous aimons partager avec d’autres.»
«Le consommateur des années 2000 tend à vouloir mettre du sens dans son assiette comme dans ses autres achats.[…] Lorsque nous faisons nos courses, nous posons un acte politique, nous achetons de l’avenir. Plus que de l’imaginaire il nous faut proposer au consommateur de mettre de l’éthique dans son achat, comme nous devons en mettre dans nos modes de production.»
Luc Guyau, op.cit.
Nourrir hommes et bêtes! Mais de quoi? Depuis la première révolution agricole, le passage de la cueillette à l’agriculture, il y a dix mille ans environ, jusqu’au début du présent siècle, la réponse universelle à cette question était simple: on se nourrissait de tous les aliments disponibles qui ne rendaient pas malades. Il semble bien qu’en dépit de cette précaution vitale, de nombreuses populations aient consommé pendant des siècles, sinon des millénaires, des produits toxiques, tel le seigle, fréquemment infecté par un champignon appelé l’ergot. La consommation de ce seigle provoquait diverses maladies graves2 qui auraient été la cause de la stagnation de la population dans toute une partie de l’Europe, la Russie notamment. Aujourd’hui la question doit être posée de façon plus précise et les réponses sont nombreuses et complexes. Nourrir qui parmi les hommes et les bêtes… de quoi et selon quelle hiérarchie? Dans les pays riches, les animaux de compagnie consomment l’équivalent de ce qui serait une diète riche pour les humains3 dans les pays les plus pauvres. Quant aux céréales servies aux animaux de la ferme, le bœuf par exemple, chacun sait qu’elles nourriraient plus de gens si elles étaient consommées directement par les humains plutôt que sous forme de hamburger.
Il importe à tous que les aliments soient sains, mais on peut très bien soutenir, comme monsieur Breton4, grand intégrateur (éleveur de porcs et producteur de céréales) et grand défenseur de l’élevage industriel, que c’est la ferme-usine qui offre le plus de garanties sur ce plan. Du strict point de vue hygiénique, l’œuf glissant sur des treillis de fer immédiatement après la ponte, n’est-il pas préférable à l’œuf pondu par la poule sur une terre ou un paillis pleins de microbes? Mais qu’en est-il si la poule d’usine est nourrie de ces farines animales dont depuis la maladie de la vache folle on connaît les effets néfastes?
L’idéal serait d’avoir le choix entre des produits vendus par des paysans que l’on connaît assez pour avoir confiance en eux et des produits provenant de fermes industrielles géantes, dont on sait qu’elles sont soumises à une inspection rigoureuse.
Il faut bien noter qu’en cette matière l’opinion publique est contradictoire. Les mesures d’hygiène que le public – amateurs de lait cru en tête – juge excessives aujourd’hui résultent de lois que le même public a réclamées dans le passé, notamment pour prévenir la tuberculose .
Les aliments frais produits dans le voisinage jouissent à bon droit d’un préjugé favorable: le transport ne les a pas dénaturés et il n’a pas provoqué de pollution, mais quel sort faut-il réserver aux produits de luxe, ceux qui viennent parfois des antipodes ou ceux que nous expédions nous-mêmes à l’autre bout du monde?
Nos recommandations
· Diverses mesures incitatives destinées à limiter les dépenses pour l’alimentation des animaux de compagnie, (qui croissent de 5 à 6% par année au Canada), pour réduire l’importation de produits d’origine lointaine et pour adapter la consommation de viande aux besoins réels des bureaucrates que nous sommes en majorité.
· Un soutien accru à la consommation des produits du voisinage, par la création de nouveaux marchés publics, par diverses autres formes de soutien à l’agriculture paysanne par la communauté, tel le panier hebdomadaire préconisé par le mouvement Équiterre.
· Une libéralisation du commerce paysan basé sur un étiquetage adéquat. S’il faut obliger un vendeur d’œufs fermier à indiquer que ses produits présentent des risques, qu’on le fasse; on exigera ensuite que le concurrent de la grande industrie indique que son produit contient des OGM , de la farine animale, ou, dans le cas des fermes laitières, des résidus des désinfectants utilisés pour le lavage des tuyaux et bassins
· Une distinction très claire en ces matières entre l’intérêt du public et celui des divers groupes de pression.
· Certaines conditions de la production des aliments devraient faire l’objet d’une mention spéciale sur les étiquettes, de façon, par exemple, que le consommateur puisse accorder sa préférence au porc produit sans antibiotiques utilisés comme stimulants de croissance.
Régénérer le sol
Dans ce cas tout est simple et clair: l’argument productiviste renforce l’argument écologique; à supposer qu’il soit vrai qu’un hectare de terre encore en bon état peut produire, grâce à la méthode industrielle, trois fois plus que le même hectare cultivé avec le respect du sol, on perd aussi trois fois plus dans l’immédiat, quand un hectare de bonne terre est emporté par l’érosion ou tué par des méthodes agressives de culture.
Nos recommandations:
· Faire en sorte que les subventions accordées aux agriculteurs soient proportionnées aux mesures qu’ils entendent adopter pour protéger le sol et l’environnement en général. C’est ce que les experts appellent l’éco-conditionnalité.
· Indiquer sur l’étiquette si l’aliment – qui n’est pas nécessairement biologique – a été produit au moyen de méthodes respectueuses du sol et de l’environnement.
Respecter les êtres vivants, leur intégrité
Dans ce cas, il y a risque d’extrémisme. De nombreux partisans de l’antispécisme, rejetant l’idée que l’homme est supérieur à l’animal et qu’il peut en conséquence l’utiliser à ses fins, s’objectent à toute consommation de viande et à tout usage de l’animal qui réduit ce dernier au rang d’esclave. Entre cette position extrême, et l’autre qui consiste à traiter l’animal comme une machine, il y a une position intermédiaire: ne pas infliger à l’animal de souffrances inutiles ou d’une utilité incertaine. C’est l’intégrité de l’animal qui est ici en cause. Le profit de l’entreprise agricole ne peut pas être le critère pour déterminer ce qui est utile. Ce critère, il faut le chercher plutôt du côté du bon sens et d’une connaissance élémentaire des bêtes. Une poule est un oiseau ayant un instinct grégaire. On ne respecte pas son intégrité quand on l’enferme dans une cage minuscule, qu’on l’empêche de picorer en lui coupant le bec ou en ne lui offrant que des fils de métal comme matière à explorer. Dans le cas de la poule, et dans celui du porc encore davantage peut-être, l’élevage intensif provoque immanquablement des infections qu’il faut combattre par des antibiotiques que l’on utilise comme remèdes curatifs après les avoir utilisés comme remèdes préventifs et comme stimulants de croissance.
Tout le monde conviendra qu’il est inutile et contraire au bon sens de rendre des bêtes malades en vue d’accélérer le rythme de leur croissance. Comme le problème de la résistance aux antibiotiques et celui de la pollution de l’environnement par les grandes porcheries s’ajoutent ici à celui de l’intégrité de l’animal, on ne voit aucune raison convaincante de tolérer les méthodes d’élevage de ce genre, encore moins de les encourager.
Le respect de la diversité des espèces est lié à celui de l’intégrité des bêtes. Les animaux de la ferme étaient à l’origine aussi variés que les milieux naturels d’où l’on venait de les tirer. Il y avait par exemple des vaches adaptées à la montagne, comme les jerseys et des vaches adaptées à la plaine, comme les holstein. À cause de leur grande productivité, qui s’explique en grande partie par la sélection artificielle dont elles ont été l’objet, les holstein sont devenues à toutes fins pratiques l’espèce unique. Munies d’un pis énorme, véritable citerne, elles sont si fragiles et si précieuses pendant leur période de plus en plus courte de haute production, qu’on les élève désormais dans un espace clos qu’elles ne quitteront jamais. Elles peuvent toutefois s’y déplacer et l’air y est respirable. Elles sont traitées royalement, par rapport aux porcs par exemple, pour l’excellente raison qu’on aura besoin d’elles longtemps. La science et le simple bon sens nous enseignent toutefois qu’il importe de maintenir la variété des espèces et pour cela d’assurer à chacune d’elles un traitement approprié à sa nature.
Recommandations
· Réviser à la baisse les subventions (directes ou indirectes) à l’élevage concentrationnaire du porc et du poulet et faire en sorte que le type d’élevage soit indiqué sur l’étiquette.
· Interdire carrément certaines pratiques comme celle qui consiste à maintenir une truie dans un espace si restreint qu’elle ne peut même pas s’y retourner.
· Imposer comme densité limite celle au-delà laquelle l’infection devient inévitable dans des conditions normales.
· Accorder une prime à ceux qui conservent des espèces par souci de la diversité au prix d’une diminution du rendement.
Réunir…les gens
La ferme a toujours eu un rôle social et politique déterminant. On peut soutenir, sans trop de risques d’errer, qu’il existe, selon les lieux et les époques, une dimension de la propriété terrienne en deçà de laquelle une famille ne peut pas assurer sa subsistance et au-delà de laquelle on dérive vers les latifundia, l’oligarchie, le rapport maître esclave. C’était le cas dans la Grèce des VIII et VIIe siècle où quelques gros propriétaires faisaient la loi. Ils pouvaient, après s’être emparé de ses terres, condamner à l’exil le petit propriétaire qui n’avait pas pu rembourser ses dettes à leur endroit. L’œuvre de Solon, le sage vénéré de Platon et d’Aristote qui créa le premier état de droit, consista essentiellement en une réforme agraire reposant sur une remise des dettes aux petits propriétaires. Il en est résulté dans toute la campagne athénienne une joie de vivre, une fierté, un patriotisme tels que les Grecs, sous la direction des Athéniens, pourront gagner une guerre décisive contre les Perses pourtant beaucoup plus nombreux.
Dans un ouvrage érudit entièrement consacré aux rapports entre l’agriculture, la culture et la politique, Pierre Savinel5 a bien montré, pour l’ensemble de l’antiquité, que l’altitude politique et culturelle à laquelle peut s’élever une collectivité est liée au respect de la dimension idéale de la propriété terrienne. À Rome, les Gracques ont tenté une réforme semblable à celle de Solon. On se prend à regretter qu’elle n’ait pas réussi. Pour ce qui est des temps modernes, Savinel note que la France et l’Allemagne doivent beaucoup au type de propriété dont elles ont favorisé l’essor 6.
Le type de propriété terrienne a été particulièrement déterminant au Québec où la ferme familiale transmise intégralement à l’un des enfants s’était imposée avant même la fin du régime seigneurial. Il existe maints témoignages d’illustres visiteurs étrangers et d’observateurs du terroir, tels Léon Gérin et Thomas Chapais, prouvant que les paysans du XIXe siècle formaient une population heureuse. D’où, sinon de son bonheur, cette population, d’abord confinée aux rives du Saint-Laurent, aurait-elle pu tirer l’énergie requise pour transposer son modèle agricole, qui était aussi un modèle social, dans les régions plus arides de l’Estrie, du Saguenay Lac Saint-Jean, de la Gaspésie et de l’Abitibi? Les Québécois pourraient se flatter d’avoir fait la conquête de leur territoire ou sa reconquête, comme ce fut le cas en Estrie, non par les armes, mais par les fourches de ses agriculteurs.
Certes, cette vocation trop exclusivement agricole du peuple québécois aura par la suite des conséquences négatives, auxquelles on remédiera avec succès au cours du XXe siècle. Nous arrivons maintenant au terme d’une période d’industrialisation où, tenant les conquêtes de l’époque précédente pour acquises, nous n’avons pas hésité à industrialiser systématiquement l’agriculture elle-même, au risque de détruire aussi bien le paysage que le tissu social de régions entières.
Comme de nombreux experts nous l’ont rappelé, si nous respections intégralement les lois du marché et les règles de l’agriculture productiviste, nous n’aurions bientôt plus d’agriculture puisque, même en plein été, les tomates mexicaines, le maïs du Kansas et le lait du Wisconsin coûteraient moins cher que les produits équivalents achetés dans le voisinage. Quelques entreprises géantes subsisteraient à proximité des grandes villes avant de devenir de simples entrepôts pour des aliments produits au Sud à un coût moindre.
La mondialisation, combinée avec l’approche productiviste, nous pousse dans cette direction. Le modèle québécois tissé serré, avec ses coopératives et ses syndicats puissants, aura toutefois résisté mieux que le modèle américain à ce gigantisme qui, pour les uns, va vers l’avant et pour les autres est un retour à l’oligarchie comme il y en a tant d’exemples dans l’histoire.
Recommandations
· Renforcer le modèle québécois en l’aidant à échapper à des contradictions qui pourraient causer sa perte. Ce modèle, né sous le signe de l’union qui fait la force, devait permettre aux entreprises familiales d’exercer un plus grand contrôle sur la transformation et la mise en marché de leurs produits. Il a eu divers effets pervers, dont celui de favoriser les grandes exploitations et de limiter la liberté et la créativité des agriculteurs, à la limite, de les transformer en kolkhoziens.
· Avant d’autoriser la création d’un nouveau syndicat, que ce soit l’Union paysanne ou un autre, initiative qui pourrait à terme faire exploser le modèle québécois, il conviendrait toutefois de veiller à ce que le Mapaq retrouve au moins une partie de son pouvoir perdu; il conviendrait aussi de multiplier les incitatifs de nature à ramener l’UPA à la plénitude de la démocratie, ce qui impliquerait que les grandes entreprises soient exclues de cette union constituée à l’origine de fermes familiales.
Embellir le paysage
«Le paysage agit comme un filtre, les haies, les arbres, les talus retiennent une partie des éléments polluants. Eh bien, pour moi la promenade joue le même rôle sur le plan intérieur. Lorsque je reviens, filtré de la sorte, je suis à nouveau plus disponible pour les autres, plus prêt à entendre ceux que j’aime»(Luc Guyau, op.cit.).
Dans la plupart des cultures, les paysans, ceux qui ont façonné le paysage des campagnes, furent les premiers artistes, ceux qui ont indiqué la voie à suivre aux architectes, aux sculpteurs, aux peintres et même aux musiciens, à tous ceux à qui, par la suite, on a réservé le titre d’artiste. En Europe, ces artistes primordiaux furent les moines paysans. Encore aujourd’hui ce qu’on admire d’abord en Toscane, en Bourgogne ou en Bavière c’est l’unité, la continuité entre le paysage et l’architecture.
Au Québec, la région de Charlevoix est devenue le paradis des artistes, parce que ses prés, surplombant le fleuve, entourés de clôtures de perches et regroupés autour de villages en nids d’aigle constituaient un modèle d’agrément et de beauté que l’on désirait spontanément reproduire. Aujourd’hui, les clôtures de perche ont disparu, la plupart des prés sont en friche et de ces paysages, à la fois déshumanisés et mal renaturés, se dégage une tristesse qui, à la longue, éloignera artistes et touristes. Les mêmes causes produisent des effets semblables dans toutes les régions périphériques du Québec.
Comment redonner la plénitude de la vie à ces régions moribondes? C’est la question que l’on se pose à Solidarité rurale depuis une décennie. Ce mouvement, dirigé par un ancien président de l’UPA, il faut le rappeler, n’aura pas été étranger à un nouvel enthousiasme dans la population pour la terre et ses produits, enthousiasme orienté ici vers les jardins de plaisance, là vers les produits frais et naturels, ailleurs vers les fromages de lait cru.
Dans le cas de Charlevoix en particulier, région qui pourrait servir de laboratoire, ou plutôt d’atelier pour l’ensemble du Québec, c’est du modèle suisse qu’il faudrait s’inspirer, en dépit de ses imperfections. La Suisse en effet a su conserver ses paysages champêtres. Tout s’y est passé comme si, en échange de privilèges, exorbitants à certains égards6, accordés à ses paysans, elle avait obtenu d’eux qu’ils assument une responsabilité artistique à l’égard du paysage. Il n’est pas exclu qu’en plus de continuer à jouir des paysages traditionnels auxquels elle est attachée, la population suisse soit gagnante, même sur le plan financier, en raison de l’attrait que ces paysages exercent sur les touristes et de la qualité des aliments que les fermes du voisinage fournissent aux hôtels et aux restaurants. L’attachement de la population suisse à ses paysans a des racines profondes. Dès le début du XIVe siècle, après avoir chassé les Autrichiens, les paysans des cantons suisses ont donné aux sujets des monarchies voisines l’exemple d’une démocratie directe supérieure à celle de l’antiquité, qui n’a jamais cru pouvoir se passer d’esclaves.
Les Suisses n’auront pas le choix. Ils devront adapter leur agriculture hyperprotégée aux nouvelles conditions du marché international. Parmi les recommandations à l’étude, il en est une7 qui, mutatis mutandis, pourrait s’appliquer au Québec. Comme la Suisse, quoique à un degré moindre, le Québec soutient avec l’argent des consommateurs et des contribuables des productions qui, étant à la fois polluantes, non-conviviales et non compétitives, devraient passer au second plan, de telle sorte que les fonds publics qu’elles monopolisent soient orientés vers des productions plus conviviales, plus esthétiques et plus respectueuses de l’environnement.
Recommandations
· Comment faire en sorte que ce mouvement, dominé par le souci de la beauté des paysages et de la qualité des aliments, se traduise par une réhumanisation du paysage québécois? Comme il s’agit d’une forme de résilience, peut-être suffirait-il d’éliminer les obstacles sur la route de tous ceux, jeunes agriculteurs, retraités de fraîche date, travailleurs à temps partiel, qui voudraient faire revivre une terre tout en retirant d’elle un revenu raisonnable. Ces obstacles, nous les avons déjà évoqués, ce sont les règlements de tous genres, les uns émanant des services d’hygiène, les autres des mécanismes officiels de mise en marché. Tant qu’un petit éleveur de lapins ne sera pas autorisé à livrer sa marchandise directement aux hôtels et restaurants du voisinage, il n’y aura pas de renaissance de l’agriculture en Charlevoix, ou ailleurs au Québec.
Réjouir… le paysan
Le manque d’intérêt des jeunes pour le métier de cultivateur a été l’une des raisons pour lesquelles le nombre de fermes est passé au Québec de 51,600 en 1956 à 36,000 en 1996. Si l’on veut que la terre sourie de nouveau, il faudrait que l’on attire vers elle des êtres eux-mêmes souriants et qui conserveront leur sourire en dépit des difficultés auxquelles ils se heurteront fatalement en réalisant leurs projets.
Avant de conclure qu’il n’y aurait pas de volontaires pour une nouvelle colonisation, opérée sous le signe de la gratuité, il faudrait créer les conditions qui rendraient le travail de la terre intéressant. Ces conditions, ce sont la polyculture, la transformation sur place et l’accès direct au consommateur.
S’il est intéressant, le travail de la terre incitera les volontaires à faire les études et les stages d’apprentissage nécessaires. Il leur apportera aussi des satisfactions personnelles qui les dispenseront d’exiger des revenus aussi élevés que ceux de l’agriculture industrielle. Pour pratiquer l’agriculture biologique ou l’agriculture raisonnée, pour en tirer ensuite de la charcuterie fine, des farines de qualité, des fromages ou des confitures de luxe, il faut autant de compétence que pour diriger une ferme industrielle. Il importe dans ces conditions que le travail, les études et l’expérimentation soient en eux-mêmes une récompense.
Recommandations
· Faciliter les choses à toute personne, déjà compétente ou apte à le devenir, qui désire contribuer à la remise des terres en valeur et en beauté.
Notes
1. Éditions du Cherche Midi, Paris, 1998.
2. Cf Poisons of the Past, par Mary Kilbourne Matossian, Yale University Press, New Haven, 1989.
3. Au Canada, on dépense 3 milliards de dollars par année pour les animaux de compagnie, soit environ 100$ par habitant. Ce chiffre moyen étant plus élevé aux États-Unis et dans certains pays d’Europe, on peut faire l’hypothèse que dans l’ensemble des pays riches de la planète (1 milliard d’habitants), on dépense 100 milliards par année pour les animaux de compagnie, dont au moins la moitié pour la nourriture, soit 50 milliards.
Il y a au moins sur la planète 1 milliards d’habitants dont le revenu annuel moyen oscille autour de 1000$. A supposer que l’alimentation représente 50% de ce revenu, le coût total de l’alimentation pour ce milliard de pauvres serait de 500 milliards, soit dix fois le coût de la nourriture des animaux de compagnie des pays les plus riches. Ces animaux ont donc une ration équivalent à celle de 100 millions d’êtres humains.
4. Cité dans l’émission Le point du 21 mars 2001. La compagnie Aliments Breton se spécialise dans la production, l’élevage, la recherche génétique et la transformation de la viande de porc. La société compte 850 employés et son chiffre d’affaires dépasse 290M$. Monsieur Breton est membre de l’UPA et a droit aux mêmes subventions que les petits éleveurs pour chacun des milliers de porcs qu’il engraisse chaque année.
5. La terre et les hommes dans les lettres gréco-latines, Éditions Sang de la terre, Paris 1988.
6. «La première République française, nous l'avons vu, crée elle aussi une classe de petits propriétaires, nouvelle dans notre histoire, qui a joué au XIXe siècle, et jusqu'à l'entre-deux guerres, un rôle stabilisateur, salutaire au milieu des nombreuses convulsions politiques qui ont troublé ce siècle, et ont fourni à cette République, comme à la troisième, le fantassin de ses victoires.
Dans notre société post-industrielle, avec une paysannerie brusquement réduite à quelque 5% de la population, une organisation inévitable en coopératives géantes au service de l'agro-industrie, on ne peut plus songer à équilibrer une société moderne par une classe moyenne paysanne. On sera peut-être néanmoins étonné d'apprendre que dans le pays européen sans conteste le plus puissant économiquement aujourd'hui, l'Allemagne fédérale, la paysannerie, qui représente 5% de la population active, et satisfait les deux tiers des besoins alimentaires du pays, travaille (remarquablement) des propriétés qui font, en moyenne, 15 hectares» (Pierre Savinel, op. cit. p. 326).
«Les prix agricoles suisses sont en moyenne deux fois supérieurs aux prix de l’Union Européenne et deux fois et demi supérieurs à ceux dans le monde. Pour certains produits, la différence peut être plus grande encore. Le lait, par exemple, se vend à peu près quatre fois son prix européen et plus de huit fois son prix mondial. Cette situation ne pourrait se maintenir si le marché intérieur agricole n’était protégé par des droits de douanes prohibitifs. On taxe les produits agricoles importés à un taux moyen de 81.5%, alors qu’on ne taxe les importations de produits manufacturés en moyenne qu’à 2.6%. Le paysan suisse tire les trois quarts de son revenu directement du gouvernement ou des mesures que ce dernier a prises en sa faveur.»
Source : L’agriculture suisse est-elle vouée à la disparition?, par Fabienne Moix, Carole Moren, Philippe Rupp et Caroline Vannod.
7- «Il faut rendre le marché plus dynamique. Pourtant pour cela, il faudrait que la Suisse suive une double stratégie: ouverture du marché intérieur et orientation écologique de la production.
Ces recommandations peuvent paraître contradictoires car l'ouverture du marché demande plus de compétitivité, ce qu'on ne peut pas atteindre en augmentant les standards écologiques. Mais c'est là que réside le point sensible de toute la politique agraire suisse. Elle doit cesser de vouloir être compétitive par rapport à l'étranger. Au contraire elle doit subir une profonde réorientation en acceptant de réduire sa production, voire d'abandonner certains secteurs (par exemple le blé où elle est quatre fois moins productive que ses concurrents sur le marché agricole international). Elle doit plutôt s'orienter vers de nouvelles demandes qui se créent dans les produits bio, les spécialités locales et les nouveaux besoins immatériaux (protection des animaux, entretien de l'environnement, conservation des traditions et maintien d'une population dans les zones rurales et montagneuses).
Le gouvernement sera tenu de verser des paiements directs en échange de ces prestations écologiques, comme l'entretien du paysage, fournies par le paysan (paysage préservé et dépeuplement des zones rurales freiné). Le consommateur se trouvera face à des prix beaucoup plus bas et le gouvernement verra ses frais réduits.
Les seuls perdants seront les grands paysans lancés dans l'exploitation intensive qui verront leurs subventions et ainsi leur principale source de revenu disparaître. Confrontés au marché international, ils n’auront aucune chance de survie. Pour eux, il faudra, avec les gains réalisés par la libéralisation du marché, mettre en place par exemple une rente de préretraite et une formation pour faciliter la reconversion vers d'autres secteurs en expansion. Cette reconversion serait donc basée sur deux principes: celui d'une agriculture multifonctionnelle et celui du paysan-entrepreneur.
En effet, comme la taille du marché augmentera en cas d'abolissement des barrières agricoles, le consommateur pourra aussi profiter de plus de diversité et de variété. De plus, les paysans devront prendre en considération l'évolution de la demande, innover sur le plan des produits et de la technologie et améliorer le service à la clientèle. En un mot, les paysans devront s'adapter aux consommateurs.»
On peut trouver le lien vers le document en question dans le dossier Agriculture de L’Encyclopédie de L’Agora sur Internet.
Source : L’agriculture suisse est-elle vouée à la disparition?