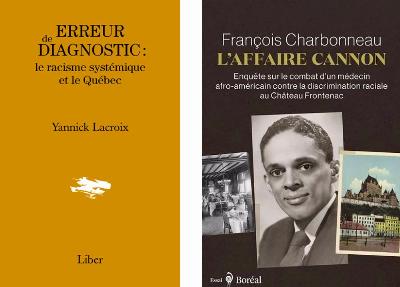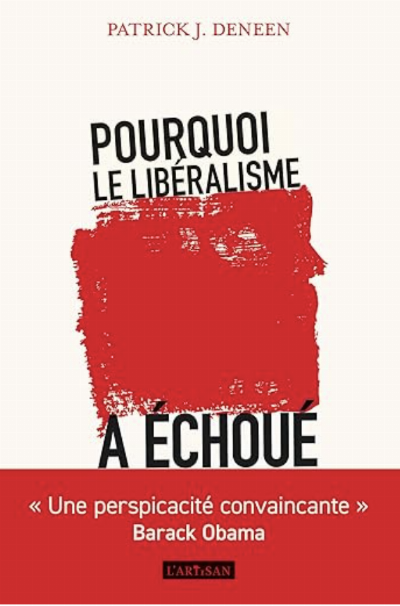La démocratie représentative et la juridicisation du politique
Il n'est plus saugrenu aujourd’hui de penser que les tribunaux sont aussi le théâtre de la délibération politique dans les systèmes politiques contemporains. La science politique voit la délibération comme un processus de discussion continu et diffus, qui n'est plus confiné à l'enceinte parlementaire. Selon Karl Deutsch, le processus juridictionnel est une forme de délibération organisée, au même titre que l’est la délibération parlementaire, gouvernée par ses procédures propres, le contradictoire pour les parties, la motivation pour le juge. La délibération est tellement essentielle aux mœurs politiques contemporaines qu'on a pu définir la démocratie comme un système de gouvernement par la discussion. Les partis politiques, l'électorat, le parlement, l'exécutif, les tribunaux, les médias, les groupes d'intérêts et les experts indépendants sont tous engagés dans un processus de débat et de persuasion.
La science politique a mis un certain retard, il est vrai, avant d’envisager la délibération judiciaire comme l’un des ressorts de la délibération générale. Cela tient vraisemblablement à la théorie classique du gouvernement représentatif qui lie la délibération à la représentation. Dans l’ouvrage connu qu’est The concept of representation, Hanna F. Pitkin a souligné comment des penseurs tels que Burke et des libéraux anglo-saxons placent la délibération au cœur de la fonction représentative. Chez Burke et Mill notamment, la délibération a pour théâtre le parlement. Pitkin montre aussi que l’on peut néanmoins concevoir le juge comme un représentant, au sens anglais de standing for. La représentation accomplie par le juge demeure toutefois abstraite : il représente ou bien l’État, en tant qu’il est l’un de ses agents, ou bien la justice, en tant qu’il est censé agir en conformité avec elle. Certains auteurs pensent que le juge, même non élu, représente indirectement la population, en ce qu’il ne peut être insensible à la pression et aux demandes populaires. Mais le rôle qui lui est le plus souvent dévolu est celui de gardien ou de fiduciaire. Burke, par exemple, fait du juge un trustee, un agent lié par une obligation fiduciaire à la population. Cependant, comme le fait remarquer Pitkin, l’administrateur n’est pas censé être le représentant du bénéficiaire de la fiducie (trust). Si l’administrateur doit agir dans l’intérêt du bénéficiaire, il le fait toutefois en son nom propre, sans consulter le bénéficiaire ni sans recevoir d’instruction de lui.
Avec la contestation contemporaine de la démocratie représentative, la figure du juge comme gardien impartial des droits de l’individu et des minorités a crû en autorité et en prestige. Le discours des droits suscité par la constitutionnalisation de chartes des droits a alimenté la contestation de la puissance souveraine de l’État. Il a encouragé la fragmentation de la société en groupes cherchant à préserver leur particularisme et à le faire reconnaître par l’État. À son tour, l’État a dû particulariser ses normes et chercher à obtenir le consentement de ces groupes pour légitimer ses décisions. Dans ce contexte, on peut dire que le juge, sans venir concurrencer les élus dans le champ du gouvernement représentatif, agit comme un représentant de l’État qui répond aux demandes d’adéquation entre l’action de l’État et la protection des identités sociales véhiculées par les droits. Ainsi le juge, sans établir de lien de représentation entre lui et la population, est celui qui traduit dans l’ordre politique et constitutionnel les diverses exigences de représentativité que divers groupes de la société formulent dans le langage du droit. Même si la légitimité démocratique du juge est l’un des puzzles insolubles de la théorie politique, dans les faits cette légitimité s’appuie sur une expertise technique et sur une apparence d’impartialité. La théorie juridique et politique contemporaine prend pour acquis, comme l’observa si bien Jeremy Waldron dans un récent ouvrage, que l’impartialité et la science du juge sont beaucoup plus dignes d’attention et de respect que le travail du législateur, emmêlé qu’il est dans la politique partisane et devant faire des compromis entre des intérêts contradictoires. Pourtant, il y a presque cinq cents ans, Machiavel nous mettait en garde contre l’idée que le calme et la solennité entourant une décision sont nécessairement les marques d’une bonne politique. De bonnes lois naissent souvent du conflit et du tumulte que beaucoup s’empressent toutefois de condamner.
Si nous laissons la théorie pour observer la pratique de la politique saisie par le droit, il est manifeste que les tribunaux canadiens sont devenus des lieux de débat politique à la suite de la réforme de 1982. Cela se vérifie à plusieurs signes. Tout d'abord, la structure du procès constitutionnel a changé; il n'oppose plus seulement un individu à l'État. Le procès compte désormais souvent en son sein des représentants de groupes d'intérêt qui obtiennent de la Cour suprême le droit d'intervenir pour faire valoir leur propre conception de enjeux de la contestation. Parmi ces groupes on trouve tous ceux dont les droits, et partant, les identités, sont protégés par la Constitution de 1982 : féministes, autochtones, minorités sexuelles et linguistiques, etc. Ensuite, ce qui a changé, c'est la nature de ce qui est discuté devant les tribunaux : le langage des juges, comme celui des plaideurs, est moins légaliste et est empreint d'arguments d'opportunité et d'orientation de politique. Les juges, comme les plaideurs et les intervenants, puisent à des données et des études socioéconomiques pour comprendre le contexte et l'impact social de la loi contestée. À bien des égards, plusieurs des procès mettant en jeu les garanties de la Charte canadienne ont ressemblé à des commissions parlementaires ad hoc évoluant dans un cadre judiciaire, comme l’a admis lui-même l’ex-juge en chef Antonio Lamer. Et puis, relayés par les médias, les débats judiciaires sont souvent au centre de l’actualité politique.
Cela dit, la transformation des tribunaux en forums politiques n'est pas le simple résultat instantané de la Charte canadienne. Plusieurs acteurs ont concouru à cette évolution. Tout d'abord, la Cour suprême elle-même y a contribué. En 1987, elle a libéralisé l'accès des groupes tiers au procès. Dans l'optique de la Cour, l'ouverture du procès constitutionnel aux groupes d'intérêts et aux minorités sociales est une stratégie utile à la légitimation de son propre pouvoir. Les décisions de la Cour paraîtront d'autant plus acceptables que la Cour aura pu entendre les groupes touchés par les enjeux du procès. Ce faisant, elle raisonne en législateur, puisqu'elle cherche à donner une solution globale à un problème politique ou moral en s'appuyant sur une évaluation des effets sociaux de la loi contestée. Ensuite, l'accès aux tribunaux a été favorisé par le gouvernement fédéral lui-même qui a mis sur pied dès 1978 un programme de contestation judiciaire destiné à subventionner les groupes désireux d'entreprendre des procédures judiciaires pour faire avancer leurs droits linguistiques, et à partir de 1985, les droits à l'égalité. Certains analystes ont même avancé, sur la base de ce programme de contestation judiciaire, que les groupes litigants et les juges sont devenus des agents agissant de manière oblique pour le compte du gouvernement fédéral et de ses stratégies d’unification nationale.
Ce tableau sommaire étant fait, il ne faut pas croire que la délibération qui a pour cadre les tribunaux équivaut à celle de la démocratie parlementaire. Sur le plan de la rhétorique, la Cour suprême a eu tendance à présenter ses jugements comme des opérations routinières de technique juridique étayées par des témoignages d'experts et des études scientifiques consultées pour évaluer l'impact social d'une mesure législative. Or, qui dit délibération, dit polémique, ce qui échappe aux vérités établies par la science. De plus, bien qu'elle soit ouverte à la preuve des faits sociaux, la Cour a éprouvé de la difficulté à les intégrer dans ses décisions, au risque de commettre de lourdes erreurs dans leur appréciation. La délibération devant les tribunaux est un processus qui tombe sous la mainmise des avocats. Les tribunaux sont des forums sélectifs; n'y entre pas qui veut; la Cour suprême exerce une discrétion dans le choix des groupes intervenant dans une affaire. Puis plaider, ce n'est pas parlementer avec des égaux.
L’un des changements les plus notables que la Charte canadienne et la politique des droits ont apportés est l’émergence de ce que l’on pourrait appeler les groupes litigants. La réforme de 1982 a favorisé l'avènement de groupes se définissant en fonction d'un particularisme reconnu par le langage de la Charte canadienne. Trudeau a réussi à conclure sa réforme en 1982 en s'alliant entre autres aux groupes réclamant une protection constitutionnelle. Ainsi, les groupes se définissant en fonction de leur statut juridique de femmes, de minorités de langue officielle, de personnes handicapées ou en tant que Néo-Canadiens ont vu leur statut et leur pouvoir renforcés. La Charte canadienne, en reconnaissant des protections particulières à ces groupes, a ainsi favorisé une fragmentation de l'identité canadienne. Elle inciterait les Canadiens à se représenter comme des acteurs constitutionnels qui peuvent, de plain-pied avec les représentants élus, participer au débat politique. Alan Cairns a appelé ce phénomène le minoritarisme constitutionnel. Plusieurs de ces groupes se sont organisés, voire bureaucratisés, et forts, dans certains cas, de subventions pour mener leur agenda, ils voient la Charte canadienne comme un moyen de transformation sociale plus efficace que le politique partisane. Certains d'entre eux se voient comme des démocrates justiciers et se persuadent que le recours aux tribunaux est une stratégie propre à élargir l'accès à l'espace démocratique.
Les effets de la Charte canadienne se sont manifestés bien au-delà des tribunaux. La réforme constitutionnelle après 1982 a permis de voir comment la Charte canadienne a enlevé aux exécutifs leur monopole sur le processus de ratification des accords signés au lac Meech et à Charlottetown. Par la pression qu'ils ont exercée sur les gouvernements et l'opinion publique, les groupes chartistes ont réussi à briser la solidarité intergouvernementale et à ériger une opposition efficace contre ces accords.
Certains analystes croient que l'influence des groupes chartistes est devenue telle que la Cour suprême est tombée sous leur emprise. La Cour suprême aurait tendance, disent-ils, à épouser le discours de ces groupes et à décider en leur faveur. Ces groupes qui se pressent devant la Cour sont issus non des classes moins fortunées mais de la classe moyenne et instruite dont les préoccupations sont avant tout sociales. Ces groupes sont des réformistes qui favorisent la redistribution des revenus par l'État mais non point la disparition des inégalités. Ils ne veulent pas tant influer sur une politique en particulier que réformer la société en entier. La Cour et ces groupes forment un parti, le parti de la Cour. Or, si la Cour est réceptive aux arguments de ces groupes, rien n'établit qu'elle soit tombée sous leur emprise. En réalité, la Cour s'est comportée comme une institution centriste qui tantôt annule les lois pour protéger les libertés de la grande entreprise et des minorités, tantôt étend la protection sociale accordée par la loi au nom des garanties de la Charte. Toutes sortes de groupes gravitent autour de la Cour, activistes de gauche, associations professionnelles, syndicats et entreprises privées. Or, si l'on comptabilise les procédures où l'on invoque la Charte, ce sont les entreprises privées qui y ont eu le plus recours. Ce que cela signifie : l'action judiciaire est un moyen accessible aux groupes organisés, et il semble que la Cour ait pratiqué une politique d'ouverture maximale à ces groupes, quels qu'ils soient.
Il y a plusieurs façons d’étudier l’impact de la politique judiciarisée sur la démocratie représentative. On peut bien sûr analyser les débats judiciaires et relever les caractéristiques du forum judiciaire. À trop concentrer notre analyse sur les juges, on risque de perdre de vue d’autres aspects cachés de la politique saisie par le droit. On sait que depuis 1982, les ministères de la justice ont instauré des procédures de contrôle de conformité des projets de loi avec la Charte canadienne. Par ce contrôle préalable, beaucoup de choix de politique sont faits ou influencés par les juristes d'État œuvrant dans les administrations. En ce sens, on peut dire que la réforme de 1982 n'a pas tant renforcé le pouvoir des tribunaux que donné à la profession juridique plus de prise sur l'État canadien. On dispose de peu de données sur le contrôle préventif des lois exercé par les juristes d’État. Le peu que nous en savons nous permet néanmoins d’avancer l’hypothèse que le contrôle judiciaire de lois est venu renforcer le processus de technicisation de la production du droit amorcée depuis la naissance de l’État-providence.
Par ailleurs, outre les débats judiciaires et l’action peu visible des juristes d’État, les relations entre les tribunaux et les parlements est un autre aspect de la délibération modifiée par le discours des droits. Dans un article faisant le bilan des annulations judiciaires prononcées entre 1982 et 1996 en vertu de la Charte canadienne, deux juristes, Peter Hogg et Allison Bushnell, prétendent que le contrôle judiciaire des lois au Canada apparaît d’autant plus acceptable qu’un dialogue s’est instauré selon eux entre les tribunaux et les parlements sur l’interprétation à donner à la Charte. De prime abord, l’idée paraît séduisante; le contrôle judiciaire, bien loin de mettre des barrières à l’expression de la volonté démocratique, pousserait le judiciaire et le législatif, par une navette incessante, à collaborer dans l’atteinte d’un juste équilibre entre la protection des droits constitutionnels et les exigences du gouvernement. Selon les auteurs, le jugement ne met pas nécessairement fin à la délibération politique puisque dans la majorité des cas, les législateurs prennent acte des décisions des tribunaux et revoient ensuite leur législation. Le concept de dialogue entre le judiciaire et le législatif a fait florès au point que la Cour suprême l’a invoqué à plusieurs reprises dans ses décisions pour rendre plus acceptables ses annulations.
Cependant, pour attrayant qu’il soit, le concept de dialogue nous apparaît théoriquement et empiriquement peu fondé. Premièrement, le simple fait que les législateurs réagissent aux annulations judiciaires n’implique pas nécessairement que les parlementaires engagent un dialogue avec les juges sur la portée des droits constitutionnels ou sur la proportionnalité des lois. Un dialogue suppose un échange à double sens entre deux interlocuteurs qui se parlent et qui s’écoutent mutuellement. Deuxièmement, si on examine les débats parlementaires suivant les invalidations judiciaires, d’ordinaire les élus se contentent d’enregistrer les interprétations judiciaires, sans les remettre en question, le recours à la clause dérogatoire étant jugé impensable ou hors de portée. En réalité, l’absence de dialogue entre les juges et les parlementaires montre plutôt qu’il s’est concentré, depuis 1982, sur l’institution judiciaire une autorité interprétative absolue, comme si l’interprétation de la constitution était le monopole de l’appareil judiciaire. En ce sens, on peut dire que l’autorité des juges dépasse leur pouvoir. Quand bien même les parlementaires pourraient contester le pouvoir des juges de déterminer définitivement les interprétations à donner au texte de la Charte canadienne, l’autorité des juges est devenue telle que le pouvoir dérogatoire s’en est trouvé comme neutralisé par une interdiction tacite. Comment pourrait-on envisager une interprétation à plusieurs voix des protections constitutionnelles? C’est là l’une des questions capitales qui se posent à la théorie du constitutionnalisme libéral.
Il y a d'autres phénomènes apparentés à la politique des droits qui influent toutefois sur l'évolution de la démocratie représentative. Depuis notamment les années 1980, le Canada, à l'instar de plusieurs autres pays occidentaux, s'est mis à privatiser plusieurs secteurs d'activités sous gestion publique. Cette privatisation est allée de pair avec la réglementation d'État, c'est-à-dire la délégation de plusieurs secteurs d'activités à des autorités administratives indépendantes qui cumulent des pouvoirs de gestion et de réglementation (CRTC, Régie de l'énergie). Ces autorités administratives ont un processus décisionnel qui s'apparente à celui des tribunaux : elles jouissent d’une indépendance fondée sur l’expertise, leur procédure de décision observent un certain formalisme, puis ces autorités consultent les groupes affectés par la réglementation avant de prendre leur décision. Ainsi, la régulation par la réglementation d'État s'est conjuguée avec le constitutionnalisme libéral pour réduire le champ des domaines réservés au gouvernement représentatif classique et pour donner naissance à de nouvelles pratiques politiques qui s'éloignent de la représentation. Ce phénomène n'est pas propre au Canada. Il s'observe ailleurs, aux États-Unis et en Europe. Y-a-t-il convergence dans les modes de gouvernance des démocraties occidentales? La Grande-Bretagne nous fournit à ce propos un exemple significatif. Après avoir, sous le gouvernement Thatcher, introduit la dérégulation et la réglementation d’État, voilà que sous le gouvernement Blair elle enjoint ses tribunaux d’appliquer, depuis octobre 2000, la Convention européenne des droits de l’Homme qu’elle avait longtemps refuser d’incorporer dans le droit national au nom de la souveraineté parlementaire.