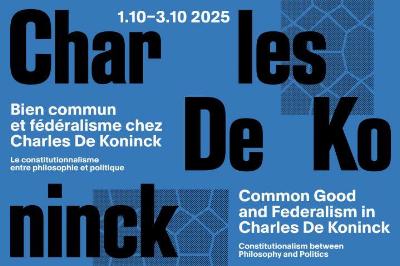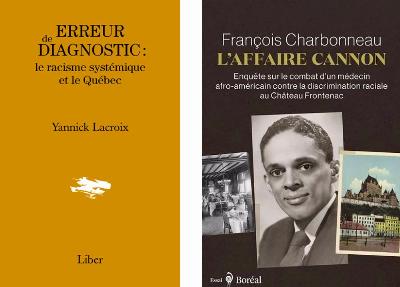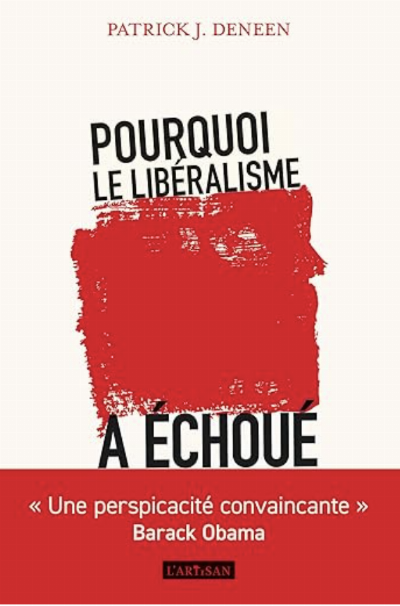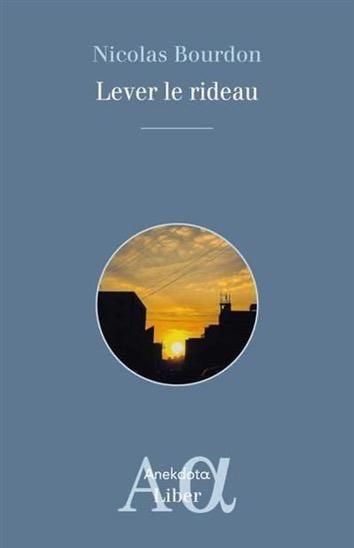La liberté du culte, une garantie fondamentale à moderniser
Le débat sur la laïcité engagé depuis plusieurs années au Québec semble avoir oublié une loi ancienne, mais toujours en vigueur, qui protège la liberté de tous les cultes en vertu de la constitution du Québec. Alors que le gouvernement et une partie de la population semblent enclins à interdire les prières dans les espaces publics, il serait utile de considérer cette loi, dont l'ambition première consistait à assurer le bon ordre et la paix dans les lieux de culte, bien que plusieurs de ses dispositions semblent aujourd'hui désuètes. Une refonte de la Loi sur la liberté des cultes serait donc bienvenue, non pour supprimer la liberté du culte, mais pour la garantir et en préciser le cadre d'exercice. Si la protection de la liberté de culte ne semble pas une priorité au Québec, le gouvernement libéral de Mark Carney a en fait son affaire à Ottawa, en déposant un projet de loi en septembre 2025 pour sanctuariser l'exercice de cette liberté par la loi criminelle.
Au cours des derniers mois, la pratique de prières musulmanes sur la place d’Armes devant la basilique Notre-Dame à Montréal a soulevé de nombreux débats et même des contre-manifestations. Devant la polémique et la grogne populaire ainsi suscitées, le gouvernement de la CAQ a promis de renforcer la législation actuelle sur la laïcité. Il semblerait même, selon un sondage réalisé par la firme Léger au début de septembre 2025, que c’est au Québec que la volonté d’interdire les prières dans les espaces publics est la plus affirmée au Canada[1].
Or, dans le débat que le Québec nourrit depuis quelques années sur la laïcité, on a perdu de vue un élément du casse-tête législatif. Depuis bien avant qu’il n’adopte la loi 21, le Québec possède une loi particulière qui garantit et encadre la liberté religieuse. Il s’agit de la Loi sur la liberté des cultes. Cette loi constitue un legs d’une loi ancienne, adoptée sous le régime de l’Union en 1852 pour séculariser les terres publiques réservées à l’Église anglicane en 1791 et proclamer ce faisant l’égalité des confessions religieuses. Ce legs a survécu à la création du Québec en 1867 et, après plusieurs refontes, devient la Loi sur la liberté des cultes en 1964. Cette dernière accomplit essentiellement deux choses : 1- Tout d’abord, garantir la liberté du culte pour toute profession religieuse, pourvu que l’exercice de cette liberté ne serve pas « d’excuse à la licence » et n’autorise pas des « pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté au Québec ». Cette garantie revêt un caractère solennel, puisqu’elle prévaut en vertu de la « constitution » et des « lois du Québec ». 2- Ensuite, réglementer le « bon ordre dans les églises et leurs alentours », en prévoyant même des sanctions pénales pour certaines activités jugées perturbatrices du culte.
Au cours des années, cet encadrement législatif du bon ordre cultuel a cependant perdu de sa portée et de sa pertinence. Il reste encore quelques articles en vigueur, dont la lecture révèle leur caractère désuet. Ainsi l’article 2 de cette loi fait reposer sur les marguilliers de paroisse la responsabilité de veiller au bon ordre dans les églises et auprès d’elles, sous peine d’amendes allant de 2 à 8 $. De même quiconque sème le désordre dans une église « pendant le service divin, ou se conduit d’une manière indécente ou irrévérencieuse dans cette église ou près de cette église » s’expose à une amende de 1 à 8 $. Toute personne qui s’amuse trop près d’une église pendant le « service divin » et qui, malgré l’ordre qui lui est donné de se retirer, refuse de quitter les lieux, peut également commettre une infraction. Fait amusant, si quelqu’un assiste au « service divin » à l’église et doit circuler près d’elle, à cheval ou en voiture, à une vitesse supérieure au trot, il s’expose à une amende allant de 1 à 2 $. Bref, cette loi, qui dote les officiers de paix dans chaque « paroisse, seigneurie, canton ou localité » de pouvoirs équivalents à ceux d’un marguillier, décrit un monde reculé, qui n’a plus grand-chose à voir avec les réalités d’aujourd’hui.

Il n’empêche que cette loi ne devrait pas être mise au rancart; elle formule un principe toujours fondamental en démocratie libérale : celui de la liberté religieuse (ou des cultes), à la condition que son exercice ne perturbe pas la paix et l’ordre public ; c’est là un principe observé dans nombre de sociétés, sous des formules diverses. Dans son jugement sur la loi 21, la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur la Loi sur la liberté des cultes. Même si le principe que celle-ci énonce participe de la « constitution » du Québec, la Cour a estimé que cette loi n’avait pas de valeur supralégislative et donc qu’elle pouvait être modifiée par une loi ordinaire.
La révision de la loi constituera une tâche délicate. Conçue pour assurer le bon ordre des offices religieux dans les paroisses catholiques, la loi devrait vraisemblablement encadrer l’exercice du culte pour toutes les confessions qui composent le paysage religieux québécois. Le législateur devra aussi trouver des notions plus précises et moins moralement chargées que la « licence » et « l’irrévérence » pour maintenir la paix et la sûreté et ainsi guider le travail des agents publics et des responsables du culte. Cependant, le législateur ferait erreur s’il ne s’avisait que d’accumuler les restrictions pour policer les manifestations publiques de croyances religieuses. La liberté religieuse, dans ses dimensions individuelle et associative, mérite aussi d’être garantie et donc d’être protégée par des sauvegardes opérables, telles qu’en contenait d’ailleurs la célèbre loi concernant la séparation des Églises et de l’État adoptée en 1905 en France. Contrairement à ce que plusieurs pensent dans ce pays comme au Québec, la laïcité n’implique pas la relégation de toute manifestation de croyance religieuse dans la sphère privée, que ce soit au domicile du croyant ou dans l’édifice du culte. Ramener la liberté religieuse à un simple droit à la dévotion cachée reviendrait quasiment à « révoquer » la liberté religieuse, et ferait glisser le Québec sur une pente qui le rapprocherait du règne de Louis XIV!
L’extension du domaine du culte
Pendant qu’au Québec d’aucuns songent à resserrer les conditions d’exercice de la liberté de culte dans l’espace public et les institutions éducatives, à Ottawa, au contraire, on envisage sa sanctuarisation par le droit pénal. Ainsi, le 19 septembre 2025, le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, a déposé au Parlement un projet de loi visant, par des amendements apportés au Code criminel, à protéger l’accès aux lieux de culte et aux établissements fréquentés par certains groupes identifiés par ce Code. Le projet de loi C-9 prévoit ériger en infraction criminelle le fait de vouloir intimider toute personne dans le but d’entraver son accès à un lieu de culte ou à un cimetière ou de vouloir gêner intentionnellement cet accès sans raison légitime. Une telle infraction encourrait une peine allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Cependant, cette nouvelle infraction protégerait également d’autres groupes qui, dans l’esprit du législateur, seraient dans une position équivalente à celle d’adeptes d’une religion. Cette catégorie spéciale est appelée « groupe identifiable » par le Code criminel et se définit comme suit : « groupe identifiable s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique. » Cette catégorie renferme donc, pour une bonne part, ce qu’on pourrait considérer comme les groupes identitaires, qui se définissent et se distinguent par l’appartenance à une identité minoritaire ou jugée défavorisée par la société. On reconnaît aussi ce que la science politique canadienne a nommé les « Charter peoples », soit tous ces groupes activistes qui ont fait alliance avec les libéraux fédéraux, depuis Pierre-Elliott Trudeau, pour défendre leurs intérêts et leur identité constitutionnalisée par notamment l’article 15 de la Charte canadienne, qui énumère les droits à l’égalité et les motifs de discrimination interdits. En vertu de l’amendement projeté par les libéraux de Mark Carney constituerait donc un acte criminel punissable d’une peine allant jusqu’à dix ans de prison le fait de vouloir entraver, par l’intimidation ou par obstruction, l’accès des membres des groupes « identifiables » à un bâtiment où ils ont l’habitude de se réunir pour leurs activités régulières, ce qui inclut une école, une garderie ou une résidence pour personnes âgées.
Il est remarquable que le législateur fédéral, par une retouche chirurgicale au Code criminel, mette ainsi sur le même plan les croyances religieuses et les convictions idéologiques ou morales des groupes identitaires, d’où la nécessité d’accorder à tous les mêmes protections juridiques par la sanctuarisation d’un côté, de la liberté de culte, et de l’autre, de la liberté associative des « Charter peoples » qui animent le Canada multiculturel et chartiste dont les libéraux fédéraux ont fait leur marque de commerce politique. Cette infraction projetée ne ravit cependant pas tout le monde. Selon l’Association canadienne des libertés civiles, « Le nouveau délit d’intimidation est beaucoup plus large que les interdictions existantes et pourrait criminaliser des manifestations pacifiques simplement parce qu’elles sont considérées comme perturbatrices. » Par ailleurs, on se demande comment on pourra concilier cette nouvelle infraction avec la réglementation annoncée au Québec pour prohiber ou restreindre les « prières de rue » aux abords des édifices servant au culte. Comme le projet de loi C-9 n’a pas encore franchi toutes les étapes parlementaires en vue de son adoption, le texte pourra encore évoluer, en fonction des amendements qui y seront peut-être adoptés. Une histoire à suivre.
[1] Voir Opinion sur les prières dans les endroits publics, Léger, 8 septembre 2025, en ligne : https://leger360.com/fr/les-prieres-dans-les-endroits-publics . Selon cette enquête, 43% des Québécois interrogés voulaient interdire les prières organisées dans les espaces publics contre 50% d’entre eux qui voulaient les autoriser sans condition ou avec certaines conditions. Dans le reste du Canada, les proportions sont de 21% des interrogés favorables à l’interdiction contre 68% de ces derniers disposés à les admettre, avec ou sans restrictions.