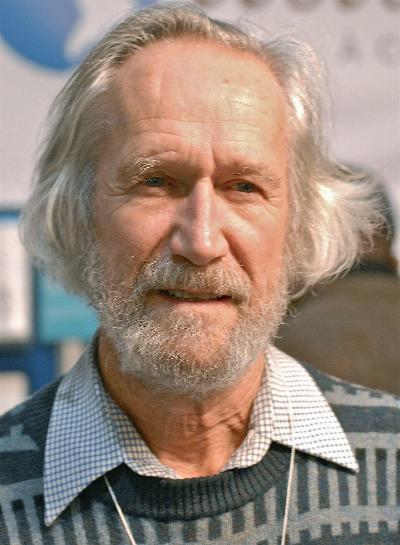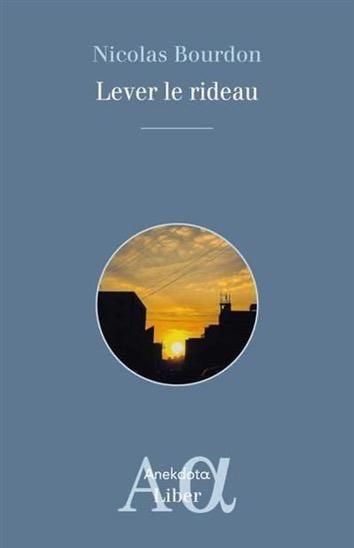La démocratie dans le monde
Aux États-Unis, ce sont les lobbies qui ont le plus d'influence. Non sans quelques bonnes raisons, oserai-je l'avouer, le président de la National Rifle Association, organisme qui, fort des 89 millions que lui versent ses membres chaque année -un américain sur 85 en fait partie- se flatte de pouvoir empêcher l'élection d'un candidat à la présidence qui se proposerait d'imposer un contrôle strict des armes feu.
Dans la plupart des autres pays, dont le Canada, ce sont les corporations, les syndicats et les associations de patrons qui ont le plus de pouvoir. À la différence des lobbies qui, parce qu'ils agissent dans l'obscurité peuvent défendre sans vergogne des intérêts particuliers, les corporations et autres groupes de pression analogues, se présentent toujours comme des défenseurs de l'intérêt public. Quand ils veulent accroître leur part du budget de l'État, les médecins, les juges ou les enseignants mettent toujours au premier plan, non leurs intérêts, mais la cause de la santé, de la justice ou de l'éducation.
Face à ces puissants clients, les chefs de nos États démocratiques font penser à des amuseurs de dauphins. Dans la piscine publique, une dizaine de ces bêtes, une douzaine au maximum, toutes plus rusées les unes que les autres, se disputent de plus en plus âprement les poissons de plus en plus petits que leur présente l'amuseur.
Le peuple regarde le spectacle à la télévision, avec, parfois, le sentiment que ses députés ont pour seul privilège d'assister à la même curée depuis les estrades. Et quand il veut se manifester, ce peuple, il emprunte des voies nouvelles qui sont marginales par rapport aux institutions de représentation. Par exemple, il forme des associations dans le but de faire interdire la construction d'une centrale nucléaire ou d'obtenir que les automobiles soient plus sécuritaires. Plusieurs observateurs ont soutenu, au cours des dernières décennies, que c'est sous cette forme que survit aujourd'hui cet esprit démocratique qui avait fait l'admiration de Tocqueville au XIXe sicle.
Cette tendance a eu pour effet d'accroître le pouvoir des tribunaux et celui des avocats, lequel était déjà considérable à l'origine. Si bien, qu'aux États-Unis tout au moins, et dans une mesure pour l'instant moindre au Canada, les tribunaux semblent jouer un rôle plus important que les parlements dans la vie publique. Cette tendance est de plus en plus accentuée par le fait qu'à défaut de pouvoir prendre des décisions claires sur des questions controversées comme l'avortement ou la langue d'affichage, les parlements s'en remettent d'eux-mêmes aux tribunaux. On a même d'excellentes raisons de penser qu'ils introduisent délibérément dans les lois des passages flous qui leur permettront d'éviter une confrontation dans l'immédiat, mais rendront invitables par la suite de nouveaux recours aux tribunaux.
[...]
Pendant soixante-dix ans, les dictatures communistes se sont présentées au monde comme des démocraties. L'abus de langage était évident. Ne l'était-il pas autant à l'Ouest, à cette seule différence près que, dans ce cas, le véritable régime est l'oligarchie plutôt que la dictature d'un parti?