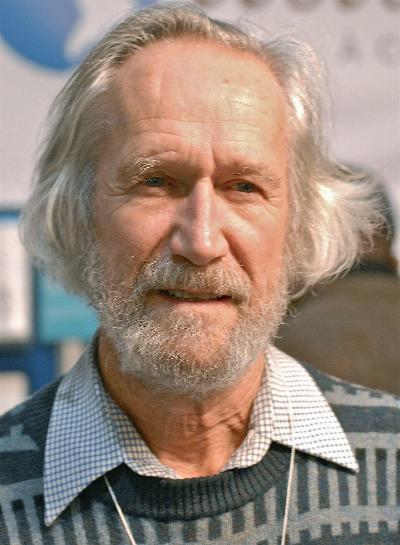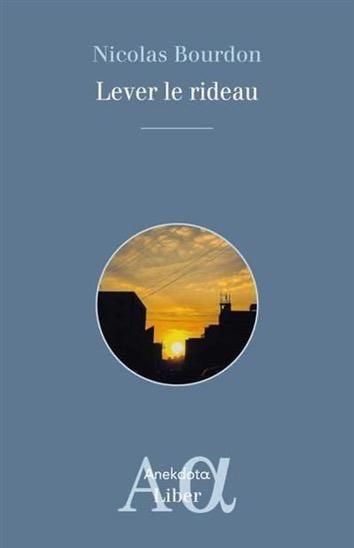La présence réelle
Être en rapport avec le réel, c’est aussi sentir le frémissement de l'esprit vivant au coeur des oeuvres d'art dignes de ce nom. C’est de cette vie que témoigne George Steiner dans Le sens du sens, Présences réelles. Il nous invite par là à assimiler l'art à l'Incarnation.
«[...] C’est seulement par la foi dans la réelle présence de l’esprit vivant au coeur des grandes oeuvres d’art que l’on peut échapper au nihilisme. Je ne peux parvenir à aucune conception rigoureuse d’une possible détermination du sens ou de l’existence quelconque qui ne parie pas sur une transcendance, une présence réelle, dans l’acte et le produit de l’art sérieux, qu’il soit verbal, musical ou art des formes matérielles». (George Steiner, Le sens du sens, Librairie philosophique J. Vrin, 1988, p. 67).
La prochaine citation nous met dans la présence réelle... et amicale de George Steiner et de tous les chefs-d’oeuvre qu’il aime, que nous aimons et que désormais nous aimerons en pensant à lui. Steiner veut d’abord nous rassurer. Présence réelle, mystère, ce ne sont pas, dit-il, des mots savants. Nous les vivons chaque fois «qu’une mélodie en vient à nous habiter, à nous posséder même sans y être invitée, chaque fois qu’un poème, un passage de prose s’empare de notre pensée et de nos sentiments, pénètre les méandres de notre mémoire et de notre sentiment du futur, chaque fois qu’un tableau métamorphose les paysages de nos perceptions antérieures (les peupliers sont en flamme après Van Gogh, les viaducs marchent après Klee). Être investi par la musique, l’art, la littérature, être rendu responsable d’une telle habitation comme un hôte l’est de son invité - peut-être inconnu, inattendu -, c’est faire l’expérience du mystère banal d’une présence réelle» (ibid., p. 63).
Ces expériences appartiennent à l’immensité du lieu commun. Steiner précise ainsi ce qu’il entend par présence réelle: «Là où nous lisons vraiment, là où l’expérience doit être celle du sens, nous faisons comme si le texte (le morceau de musique, l’oeuvre d’art) incarnait (la notion a ses fondements dans le sacré) une présence réelle d’un être signifiant. Cette présence réelle, comme dans une icône, comme dans la métaphore réalisée du pain et du vin consacrés, est finalement irréductible à toute articulation formelle, à toute déconstruction analytique et toute paraphrase»(ibid., p. 62).
Steiner est bien conscient de la difficulté de rendre compte de convictions comme la sienne dans le contexte créé d’une part par le positivisme logique, le déconstructivisme et d’autre part par ce qu’il appelle l’éclectisme libéral, qui n’est rien d’autre que le relativisme découlant d’une liberté qui en permettant tout, nivelle tout également. Mais, écrit-il, «l’inévitable embarras qui doit accompagner tout aveu public de mystère me semble préférable aux faux-fuyants et aux déficits conceptuels de l’herméneutique contemporaine.»