Brèves
Thème : Culture
Disparition de Victor-Lévy Beaulieu, écrivain aux grandes œuvres
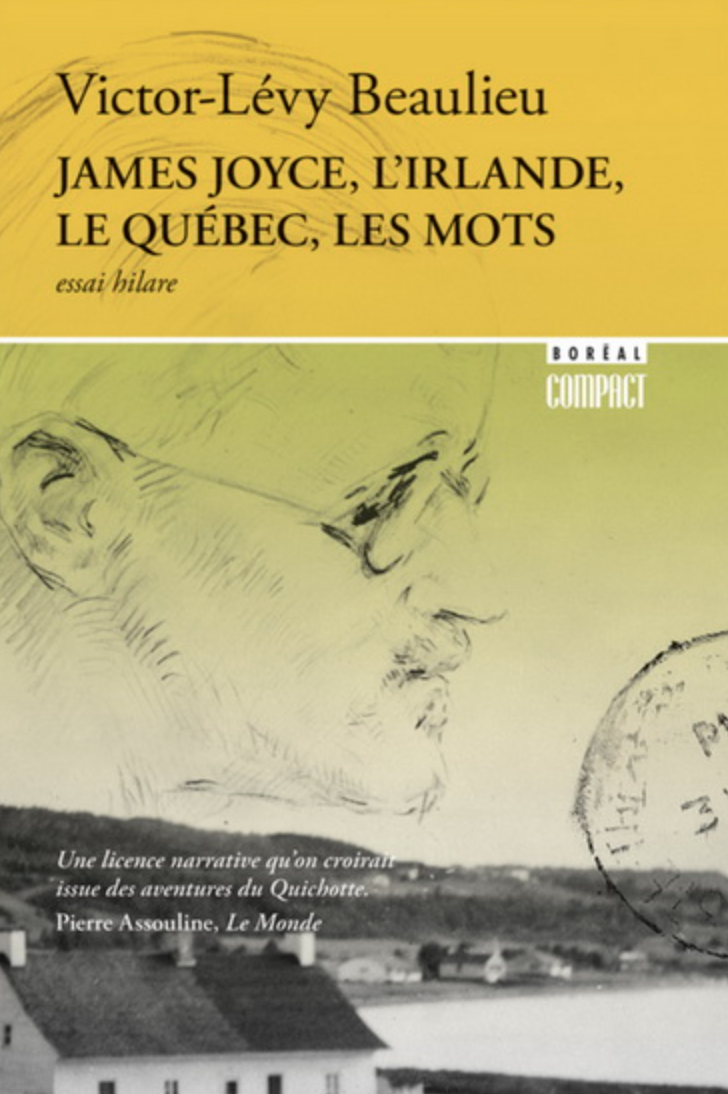
« Au Québec, Victor-Lévy Beaulieu, ou tout simplement VLB, entre assurément dans la catégorie des écrivains politiques dont l’œuvre, qui en impose et déconcerte, se rie des frontières savantes. Or, dans la littérature québécoise contemporaine, c’est Victor-Lévy Beaulieu qui a rendu à l’Irlande, à sa littérature et à son histoire tragique le plus bel hommage qui soit, un hommage en forme d’épopée et de mausolée narratif qui défient les genres littéraires usuels. Cet hommage est d’autant plus étonnant que la référence à l’Irlande dans la littérature et la politique québécoises contemporaines avait été intermittente, sinon chétive.
Victor Lévy-Beaulieu est assurément l’un des plus prolifiques de nos écrivains, il a à son actif au-delà d’une soixantaine de titres. Né en 1945, l’écrivain est un boomer, qui a suivi une trajectoire atypique, en portant plusieurs chapeaux dans l’espace public : éditeur, écrivain, polémiste et défenseur notoire de l’indépendance québécoise. Il a pratiqué tous les genres, le théâtre, le roman, la poésie, l’essai, le téléroman. VLB a dans sa besace plusieurs essais consacrés à des géants de la littérature, Victor Hugo, Jack Kérouac, Herman Melville, Voltaire, Léon Tolstoï. Son essai hilare sur James Joyce apparaît donc comme un aboutissement, un magnum opus ; c’est le plus volumineux de ses hommages, 1080 pages, contre 750 pour son Melville. C’est peut-être le plus achevé, le plus complexe, le plus étourdissant. C’est dire la place que VLB accorde à Joyce dans son panthéon.
La fascination de VLB pour Joyce est ancienne. Il l’aurait découvert dès 1964, et depuis n’aurait cessé de le lire, de l’étudier. Son Joyce raconte même l’histoire de cette découverte. Ce n’est pas le seul ouvrage où VLB révèle sa fascination pour Joyce, plusieurs ouvrages précédents l’avaient annoncée. Quant à l’ouvrage lui-même il aurait été écrit entre 1973-2005. Il est donc le fruit de près de quarante ans de lectures et d’écriture, livrées au lecteur comme une somme. « [L]a rédaction de James Joyce… a été en soi une véritable odyssée », écrit Jean-François Chassay. D’ailleurs, pour le bénéfice du lecteur, VLB fournit une abondante bibliographie sur l’histoire d’Irlande, James Joyce, plusieurs des ouvrages qui y sont indiqués sont annotés par VLB lui-même. […]
« Les peuples vaincus n’ont jamais d’histoire par-devers les autres et par beaucoup plus par devers eux-mêmes. Ne naissant pas au monde, ils ne naissent pas chez eux non plus. » Le Québec du reste, lance VLB, est une nation plus « hystérique qu’historique » En racontant l’histoire d’Irlande, VLB historicise son propre travail d’historien et étend le champ de l’histoire québécoise, qui inclut désormais celle d’une nation jumelle, qui partage avec lui une communauté de destin. Le Québec et l’Irlande sont deux nations « catholiques à gros grains », dit-il. C’est pour lutter contre le défaut d’histoire, la tendance à l’oubli qui est le sort des nations vaincues que VLB ambitionne de donner à son écriture une profondeur historique. Il agit ce faisant comme un écrivain national, non pas chantre du repli sur un récit national étriqué, mais héraut d’un récit surdimensionné, cosmique, gourmand, à plusieurs voix, où les chants celtes se mêlent aux chansons à répondre québécoises. C’est aussi une façon de s’inscrire en faux contre la littérature québécoise contemporaine, devenue à ses yeux fade, ignorante de tout héritage historique, au style pauvre et uniforme. L’errance cosmopolite dont se gavent les écrivains globe-trotter québécois masque selon lui une grande indigence. Ils ont aboli la référence à la France et la Grande-Bretagne dans leurs expériences d’écriture centrées sur des moi individuels sans épaisseur collective. VLB emprunte un tout autre chemin; il ose rétablir la filiation à l’Irlande, à l’aune de laquelle la Grande-Bretagne est prise à partie, à la fois comme nation conquérante et culture assimilatrice. […] »
Extraits de l’article suivant : Marc Chevrier « Victor-Lévy Beaulieu, James Joyce, les langues et le Québec hibernien », dans Linda Cardinal, Simon Jolivet et Isabelle Matte (dir.). Le Québec et l’Irlande, Québec, Septentrion, 2014, p. 214-235.
Ted Gioia: assistons-nous à l'effondrement du système des connaissances?
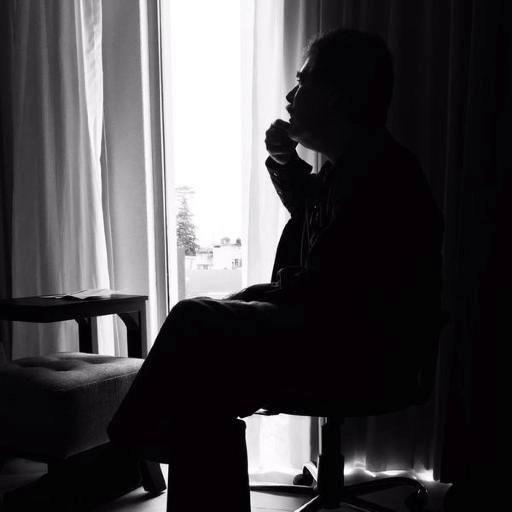 Le critique culturel Ted Gioia, une des vedettes de Substack avec ses 240 000 abonnés, qui s'est fait connaître entre autres par ses articles sur la culture de la dopamine, y va une fois de plus d'une de ses prédictions audacieuses:
Le critique culturel Ted Gioia, une des vedettes de Substack avec ses 240 000 abonnés, qui s'est fait connaître entre autres par ses articles sur la culture de la dopamine, y va une fois de plus d'une de ses prédictions audacieuses:
«Les changements les plus importants se produisent souvent bien avant qu'on leur donne un nom. On peut penser à la Renaissance, aux Lumières, à la naissance des grandes religions. Lorsque les scribes s'en aperçoivent, le monde est déjà en train de renaître. Si le New York Times remarque le Bouddha, c'est que l'illuminé a déjà quitté la ville. Nous vivons actuellement une telle situation [...] un changement total, comme l'inversion des pôles magnétiques. Mais ce changement n'a pas encore de nom. Appelons-le : l'effondrement du système des connaissances. »
Quelques signes précurseurs de ce bouleversement:
- Les études scientifiques ne sont pas être reproduites et les études scientifiques les moins rigoureuses (faked studies) sont régulièrement les plus citées.
- La méfiance du public à l'égard des experts a atteint une intensité sans précédent.
- Le parcours professionnel des travailleurs du savoir est en train de s'effondrer.
- Les universités ont perdu leur prestige et se sont fait des ennemis parmi les principaux dirigeants.
- L'IA s'impose partout comme le nouveau système expert. Mais lorsqu'elle hallucine et génère des inepties, les autorités prennent cela pour argent comptant.
Gioia se réjouit en fait de cet effondrement, car, croit-il, «la technocratie devient si oppressive et manipulatrice qu'elle va susciter un retour du pendule. Notre rébellion pourrait ressembler au mouvement romantique du début du XIXe siècle. Nous avons besoin d'un nouveau romantisme.»
Est-ce que le déclin de la lecture explique la crise de la démocratie ?
 Selon plusieurs commentateurs, dont le théoricien des médias Andrey Mir, les modes de pensée et de discours de l'ère numérique ressemblent de plus en plus à ceux des cultures orales pré-alphabétisées. Ces auteurs s'appuient largement sur les travaux du philosophe Walter Ong, qui a développé dans Orality and Literacy une théorie très influente, quoique controversée, sur la façon dont les cultures orales et littéraires divergent.
Selon plusieurs commentateurs, dont le théoricien des médias Andrey Mir, les modes de pensée et de discours de l'ère numérique ressemblent de plus en plus à ceux des cultures orales pré-alphabétisées. Ces auteurs s'appuient largement sur les travaux du philosophe Walter Ong, qui a développé dans Orality and Literacy une théorie très influente, quoique controversée, sur la façon dont les cultures orales et littéraires divergent.
« Andrey Mir affirme que l'"oralité numérique" a plongé de nombreux conservateurs et progressistes dans l'abîme de la caverne de Platon - le royaume allégorique où les intuitions subjectives sont prises pour des vérités objectives. La droite subordonne la raison au culte de la personnalité de Trump, tandis que la gauche accorde moins de valeur à l'empirisme qu'à l'"intersectionnalité". Il en résulte un "tribalisme identitaire", une polarisation et une crise de la démocratie représentative.»
Quelques traits de l'oralité
«Dans une culture orale, toutes les idées importantes doivent être exprimées d'une manière qui soit à la fois mémorable et facile à réciter.»
«Cela implique, entre autres, l'utilisation intensive de répétitions, de formules, de moyens mnémotechniques et d'épithètes.»
«Par ailleurs, dans une société orale, la communication doit toujours se faire face à face, souvent à portée de voix des autres villageois ou hommes de clan. Selon Ong, cela imprègne le discours d'un esprit combatif, car les déclarations ont tendance à se doubler de demandes de statut et d'affirmation sociale.»
«Plus important encore peut-être, ces limites de l'oralité l'ont rendue incapable d'accueillir la pensée abstraite.»
Un essai à lire dans Vox (en anglais).