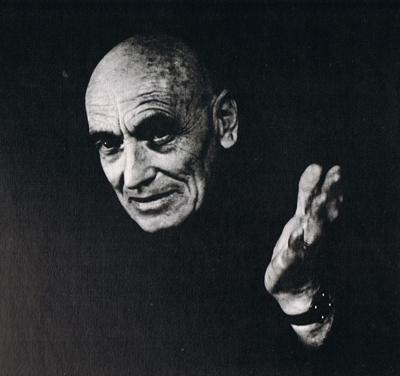L'enseignement supérieur aux États-Unis
En 1974 et 1975, la revue Daedalus a continué le travail déjà entrepris par l'Assembly en publiant deux importants numéros sur l'enseignement supérieur aux Etats-Unis.1 Quelques-uns des meilleurs représentants des collèges et des universités d'outre-frontière ont collaboré à ces numéros. Quelques-uns, c'est-
-à-dire plus de cent. La mosaïque d'opinions et de propositions qui en est résulté présente un intérêt considérable.
Au moment où, un peu partout, se forment des comités sur l'avenir des universités, nous avons pensé faire oeuvre utile en présentant un résumé de certains articles, choisis de façon à illustrer la variété des points de vue sous lesquels on peut aborder le problème de l'enseignement supérieur. Ces articles sont d'une qualité telle qu'ils n'ont pas vieilli en deux ans.
David Riesman et Gerald Grant,2 The Ecology of Acadernic Reform
Riesman et Grant présentent d'abord les diverses expériences marginales qui ont servi de modèles aux contestataires des années soixante.
Les mouvements anti-universitaires des années vingt
Dans les années vingt, il y eut aux États-Unis un mouvement anti-universitaire qui amena la fondation de quelques institutions ayant pour objectif de former non une élite, mais des leaders syndicaux, des agents qui retourneraient dans leur milieu d'origine pour y opérer des changement politiques et sociaux. Antioch College est un archétype en cette matière. Au cours des années soixante, Antioch devint le haut lieu du mouvement des activistes radicaux.
Le mouvement néo-classique
Un collège archétypal bien différent était fondé en 1937 par Scott Buchanan, un disciple de Robert Hutchins, éditeur des Great Books: le St-John's College à Annapolis. Comme la plupart des institutions qui se définissaient par opposition à l'université, St-John's College était caractérisé avant tout par un idéal d'ordre moral, en l'occurrence la vertu au sens platonicien du terme. Scott Buchanan voulait former des hommes complets et non des hommes capables-de-réussir-dans-la-vie-et-de-se-faire-des-amis.
Dans le domaine intellectuel proprement dit, ce qui caractérisait le St-John's College, c'est la cohérence. Première réaction contre les super-marchés éducatifs. À St-John's, on pensait également que les classiques, les mathématiques et la philosophie étaient les disciplines les plus aptes à former l'esprit. Encore aujourd'hui les néo-classiques considèrent comme vulgaire et technocratique la formation donnée dans les collèges et les universités divisés en départements. Il n'empêche que Buchanan se considérait lui-même comme un radical, non comme un réactionnaire.
Le mouvement esthétique
Dans l'enseignement supérieur américain, le muscle a toujours été plus respecté que la fibre artistique, associée à la sensibilité féminine. Dans les années vingt, ceux qui vou!aient étudier les arts devaient se diriger vers les conservatoires ou les instituts spécialisés. C'est dans les années trente que furent fondés les premiers collèges féminins à vocation avant tout artistique. La co-éducation devait mettre par la suite les collèges à la portée des mâles. Le célèbre collège Black Mountain fut fondé en 1932. Buckminster Fuller, Paul Goodman, le peintre Joseph Albers ont été très marqués par ce collège. Au cours des années soixante, l'intérêt pour les arts a commencé à se répandre, mais avec mesure: aucune grande université, à l'exception de Stanford, ne décerne plus de vingt-cinq diplômes en art chaque année.
Le mouvement communautaire
Deux noms caractérisent ce mouvement d'inspiration rousseauiste: Abraham Maslow et Carl Rogers. Tout a commencé dans les années cinquante et soixante par les National Training Labs destinés à aider les professeurs, les membres du clergé et les hommes d'affaires à devenir plus sensibles aux réactions affectives d'autrui. On sait le succès que la formule du T-Group a connu par la suite. En 1969, le Johnson College était détaché de l'université de Redlands. Le corps professoral de ce collège comprenait non seulement des spécialistes du T-Group, mais des observateurs ayant pour fonction de faire rapport sur l'évolution de la vie affective des étudiants. Cette expérience ne dura que quelques années. En 1970, en Californie, le Kresge College était fondé. Les fondateurs de ce collège prétendaient qu'un environnement éducatif ne pouvait favoriser la création que dans la mesure où il était caractérisé par des rapports humains directs, ouverts et explicites.
Dans les revendications des étudiants au cours des années soixante, on retrouvait des éléments pouvant être rattachés à chacun des quatre mouvements dont nous venons de donner un aperçu. Riesman et Grant considèrent cependant que les causes immédiates de la révolte étudiante furent plutôt d'ordre démographique.
Les effectifs de l'enseignement supérieur américain, gradués mis à part, étaient en 1945 de 500 000, en 1960 de 3 500 000 et en 1970 de 7 400 000, progression qui s'explique en partie par le baby boom de l'après-guerre.
La compétition entre étudiants, devenue plus dure en raison du seul facteur numérique, a été aggravée par divers autres facteurs dont le lancement du spoutnik et le fait que plusieurs institutions ont profité de l'occasion pour élargir leur bassin de recrutement. Pour toutes ces raisons, il était plus difficile d'avoir la note A en 1965 que dix ans plus tôt.
Si tout a éclaté, concluent Riesman et Grant, ce n'est pas parce que l'enseignement était mauvais, mais au contraire parce qu'il était trop fort. La situation commença à se renverser à la fin des années soixante. En 1970, 16% des étudiants obtenaient la mention honors, 19% en 1971, 23.5% en 1972, 27% en 1973. Taux annuel d'inflation: 20% environ.
Puisque la paix est revenue sur les campus et que, du moins dans les grands centres, les étudiants travaillent beaucoup, on admet généralement que la situation est revenue à ce qu'elle était dans l'ère post-spoutnik, que l'autorité des professeurs a été restaurée. Nous ne sommes pas de cet avis. Les attitudes des étudiants ont changé beaucoup moins que leur comportement. Plusieurs des étudiants qui se préparent aux études de médecine dans des collèges sélectifs ne rêvent ni de gloire ni de fortune; ils veulent plutôt une profession où ils seront sûrs d'être vraiment utiles, qui leur permettra d'échapper à l'emprise de la bu. reaucratie et de préserver leur autonomie personnelle. Cet idéal est partagé par une forte proportion de ceux qui s'entassent dans les facultés de droit ... Dans la nouvelle situation économique des années 70, à une époque assombrie par les désillusions politiques consécutives aux attentes extravagantes de la décade précédente, professeurs et étudiants n'en continuent pas moins à rester a
ttachés aux idéaux des années soixante; ils les transposent dans la forme que prennent leurs ambitions, dans leur art de vivre, voire même dans leurs actions et leurs conversations quotidiennes.
Robert N. Bellah,3 «The New Religlous Consclousness and The Secular UniverSity»
Robert N. Bellah montre comment l'enseignement universitaire actuel est fondé sur la rationalité, mais une rationalité qui n'a plus rien à voir avec la recherche de la vérité ou d'une réalité ultime. «La connaissance est un outil de manipulation du monde». Le seul but de l'université, c'est de donner à l'étudiant les moyens concrets et les connaissances suffisantes pour parvenir à cette manipulation.
Tout autre était la conception des grandes sociétés traditionnelles. Dans le confucianisme, par exemple, la relation de l'élève avec son maître était aussi importante que celle de l'enfant avec ses parents. L'enseignement revêtait des
formes disciplinaires rigoureuses. Éduquer, c'était transformer un être, lui donner accès à la sagesse. «L'éducation traditionnelle n'était pas une relation entre un sujet fermé et un objet étranger, mais le développement d'une personne transformée par sa relation avec un tout organique qui comprenait la société où elle vivait, le monde de la nature et le cosmos tout entier».
L'esprit critique qui a commencé à se répandre au XVIle siècle a progressivement miné toutes les grandes doctrines sociales et religieuses. Les grands maîtres du doute du Xixe siècle, Marx, Nietzsche et Freud ont dénoncé tous les masques sous lesquels se cachait l'homo religiosus. Malgré tout, on peut dire qu'un enseignement tenant compte de la formation complète de l'élève a subsisté aux États-Unis jusqu'à tout récemment. Mais l'accès des masses à l'université et la sécularisation des programmes a rapidement éliminé toute trace de ce type d'éducation.
Ce sécularisme moderne, en faisant disparaître la tyrannie religieuse, a fait naître une tyrannie pire encore, celle du pragmatisme et de ses conséquences: l'homme bureaucrate, technocrate et manipulateur, qui rejette la transcendance et dont la «vision est unilatérale», pour reprendre le mot de Blake.
Ce diagnostic posé, l'auteur se réfère à ce que Ricoeur appelle la «naïveté seconde» par opposition à la «naïveté première», c'est-à-dire à tout ce qui était perçu comme acquis et qui a été miné par la critique systématique.
La «naïveté seconde», ce serait, une fois la part faite àl'esprit critique, le retour conscient aux grands symboles religieux. Et c'est cette naïveté seconde que Bellah désigne comme «une nouvelle conscience religieuse». «En usant de mots franchement traditionnels, on pourrait définir la naïveté seconde comme l'accomplissement ultime de l'iconoclasme biblique, qui n'accepte aucun ersatz de la Divinité elle-même».
L'adepte de cette naïveté nie le caractère définitif de toute interprétation religieuse. Mais à la différence des maîtres du doute, il croit que les symboles religieux ont une signification inépuisable, même s'ils sont sujets à tous les changements sociaux, historiques et idéologiques. L'auteur oppose égalemen cette conscience à la contre-culture; cette conscience religieuse se fait à l'intérieur de la culture moderne et non en opposition avec elle.
Bellah croit que cette nouvelle conscience religieuse pourrait trouver un support dans un département de religion et, éventuellement, si fragile soit-elle, contribuer en s'étendant, à régler le schisme entre le rationalisme désincarné de l'université actuelle et notre être humain tout entier.
Allan BIoom,4
«The Failure of the University»
Allan Bloom est surtout préoccupé par le déclin des études libérales. Il pense que ce déclin est causé par le refus des modèles européens. «Peu de choses ici pouvaient inspirer les meilleurs esprits», remarque-t-il. De plus, les grands classiques européens ne nous sont d'aucun secours pour régler les problèmes, tel le féminisme, qui sont à l'ordre du jour. On peut rejeter toute la tradition sous le seul prétexte qu'elle est dans son ensemble un produit du «male chauvinism».
Partant d'un texte où Tocqueville se demande si Pascal aurait pu être Pascal dans la société américaine, Allan Bloom se demande si le sens de la gratuité nécessaire aux études libérales peut vraiment exister en dehors de la société aristocratique, qui dispense certains de ses membres de se préoccuper de leur gloire et de leur fortune.
Il est vrai, conclut-il, que la paix est revenue dans les campus, que les étudiants étudient, mais il ne s'agit pas d'études libérales.
Les étudiants s'ennuient. Ils s'ennuient parce qu'ils ont déjà joui au secondaire de cette liberté qu'ils espéraient autrefois trouver au collège; il s'ennuient parce qu'ils ont été imprégnés de l'idéologie qui présente l'université comme l'instrument de l'establishment et le passeport pour le succès. Ils s'ennuient parce que le vieux snobisme, idiot mais stimulant, a disparu; ils s'ennuient parce qu'ils préparent une carrière qu'ils savent nécessaire mais qu'ils méprisent. Mais avant tout ils s'ennuient parce que l'université ne leur offre aucune inspiration, aucune raison supérieure de vivre, parce qu'elle ne leur ouvre aucune perspective à la fois vaste et nouvelle.
James A. Perkins,5
«The University - Old Ghosts and New»
James A. Perkins estime que pendant les années soixante les universités américaines ont surtout établi la preuve de leur vitalité. Elles ont plié, dit-il, mais elles n'ont pas rompu. D'une manière générale, le public a fait preuve de beaucoup de tolérance à leur égard.
Quatre grands défis attendent encore les universités, soutient James A. Perkins.
1. La poussée égalitariste. Selon toute vraisemblance, l'entrée à l'université devra se faire sur une base de plus en plus égalitariste et la sortie dans des conditions de plus en plus méritocratiques.
2. La responsabilité. Les universités devront rendre des comptes de façon de plus en plus suivie et rigoureuse.
3. L'isolationisme. Il est vraisemblable que la tendance àVisolationisme se fasse de plus en plus sentir dans les universités à un moment où les échanges internationaux seront de plus en plus importants.
4. Le problème des ressources. On misera de plus en plus sur les ressources intellectuelles des universités pour résoudre les problèmes posés par l'épuisement des resources matérielles, particulièrement des ressources énergétiques.
À l'agitation des années soixante a succédé la tranquillité des années soixante-dix. Cela nous rend nerveux. Le hurlement des loups a été remplacé par un étrange silence. Nous nous Interrogeons. Les loups sont-ils vraiment partis ou profitent-ils de l'obscurité pour se rapprocher du feu de camp?
Alexander Gerschenkron,6
«The Legacies of Evil»
Alexander Gerschenkron traite surtout des traces laissées chez les professeurs par la crise des années soixante. Elles sont plus profondes, dit-il, qu'on ne veut généralement l'admettre.
Certes les doyens ne sont plus jetés en bas des escaliers. La courtoisie est revenue. Mais si les plaies se sont cicatrisées, certaines blessures sont encore très douloureuses. Les humiliations, les insultes, les menaces ont laissé une rancoeur sous-cutanée qui expliquent certains changements subtils dans le comportement des professeurs.
Les cours continuent d'être donnés et préparés comme ils l'ont toujours été, mais les professeurs éprouvent constamment le besoin d'insister sur l'importance de l'enseignement, comme s'ils avaient à se justifier. La bouche toutefois ne parle pas toujours de l'abondance du coeur. Le coeur justement n'y est pas, pas autant que par le passé. «La relation maître-élève est une plante trop fragile pour qu'on puisse sans risques la piétiner et la brutaliser par des menaces et des demandes non-négociables». Unbewaeltigte Vergangenheit! Passé non dominé! C'est cette vieille expression allemande qui selon Gerschenkron résume le mieux la situation.
Quelque chose d'autre a changé, de toute évidence. Les conversations des professeurs aux repas et aux rencontres plus formelles ne sont plus tout à fait les mêmes. Le sujet des conversations s'est élargi considérablement. L'accent était jadis mis sur les questions liées au travail professionnel. Les gens parlaient des choses qu'ils connaissaient bien et hésitaient beaucoup avant d'aborder des questions qui n'étaient pas de leur ressort. Ce n'est manifestement plus le cas. Je considère pour ma part qu'il s'agit là d'une autre conséquence des années d'agitation.
Clark Kerr,7
«What We Might Learn from the Climateric»
Les sondages, note Clark Kerr, révèlent que de 1969 à 1975 les institutions d'enseignement supérieur ont perdu la moitié du crédit dont elles jouissaient dans l'opinion publique. Au cours des années 60, le coût de l'enseignement supérieur était passé de 1 à 2.5% du PNB.
L'université, poursuit l'auteur, n'est plus en situation de monopole. De plus en plus, l'industrie fait elle-même ses recherches ou les confie à des agences spécialisées telles que Rand and Brookings. Dans tous les domaines, la compétition se fait plus vive.
Pendant longtemps les universitaires avaient reproché aux administrations publiques de ne pas s'intéresser aux noirs et aux femmes. La situation à cet égard était encore plus déplorable dans les universités elles-mêmes. La vague égalitariste, qui en inquiète plusieurs, est donc un juste retour des choses.
Clark Kerr est persuadé que les mouvements de contestation sont cycliques. Il remarque cependant que leur amplitude a tendance à s'accroître de vague en vague. Que nous réserve la prochaine crise? Les petits groupes d'activistes qui sont à l'oeuvre actuellement sont-ils les derniers représentants de la vague précédente ou les précurseurs de la prochaine?
Clark Kerr soutient finalement que tout compte fait l'enseignement supérieur a fait preuve d'une grande vitalité. Il se réjouit de ce que professeurs, étudiants et administrateurs semblent capables de s'unir contre l'ennemi extérieur, à défaut de pouvoir résoudre les problèmes internes dans l'harmonie.
Les collèges et les universités sont des systèmes de sentiment tout autant que des structures administratives. lis se sont toujours plu au cours des siècles à se considérer eux-mêmes comme des communautés de savants unis par un lien d'affection.
Ce voile de tendre attachement fraternel a été bien déchiré ces dernières années, en particulier dans les institutions d'élite, où le sens de la communauté était le plus fort. Dans les corps enseignants il y eut bientôt une gauche, un centre et une droite.
Gerard Piel,8
«Public Support for Autonornous University»
À l'heure actuelle, les universités privées dépendent des pouvoirs publics pour près du tiers de leur budget. Malgré cela leur situation financière se détériore depuis 1967.
La vocation première des universités n'est pas de contribuer à l'effort de guerre. Pourtant quand, après la fin des grands programmes spatiaux et militaires, les universités ont pu enfin revenir à leur vocation première, elles ont perdu beaucoup de crédit dans l'opinion publique; comme si un fort pourcentage des américains ne les tolérait que dans la mesure où elles font autre chose que ce qu'elles doivent faire!
Mais que doivent-elles faire? Gérard Piel répond sans hésiter: former des gouvernants et non des gouvernés, car dans une démocratie le citoyen est gouvernant. Mettre l'accent sur la formation professionnelle comme on le fait actuellement n'est peut-être pas la meilleure façon de former des gouvernants, poursuit Gerard Piel: «that does not always come along with trinning in a marketable skill».
À cause d'excès dans l'usage de la liberté d'enseignement, plusieurs collèges et universités se sont montrés incapables d'offrir un enseignement cohérent. En conséquence, dans les universités d'État les étudiants sous-gradués ont déserté les cours de humanities et même les sciences, là du moins où elles ne sont pas exigées par la spécialité. Ils se sont tournés vers les cours de «business», de «prelaw» «and similarly relevant and sterile course of studies».
Le marchandage entre les agences gouvernementales et les universités doit cesser, soutient Gerard Piel, y compris dans le cas des institutions privées. Ces dernières doivent continuer à servir de phares aux autres institutions. Elles ne doivent pas avoir honte du besoin qu'elles ont des fonds publics. Au lieu d'essayer de se justifier en publiant des statistiques sur le rapport entre la recherche et la croissance du PNB, elles devraient réaffirmer avec énergie leur vocation première, qui est de former des gouvernants.
Pour ne pas être à la merci des grandes agences, elles feraient bien de porter le problème des subventions devant l'électorat. En retour, elles devraient renoncer aux frais de scolarité, c'est-à-dire ouvrir leurs portes à tous les citoyens sans distinction d'âge, de sexe ou de fortune; tout en maintenant leurs exigences intellectuelles et en sauvegardant ce qui constitue leur originalité.
Le petit livre de Alexander Meiklejohn, Education between two Worlds, nous rappelle que la plus grande partie de l'argent, du temps et de l'énergie humaine dépensée en éducation dans les universités sert àpréparer les citoyens à leur rôle de gouvernés. Ce qu'il faut pour former un gouvernant c'est une intelligence autonome, disciplinée de telle sorte qu'elle puisse rechercher la vérité, y faire face et qu'elle soit capable de porter ces jugements imposants grâce auxquels on peut se tenir debout devant l'autorité et résister aux illusions réconfortantes.
Kenneth E. Boulding,9
«Quality versus Equality»
Les départements dans les universités sont caractérisés soit par l'économie de marché, soit par la collégialîté. Dans le premier cas, on est prêt à payer très cher pour obtenir les services d'un professeur reconnu à l'extérieur ou pour retenir ceux d'un professeur sollicité par une autre institution; ce qui entraine l'inégalité. Dans le second cas, l'égalité règne; le professeur affirme son pouvoir non en usant de son droit de partir mais en cherchant à avoir voix au chapître.
C'est, soutient Kenneth Boulding, l'égalitarisme qui a tué Cambridge et Oxford. Il rappelle à ce propos que la célèbre étude d'Adam Smith sur le cas d'Oxford constitue une analyse subtile de la pathologie de la collégialité.
À l'heure actuelle aux U.S.A., la tendance est à l'égalité. Cela inquiète Kenneth Boulding. Que deviendront les professeurs les plus créateurs, les high achievers? N'auront-ils droit dans leur département qu'à la même fraction de secrétaires que leurs collègues les moins productifs? Il demeure souhaitable et possible, soutient Kenneth Boulding, de créer, en dehors des départements, des instituts, des centres de recherche et des revues.
Mais alors la vie dans les départements ne deviendra-t-elle pas de plus en plus triste? D'où le conflit entre les cosmos, qui ont la fortune et la gloire, et les Iocals, qui espèrent faire l'équilibre en négociant des conventions collectives.
Kenneth Boulding déplore que l'enseignement comme tel passe au second plan, ce qui selon lui s'explique par le fait qu'il s'agit là d'un travail invisible et difficile à évaluer. La médiocrité des facultés d'éducation, poursuit-il, aggrave encore la situation.
Remède? Pourquoi pas des instituts, répond Kenneth Boulding; entendons par là la possibilité pour les professeurs se consacrant au seul enseignement de présenter des projets d'expérimentation pédagogique jouissant du même statut que les projets de recherche.
La solution du dilemme de l'égalité et de la qualité ne pourra venir que du développement de ce qu'on pourrait appeler une super-collégialité, c'est-à-dire un sens de la communauté si fort que l'inégalité puisse être rendu légitime par l'intérêt de l'ensemble.
John G. Kerneny,10
«The University in Steady State»
La croissance zéro des effectifs étudiants pose de nombreux problèmes, dont celui du renouvellement du corps professoral. Il y a vingt-cinq ans, rappelle John G. Kemeny, un professeur en probation dans une grande université avait environ 50% de chances de devenir permanent. Après un échec dans les ligues majeures, il avait toutefois droit de reprise dans les ligues mineures, si bien qu'il n'avait aucune raison sérieuse de perdre espoir. À l'heure actuelle, dans plusieurs bonnes universités les chances d'obtenir la permanence sont de 30%,11 situation d'autant plus dramatique que les postes disponibles dans les ligues mineures se font de plus en plus rares.
Pour poser clairement le problème, John G. Kemeny se livre à quelques exercices de mathématiques à partir des données disponibles dans sa propre institution. À Dartmouth, la période de probation est de six ans. La diminution naturelle des effectifs enseignants est d'environ 2% par année. On suppose par ailleurs, pour simplifier le modèle, que chaque groupe d'âge est équitablement représenté. On distingue ensuite la croissance rapide (5%), la croissance lente (2%) et la croissance zéro. Partant de ces données, John G. Kemeny dresse un tableau permettant d'obtenir le rapport entre la probabilité de la permanence et le pourcentage de professeurs permanents selon chaque type de croissance.
À supposer donc qu'une institution veuille maintenir le pourcentage de ses professeurs permanents à 60%, cela signifie que les chances d'obtenir la permanence seront de 80% en croissance rapide, de 55% en croissance lente et de 40% en croissance zéro. Dans la plupart des cas concrets, les chances d'obtenir la permanence sont moins élevées en raison du fait que les groupes d'âge les plus récents ont été favorisés par la croissance rapide des dernières années.12
Faut-il donc abolir la permanence, comme le réclame un nombre croissant de professeurs en probation? John G. Kemeny n'est pas de cet avis. Il estime qu'un pourcentage négligeable des professeurs permanents profitent de leur inamovibilité pour ne rien faire. Il serait insensé, pense-t-il, de priver la majorité de la liberté que donne la sécurité, dans le seul but d'éliminer quelques médiocres. John G. Kemeny suppose, bien entendu, que l'octroi de la permanence est un rituel extrêmement sérieux, ce qui est le cas à Dartmouth College.
Comment alors améliorer la situation des professeurs en probation? John G. Kemeny passe diverses solutions en revue dont le recours à des étudiants gradués et à des professeurs de l'extérieur engagés pour une période déterminée. À Dartmouth même, la solution retenue est un plan de retraite anticipée d'un type particulier.
Si les autres professions n'offrent pas la même sécurité que l'enseignement, elles n'exigent par contre rien de comparable à l'évaluation très rigoureuse qui précède la décision concernant la permanence dans les bonnes institutions. Je serais prêt à soutenir qu'à Dartmouth le processus par lequel on octroie la permanence est plus exigeant que n'importe lequel des dépistages en milieu de travail qui se pratique dans l'industrie et dans les professions.
R. W. Fieming,13
«Reflexion on Higher Education»
Selon R.W. Fleming, l'application des principes égalitaristes, dans l'admission des étudiants particulièrement, posera encore bien des problèmes dans l'enseignement supérieur américain. Pour faire la sélection, on utilisait surtout des tests et les résultats du secondaire, ce qui défavorisait les candidats issus des milieux pauvres. Pour rendre justice à ces derniers, plusieurs institutions ont choisi d'adopter dans leur cas des critères spéciaux. Toutefois, certains éléments de la majorité ont vu là une injustice. Les poursuites judiciaires se sont multipliées. R.W. Fleming conclut qu'il faudra trouver un système d'admission pour tous tout à fait nouveau, tâche qui, selon lui, ne sera pas facile et ne manquera pas de créer de nouvelles divisions.
Parlant ensuite des contrôles gouvernementaux sur les institutions, qui sont de plus en plus subventionnées, R.W. Fleming reconnaît qu'il sera bien difficile d'échapper à une bureaucratisation croissante. Résultat: chercheurs et administrateurs continueront de perdre une grande partie de leur temps à rédiger de longs rapports que les destinataires ne liront pas, faute de temps et de personnel.
Bref, sur le plan financier l'avenir prévisible des universités est plutôt sombre. Les coûts vent continuer de s'accroître mais les revenus ne pourront pas suivre la même courbe. Pour accorder aux professeurs et au personnel non-enseignant les augmentations de salaires et d'honoraires qui seront réclamées de plus en plus énergiquement, les administrations devront opérer dans le personnel des coupures telles que les ressources disponibles puissent être réparties entre moins de monde. Cette mesure va aggraver encore la situation du marché pour les nouveaux Ph.D., mais elle est néanmoins inévitable.
Daniel P. Moynihan,14
«The Polities of Higher Education»
Les collèges et les universités privés ont-ils des chances de survivre? Tout indique, répond D.P. Moynihan, qu'ils ont laissé passer une occasion qui ne se représentera plus. Cette occasion, c'est la fondation nationale dont il avait été question à la fin des années soixante. Cette fondation, imitée de la University Grants Commission de Grande-Bretagne, aurait réparti au mérite des fonds publics entre les institutions reconnues pour leur excellence.
Les gouvernements, soutient D.P. Moynihan, ont pris l'habitude d'assigner à l'éducation des finalités qui n'ont rien àvoir avec l'éducation; ces finalités sont liées à la défense nationale et à l'idéal politique de l'égalité des chances.
Il aurait donc fallu que les universités privées défendent leur cause de façon très énergique. Elles ne l'ont pas fait. Mais pouvaient-elles le faire, demande D.P. Moynihan? À commencer par les plus élitistes d'entre elles, elles sont en contradiction avec elles-mêmes: elles sont égalitaristes idéologiquement et élitistes écologiquement. Le message des professeurs, qui sont de plus en plus à gauche, est en opposition avec le medium qui est fondamentalement capitaliste; les institutions privées, en effet, ne paient pas de taxes sur les bénéfices qu'elles tirent de capitaux accumulés pour la plupart au dix-neuvième siècle.
On comprend donc, poursuit Moynihan, le malaise qu'éprouvent les représentants de ces institutions quand vient pour eux le moment de défendre l'excellence de leurs institutions sur la place publique.
D.P. Moynihan trouve cette situation regrettable parce que, dit-il en s'inspirant de David Riesman, c'est l'exemple des grandes universités privées qui, jusqu'à ce jour, a permis aux institutions publiques d'échapper aux pires excès de l'égalitarisme. L'excellence atteinte par certaines universités publiques constitue à son tour un défi positif pour les institutions privées. En laissant disparaître ces dernières, les américains perdront sur les deux tableaux, conclut Moynihan. Il n'accorde de chances de survie qu'à Harvard et Notre-Dame.
Les subventions accordées aux universités sont soumises à des changements perpétuels. Tout pour l'espace! Et puis hop! rien pour l'espace! Vaches maigres pour l'astronomie! Les sciences sociales décollent! Fin de la portion déjà congrue pour les langues et les études régionales! Place au coeur, au cancer...! C'est ainsi que les subventions sont passées de 44 millions à 4.5 milliards en 1975.
Généralement plus un secteur de l'administration publique devient important, plus il s'élève dans la hiérarchie bureaucratique. À ce compte, l'enseignement supérieur devrait avoir au moins son propre soussecrétaire, sinon un département particulier. En réalité, il n'a qu'un délégué auprès du commissaire à l'éducation, ce qui signifie qu'il est à la remorque de l'enseignement élémentaire et secondaire.
Hernian Feshbach,15
«Graduate Education and Fédéral Support of Research»
Herman Feshbach s'inquiète de ce qu'on subventionne de moins en moins la recherche pure au profit de la recherche orientée vers la solution de problèmes concrets, comme ceux que pose la découverte de nouvelles sources d'énergie. Pour défendre sa thèse, il cite un long texte de H.G.B. Casimir, dont voici un extrait.
J'ai ouï dire que le rôle de la recherche pure dans la découverte serait minime. C'est l'absurdité la plus patente sur laquelle il m'ait été donné de trébucher.
On pourrait évidemment spéculer sous fin de savoir si les transistors auraient pu être découverts par des gens qui n'auraient pas été initiés à la mécanique ondulatoire et à la théorie des électrons dans les solides et qui n'auraient pas contribué à leur développement. Il arrive cependant que les inventeurs des transistors étaient effectivement versés dans la théorie quantique des solides et avaient contribué à son développement.
On pourrait se demander si les circuits de base des ordinateurs auraient pu être découverts par des gens dont l'objectif aurait été de fabriquer des ordinateurs. Il arrive qu'ils ont été découverts dans les années trente par des physiciens qui s'occupaient du comptage des particules nucléaires parce qu'ils étaient intéressés à la physique nucléaire.
On pourrait se demander si dans un effort pour améliorer les communications, quelqu'un aurait pu découvrir les ondes électromagnétiques. Elles n'ont pas été découvertes ainsi. Elles ont été découvertes par Hertz, qui mettait l'accent sur la beauté de la physique et fit reposer son oeuvre sur les considérations théoriques de Maxwell. Je pense qu'il serait difficile de trouver au XXe siècle un seul exemple d'une découverte qui ne serait pas ainsi tributaire de la pensée scientifique fondamentale.
B. T. Feld,16
«On Legitimizing Public-Service Science in the University»
La proportion de ceux qui étudient en sciences pures a diminué par rapport à ce qu'elle a été au cours des cinquante dernières années. Pour remédier à cette situation B.T. Feld propose à ses collègues de sortir de leur tour d'ivoire, de considérer la science comme un service public. Il cite Einstein en exemple. Au moment où il travaillait à sa théorie de la relativité, il a travaillé avec Szilard à la mise au point d'une pompe électro-magnétique destinée à empêcher l'émanation de gaz toxique dans les réfrigérateurs. Pour l'avancement dans la carrière, soutient B.T. Feld, les activités de ce genre devraient être prises en considération; les publications dans des revues savantes ne devraient pas être le seul critère.
Si l'image de la science est dangereusement ternie, c'est malheureusement pour de bonnes raisons: la découverte de la fission conduisit à la première bombe atomique; les beautés de la recherche spatiale ont cédé la place, en tant que retombées principales, aux missiles intercontinentaux et aux satellites espions... Les nouvelles possibilités pour les communications et le transport de l'énergie que le laser fit entrevoir semblent pour l'instant se limiter aux smart bombs; tout indique qu'à son apogée la révolution pavlovofreudienne dans les sciences psychologiques et comportementales consiste surtout dans des lavages de cerveau, dans l'hospitalisation forçée des dissidents et la vente plus efficace du savon. Et où donc se trouve, pourrait-on demander, le remède au cancer qui nous fut promis? Comment concilier la fameuse percée de l'agriculture, la révolution verte avec le fait que les masses meurent d'inanition en Afrique et en Asie? Seulement une partie de ce problème peut être attribuée à la surenchère prati
quée par les chercheurs universitaires et les départements de science. Dans une mesure au moins égale nous sommes aussi coupables d'omission, de non-intervention. Quoi qu'il en soit, puisque ce sont les universités qui sont à l'avant-garde de la recherche scientifique, aux U.S.A. tout au moins, elles ont une part importante de responsabilité.
Asa S. Knowles,17
«Cooperative Education: The Catalyst for Innovation and Relevance»
À l'heure actuelle, il y a aux U.S.A. 600 institutions qui offrent des programmes coopératifs ou sont sur le point de le faire. L'expression éducation coopérative désigne toute espèce de programme où ce qui est acquis en classe est complété par une expérience vécue en dehors du campus. Il faut se plier à un certain nombre d'exigences:
1. L'expérience hors campus doit être reliée d'aussi près que possible aux disciplines scolaires qui intéressent le plus l'étudiant.
2. L'emploi doit être stable.
3. L'expérience de travail doit devenir de plus en plus exigeante à mesure que l'étudiant progresse dans son programme scolaire.
Les employeurs estiment que les étudiants coopératifs sont enthousiastes et curieux intellectuellement. À cause de l'alternance travail-étude, les institutions qui ont fait de l'éducation coopérative une vocation peuvent mettre leurs ressources à la disposition d'un nombre d'étudiants dépassant de 75 à 800/. le chiffre habituel.
L'éducation coopérative rend l'enseignement stipérieur plus facilement accessible aux représentants des minorités et aux personnes défavorisées sur le plan économique; elle leur permet d'avoir de l'avancement dans leur carrière; pendant leurs années d'études, elle diminue leur dépendance à l'égard des prêts et bourses du gouvernement.
Lewis M.Branscomb et Paul C. Gilmore,18
«Education in Private Industry»
Selon ces auteurs, l'industrie a surtout besoin de sophistes, mais elle ne saurait se passer d'un certain nombre de disciples de Socrate. On sait que les sophistes prétendaient que l'éducateur avait pour tâche d'anticiper l'avenir le plus adéquatement possible et de former les jeunes de telle sorte qu'ils puissent réussir dans cet avenir anticipé.
Doutant de tout et d'abord des conjectures sur l'avenir, Socrate recherchait l'universel, c'est-à-dire un bien pouvant conserver sa valeur dans toutes les conditions. C'est ce que soutient Robert Mclintock dans le commentaire qu'il a consacré à l'ouvrage de Toffler, Learning for Tomorrow, Branscomb et Gilmore s'inspirent de ce commentaire. Ils prétendent que les grandes corporations ont suffisamment confiance en leur faculté d'anticipation pour adopter une attitude carrément sophistique. Les sophistes à leur avis peuvent être formés dans et par la corporation. Quant aux quelques disciples de Socrate dont les corporations ont besoin pour faire face aux imprévus, ils doivent évidemment être formés en dehors de la corporation.
En 1969, IBM avait à son service 3417 professeurs, les uns à temps plein, les autres à temps partiel. Dans les compagnies comme Xerox et Bell, les services éducatifs sont aussi très importants. Chez Bell, les étudiants qui préparent une maîtrise, en relation avec une université, sont assez motivés: leur succès est la condition de leur réengagement.
Nous avons voulu mettre l'accent sur le fait qu'un intérêt économique fondamental force l'industrie àavoir son propre système d'éducation et d'apprentissage de même qu'à utiliser les ressources de la communauté universitaire.
Le même intérêt économique entraîne une expérience opérationnelle sur une large échelle, avec une variété de méthodes et d'outils qui permettent la mise au point de modèles tout à fait différents de ceux qu'on trouve dans les maisons d'enseignement. Il se peut que cet intérêt économique ne soit pas partagé par les maisons d'enseignement, mais ces dernières vont sûrement être influencées par ses conséquences. Si d'une façon ou d'une autre nos maisons d'enseignement participent activement à l'orientation de l'évolution de l'éducation, sous toutes ses formes, alors les conséquences en question seront bénéfiques pour l'ensemble de la société.
B. F. Skinner,19
«Designing Higher Education»
«La principale fonction de l'éducation c'est de transmettre la culture, d'amener les nouveaux membres d'un groupe à profiter de ce que d'autres ont déjà appris. Il s'ensuit que le principal devoir d'un étudiant c'est d'apprendre ce que les autres savent déjà».
Voilà, dit Skinner, une assertion contestée. Dans l'éducation actuelle, il y a tout un courant qui refuse cette transmission de la culture comme une façon pour le professeur d'imprimer dans l'élève ses propres valeurs, agissant ainsi à l'encontre de sa liberté et de sa dignité. On exige du professeur un autre mode de relation que la transmission de ce qu'il sait.
Si on veut faire la preuve quantifiable de cet autre type d'enseignement, essentiellement basé sur le développement personnel de l'élève, on nous dira que ses résultats ne sont pas mesurables. Seule la transmission des connaissances est mesurable. Mais on ne peut mesurer les changements survenus dans l'élève, lesquels sont qualitatifs.
Les pédagogies qui ont remplacé la transmission de la culture ont aussi des effets inattendus qui ne prêchent pas en faveur des méthodes adoptées:
- l'élève qui, depuis le jardin d enfance jusqu'au secondaire, a été poussé à n'utiliser que ses pouvoirs créateurs peut avoir une idée exagérée de ses capacités et de ses connaissances;
- si on fait fi de la tradition, les efforts de création partent de zéro et les oeuvres d'art qui en résultent sont nécessairement primitives.
- l'élève coupé des découvertes techniques à travers les âges risque fort d'être sans défense en face des superstitions et des idéologies qui ne tiennent compte ni de la logique ni du bon sens.
- enfin, beaucoup de pratiques culturelles avaient un sens dans leur relation avec l'avenir. L'étudiant acquérait par elles des comportements dont les effets se faisaient sentir dans un avenir même lointain. En enfermant l'élève dans des sujets purement actuels et immédiats, on en fait, au sens le plus strict du mot, un existentialiste.
Bien sûr, poursuit l'auteur, quelle que soit la pédagogie adoptée, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, transmission de culture. Pourtant, beaucoup de philosophes de l'éducation minimisent cette transmission pour des raisons qui ont peu à voir avec l'éducation.
Il y a rarement rencontre, note Skinner, entre un bon professeur et un bon élève. Le plus souvent, des professeurs ordinaires ont de bons élèves et des élèves ordinaires n'ont pas de bons professeurs. C'est pour pallier cette lacune qu'il faut établir des programmes éducatifs efficaces.
Mais pourquoi enseigner et pourquoi apprendre? Il fut un temps où l'éducation était punitive et coercitive. Elle permettait à l'étudiant d'accéder à l'université, mais la motivation dominante pour s'instruire était la peur des punitions. Cela n'est plus justifiable dans une société démocratique. D'autre part, poursuit l'auteur, ce sont les professeurs qui ont eux-mêmes rejeté le fouet et redonné la liberté de choisir à l'étudiant.
Seulement, comment s'y retrouver, seul au milieu de l'extrême variété du monde environnant? En limitant la transmission de la culture, on limite aussi la portée du contact avec le monde réel. Car, souligne Skinner, il est rarissime que des oeuvres remarquables soient le produit d'un développement purement personnel. Laissé à lui-même, l'étudiant risque de ne s'intéresser qu'aux événements d'actualité dont la portée est inutile ou sans intérêt réel. Donc en même temps qu'il faut abandonner les méthodes punitives, il faut poursuivre la transmission de la culture. «Et les découvertes récentes dans la compréhension du comportement humain fournissent non seulement les moyens mais aussi la confiance nécessaire pour faire des changements significatifs».
Le comportement, on a tendance à l'oublier, est modifié par les conséquences qui en découlent. Skinner est d'avis qu'on peut renforcer le comportement de l'élève en soulignant de façon marquante les conséquences liées à ce comportement. Par exemple, le fait de lire peut être renforcé par l'intérêt même que présente le livre, par les bonnes notes attachées à la compréhension de ce livre. Mais les renforcements peuvent être encore plus positifs, plus évidemment reliés àl'acte posé. C'est le progrès lui-même qui devrait être rendu évident. Les élèves peuvent être amenés à lire grâce àun genre de renforcement qui leur prouve que les conséquences de leur lecture sont immédiates et clairement circonscrites.
Cela implique que:
- l'étudiant progresse à son propre rythme. Ce principe peut être appliqué au primaire autant qu'au secondaire;
- qu'il réponde à l'information donnée de façon à ce que ses réponses puissent être évaluées et, si elles sont adéquates, être renforcées;
- qu'il évolue de telle sorte que ce qu'il vient d'apprendre soit une étape nécessaire pour franchir l'étape suivante. Le renforcement a un effet maximal si l'étape a été parfaitement maîtrisée.
Certains lecteurs, poursuit Skinner, sont rebelles à ce genre de conditionnement, mais les résultats prouvent qu'il est possible d'amener les étudiants à étudier à la fois énergiquement et avec plaisir et qu'ils ont moins tendance à fuir l'éducation par l'inattention aux cours ou carrément par l'abandon des études.
L'auteur se réfère au Personalized Systern Instruction conçu par Fred S. Keller dans le domaine de l'éducation supérieure, comme à une méthode très efficace de renforcement qui peut résoudre le fameux problème de la motivation dans les études universitaires. Skinner dénonce les méthodes visant à ne développer que la curiosité naturelle, la créativité et l'imagination chez l'étudiant. Les gens ne sont ni éthiques, ni moraux de nature et le deviennent naturellement encore moins.
Il faut donc accepter qu'une culture impose son code moral et éthique à ses membres et qu'en transmettant une culture, une éducation impose aux étudiants ce qui a été appris par d'autres. Cela implique qu'on délimite à l'avance un programme d'études. Car l'étudiant n'est pas en mesure de savoir ce qui lui sera utile.
Ceux qui laissent les étudiants décider eux-mêmes ce qu'ils vont étudier, et abandonnent l'enseignement aux environnements sociaux, physiques et académiques, abdiquent essentiellement leur rôle de professeurs. lis trahissent les étudiants qui ont déjà le souci de leur avenir et manquent à leur devoir àl'égard de ceux qui n'ont jamais eu de raison de s'en soucier. Il est possible que l'éducation endosse un jour la responsabilité des millions de jeunes gens qui sont non seulement mal préparés pour l'avenir mais qui ne sont même pas sûrs d'en avoir un.