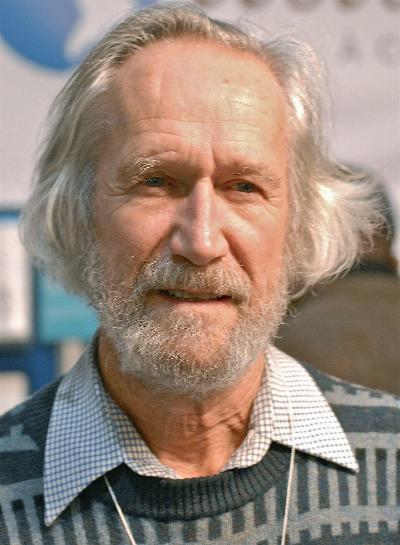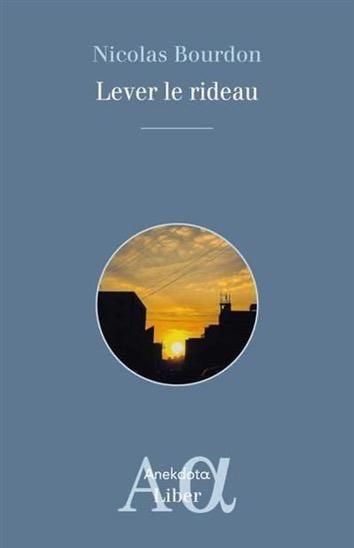L'architecture ou le bon usage de l'énergie
Je tiens pour acquis que le lecteur me donnera raison si j’affirme que le Parthénon, la cathédrale de Chartres, l’Alhambra de Grenade, le village de La Roque sur Cèze sont des chefs d’œuvre de l’architecture. Les touristes qui visitent Montréal pensent la même chose de notre stade olympique.
À l’exception du village, ces monuments ont en commun d’être pharaoniques et sans doute aussi d’avoir été l’occasion de quelques scandales qui ont mécontenté la population locale, comme ce fut le cas à Montréal. Mais le temps qui passe efface ces mauvais souvenirs et met en relief la valeur, à tous égards, des monuments en cause. Les bienfaits de tous genres que la cathédrale de Chartres a apportés à cette petite ville, puis à la France et à l’humanité entières sont inestimables.
Justifient-ils les efforts fait par la population de Chartres au moment de la construction ? N’aurait-il pas été préférable que l’on consacre plus d’argent à la lutte contre les maladies et la pauvreté des Chartrains ? C’est ce que répondraient sans doute les Québécois d’aujourd’hui et ils construiraient force grands hôpitaux uniquement fonctionnels.
Faut-il attendre d’avoir satisfait les besoins primaires des populations pour leur offrir un peu de ce luxe noble qu’on appelle beauté ? Si on s’en était tenu à cette règle, il n’y aurait pas eu de civilisations mais il faut aussi reconnaître qu’un minimum de richesse est nécessaire. Au temps des cathédrales, la France tirait profit de progrès récents en agriculture. Où est le point d’équilibre ? Chacun aura son opinion.
Reste un fait. Les hommes construisaient en beauté pour l’éternité alors que la terre n’était pour eux qu’un lieu de passage, une vallée de larmes. Et alors que la terre est notre demeure unique et définitive, nous réussissons, par un usage inconsidéré de l’énergie, l’exploit de mettre la planète en péril pour construire de la laideur éphémère.
Tout en formulant ce constat de façon originale, René Dubos a proposé un modèle aussi bien pour l’architecture que pour l’écologie de l’avenir.
« Maintenant le cas de l’architecture : jusqu'à il y a cinquante ans, (nous sommes en 1976) dans le monde entier, bâtisseurs et architectes avaient l'habitude d'adapter leurs constructions aux contraintes locales. La forme du toit, l'épaisseur des murs, la forme des fenêtres, l'orientation de la maison, l'ensemble, tout cela était déterminé par la neige, les précipitations, les vents, la température, etc... Par leur connaissance de ces contraintes essentielles imposées par l'environnement, les architectes des anciennes populations - et en l'occurrence populations simples - avaient développé partout une architecture locale qui, pour répondre à la question de Dean Morton, était d'une immense diversité et possédait un grand charme, et dont la consommation en énergie était peu coûteuse. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient parfaire leurs connaissances dans ce domaine, devraient lire « Architecture Without Architects », qui montre comment les gens pendant des générations possédaient le sens d'une construction qui correspondait aux conditions naturelles. Eh bien, pendant les cinquante dernières années, comme je l'ai dit nous avons introduit dans nos constructions des processus énergétiques afin d'éviter d'avoir à respecter ces contraintes. Nous sommes devenus si insouciants dans notre utilisation de l'énergie que nous surchauffons nos bâtiments pendant l'hiver et que nous les sur rafraîchissons pendant l'été. Tout ceci provient de ce type anonyme d'architecture qui défigure toutes nos villes dans le monde entier. Je suis persuadé que si nous devenions plus économiques, plus raisonnables, dans notre utilisation de l'énergie, une fois de plus nous pourrions conférer à l'architecture cette forme de qualité qui correspondrait aux conditions locales. » Source