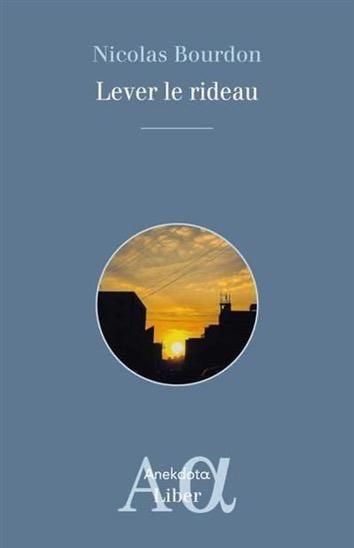Wagner et nous
D'après l'auteur, Wagner, « Fichte sonore », « partie intégrante des intentions conquérantes et absorbantes de l'impérialisme allemand », « a frayé la voie aux armées ». C'est l'exactitude même. Dire que la vogue en France du fameux Ton-Dichter « a pris naissance d'abord dans les milieux scientifiques, dans les salles de garde des hôpitaux, etc. », est assez contestable, quant à la priorité que signale l'ancien étudiant en médecine qu'est M. Léon Daudet. Cette réserve faite, le témoignage de M. Daudet est précieux à connaître :
Pour comprendre cet enthousiasme, il faut se rendre compte de la dépression morale des grands garçons de vingt à vingt-cinq ans, surmenés par les concours, passant leur matinée à l'hôpital, leur après-midi dans les laboratoires et les bibliothèques et opprimés par l'ambiance du plat réalisme, d'un « naturalisme » extrêmement grossier, ou d'un agnosticisme à la Renan qui, lui aussi, faisait fureur. Avec ce manque de choix qui caractérise, en général, les très jeunes gens, nous étions en quête d'un idéal, d'une fenêtre qui ne donnât pas sur un chantier, ou sur une doctrine désespérante ou morne, ou sur un doute. Wagner était là, avec ses histoires embrouillées d'or du Rhin pris et repris, de nains, de géants, de vierges guerrières, de héros purs, de « par pitié sachant », - durch mitleih wissens -, et cette mythologie de fer-blanc qui, aujourd'hui, nous fait sourire. On se jeta avidement sur sa symbolique.
On analysa ses intentions morales et amorales, on scruta finement sa mystique. Que de fois, au lit des malades, dans ce jour gris d'hiver qui tombe maussadement des fenêtres des hôpitaux, à la salle d'opérations, autour des microscopes en batterie, j'ai entendu fredonner le thème du feu, celui de l'épée, celui du sommeil, celui du destin, courtes évasions vers le rêve, hors du réel immédiat et brutal. Dès que nos conversations d'étudiants s'élevaient au-dessus du terre-à-terre quotidien, ou du professionnel, ou des brigues et intrigues de Faculté, le nom de Wagner reparaissait. Le jeudi soir, accouraient chez mon père une vingtaine de mes compagnons d'études, totalement étrangers à la littérature, mais désireux de rencontrer là des musiciens ayant connu le maître de Wanhfried, des poètes comme Mendès, ou des correspondants de journaux allemands ayant été admis dans son intimité. On les harcelait de questions, on ne se rassasiait pas d'entendre de leur bouche comment il s'habillait, comment il riait, comment il parlait, comment il grimpait aux arbres ou imitait le chien furibond pour fuir les importuns. Je me rappelle le mot d'un de mes amis, aujourd'hui médecin célèbre, devant le convoi de Victor Hugo à travers Paris: «Qu'est-ce que ce Hugo à côté de Wagner?... Un moustique! » Un autre disait: « Wagner est le premier des embryologistes et des ethnographes de tous les temps. Son oeuvre a un goût de genèse. Elle est un pont entre la science et l'art. »