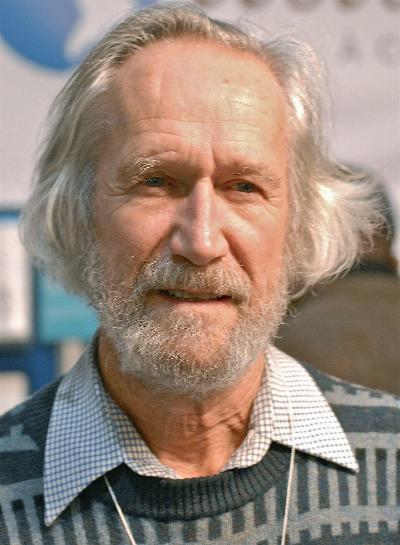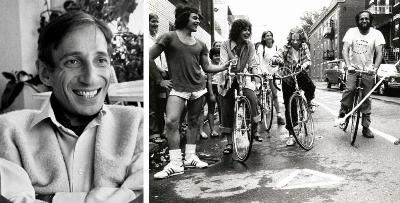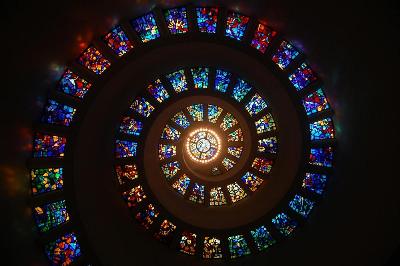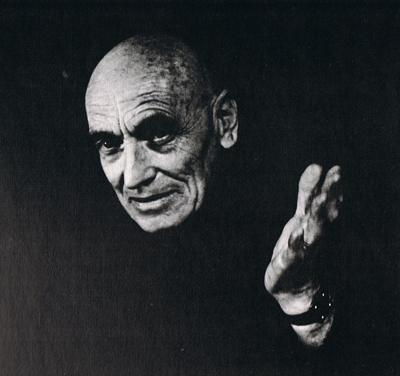Les trois Nixon contre les trois Brejnev ou la guerre jouée
On se plaît à imaginer la suite. Messieurs Nixon et Brejnev s'inspireraient de la tradition du duel et prendraient exemple sur l'époque où le roi d'Angleterre faisait une guerre propre à son cousin le roi de France. Au lieu de faire de la guerre le mal absolu pour ensuite, en se retournant, en rejeter tout le fardeau sur des peuples innocents, ils la considéreraient comme la règle ultime du jeu politique. Chaque fois que leurs négociations au sujet du partage d'une colonie aboutiraient à une impasse, ils ouvriraient officiellement les hostilités et s'entendraient sur le choix du terrain, des armes et des troupes. Le terrain serait de préférence une zone inhabitée située sur leurs territoires; les armes seraient conventionnelles; les combattants seraient des volontaires ayant suffisamment de privilèges pour assurer la sécurité de leur famille.
On croit rêver. On rêve en fait. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un vague projet d'avenir, mais d'une remémoration. Les cités grecques et les nations chrétiennes nous ont laissé de nombreux exemples de guerres réglementées. Comment expliquer qu'on semble avoir perdu jusqu'au souvenir de ces guerres ? Nous sommes dans une civilisation où le réel dépasse la fiction. Comment comprendre que dans une telle civilisation le possible soit devenu rêve ? Où se cache parmi toutes nos sciences cette raison qui triomphait parfois, parce qu'elle n'avait aucune illusion sur elle-même, ce bon sens qui faisait dire à Lord Acton : «Le meilleur moyen de faire de la terre un enfer, c'est de vouloir en faire un paradis» ?