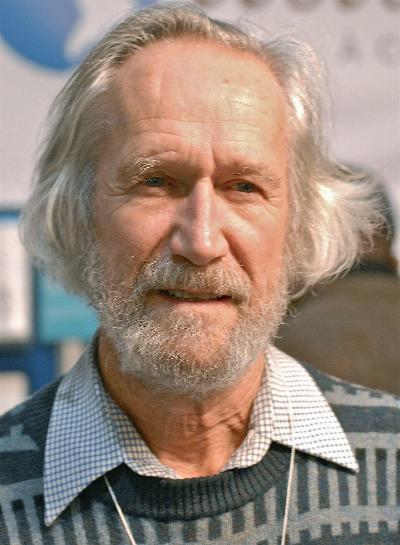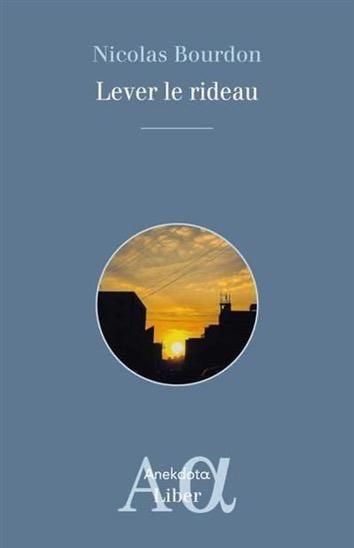Gestion par comité
Un expert en la matière, M. Banton, de l'INRS-Eau, semble favoriser des solutions de ce genre quand il soutient que la gestion de l'eau doit se faire au niveau des bassins versants, comme dans le cas de Valence. Renvoyant dos à dos la nationalisation de l'eau et la privatisation totale, il propose une solution intermédiaire qu'il appelle la gestion par comité: «La gestion par comité, qui est par ailleurs actuellement étudiée pour les eaux superficielles dans différents bassins versants du Québec, semble en fait la meilleure option de gestion, puisqu'elle allie à la fois l'implication de tous les usagers publics, institutionnels et industriels, l'existence d'un pouvoir autonome pour la gestion, et le renforcement de la décision régionale en matière de priorité de développement économique. [?] Dans ce mode de gestion, le gouvernement et son représentant, le ministère de l'Environnement joueraient des rôles d'observateurs et d'appuis à la requête des comités.»
Hélas! Ce modèle est trop élégant pour ne pas cacher les pièges qu'il faut à tout prix éviter. Monsieur Banton indique bien le camp auquel il appartient, quand il donne à entendre au début de sa conférence que de l'eau souterraine il y en a en surabondance au Québec. Comment expliquer qu'un chercheur aussi écouté omette d'évoquer la question de la qualité variable de cette eau?
Et qu'est-ce qu'un gouvernement qui se limite au rôle d'observateur? Si la chose était seulement possible, ce dont il est permis de douter, serait-elle souhaitable? La solution de monsieur Banton, une fois dissipée la vapeur démocratique sous laquelle elle se présente, consiste en réalité à donner le pouvoir aux experts, et par leur intermédiaire, aux grandes entreprises capables de retenir leurs services, en alternance avec les gouvernements et les centres de recherche eux-mêmes, en partie subventionnés par les entreprises privées, telles Danone pour les eaux en bouteille ou La Lyonnaise des eaux pour la gestion des eaux municipales.
Les expériences récentes de Franklin (voir l'article de Lise Dolbec) de Barnston-Ouest (voir l'article de Louise Doucet) et de Mirabel (voir l'article de Gilles Verrier) montrent clairement que des comités locaux ne sont absolument pas en mesure de négocier avec des groupes puissants.
Dans le cadre d'une politique de développement durable, rompant le lien entre la propriété du sol et la propriété de l'eau, et affirmant clairement que l'eau est un bien commun de l'humanité dont les nations ont la gestion déléguée, le gouvernement devrait offrir aux collectivités locales et régionales tout le soutien dont elles ont besoin pour défendre efficacement leurs intérêts et leurs principes.
En attendant qu'une telle politique soit établie, le gouvernement du Québec doit reconduire le moratoire, comme le Fédéral l'a d'ailleurs invité à le faire.