Lorsque Montréal parlait
Cet article a paru en 1977, dans le numéro 17 de la revue Critère. Pierre Vadeboncoeur y évoque le Montréal des décennies 1930 et 1940.
Il y a quelque quarante ans, Montréal avait encore une certaine atmosphère et un certain visage, aujourd'hui bien dégradés. La ville semblait parvenue à sa taille adulte; elle paraissait ne plus devoir grandir beaucoup mais seule-ment gagner en qualité, dans un esprit qui serait resté le même. On n'observait pas encore dans les choses le dynamisme chaotique qui les travaille aujourd'hui et dont on n'était pas averti à cette époque, car la réflexion futuriste est récente.
Montréal était une grande ville, mais par ses dimensions plutôt que par l'ambiance de ses quartiers, où la vie de l'ancien temps continuait tant bien que mal: la vie de l'ancien temps, ses rapports, sa cadence et certaines formes socio¬logiques transmises par héritage.
Lieu d'établissement des familles
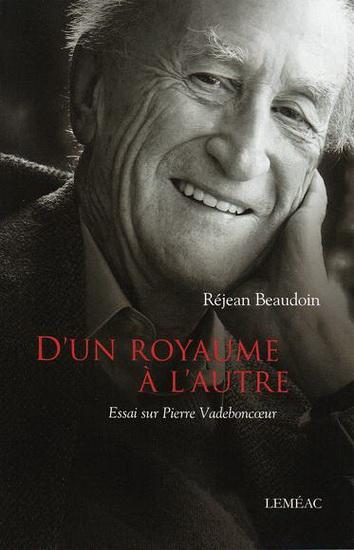 Par exemple, ce qui me frappe rétrospectivement le plus quand je repense à cet ancien Montréal, c'est d'y voir un gigantesque lieu d'établissement des familles. La famille était encore assez intacte, avec ses habitudes, ses valeurs, ses principes, sa force d'attraction, ainsi qu'avec le don qu'elle avait d'étendre tout autour d'elle une sorte de tissu social qui était à sa ressemblance et qui constituait peut être alors la fondamentale réalité culturelle de Montréal. On s'étonnait de découvrir dans le roman français, Zola par exemple au sujet de Paris, des tableaux de moeurs urbaines jurant avec nos traditions ancestrales, car celles ci subsistaient, elles étaient fortes et façonnaient les mentali¬tés. Dans l'image que nous nous faisions de la ville, il n'y avait pas trop de discontinuité avec la campagne, ni rupture entre les conceptions du passé et celles du présent. Peut être la ville de Montréal, à mi chemin de sa croissance, était elle culturellement singulière, je ne sais, plus innocente que bien d'autres, peu évoluée, davantage faite de bonnes gens encore imbus d'un humanisme lui même pétri de religion et habitués depuis des siècles à la sévérité des moeurs et à la frugalité.
Par exemple, ce qui me frappe rétrospectivement le plus quand je repense à cet ancien Montréal, c'est d'y voir un gigantesque lieu d'établissement des familles. La famille était encore assez intacte, avec ses habitudes, ses valeurs, ses principes, sa force d'attraction, ainsi qu'avec le don qu'elle avait d'étendre tout autour d'elle une sorte de tissu social qui était à sa ressemblance et qui constituait peut être alors la fondamentale réalité culturelle de Montréal. On s'étonnait de découvrir dans le roman français, Zola par exemple au sujet de Paris, des tableaux de moeurs urbaines jurant avec nos traditions ancestrales, car celles ci subsistaient, elles étaient fortes et façonnaient les mentali¬tés. Dans l'image que nous nous faisions de la ville, il n'y avait pas trop de discontinuité avec la campagne, ni rupture entre les conceptions du passé et celles du présent. Peut être la ville de Montréal, à mi chemin de sa croissance, était elle culturellement singulière, je ne sais, plus innocente que bien d'autres, peu évoluée, davantage faite de bonnes gens encore imbus d'un humanisme lui même pétri de religion et habitués depuis des siècles à la sévérité des moeurs et à la frugalité.
Je m'illusionne peut être, mais il me semble que tel était le climat que nous respirions. J'étais bien jeune alors et moi même tout enveloppé du passé. Ma représentation de la ville devait en être influencée, mais pas au point, je crois, où j'aurais pu me tromper tout à fait sur ce que Montréal était réellement. Il y a d'ailleurs des recoupements: on a dit depuis que notre ville était un grand village et, à mon souvenir, c'était loin d'être faux. Le maire était tout proche, un phénomène de province, un familier pittoresque; il éma¬nait des quartiers, aurait on dit: ce n'était pas un maire de mégalopolis impersonnelle, bigarrée, infectée, trépidante, louche, agressive, où le glacial anonymat, la complexité des rapports et le cosmopolitisme ont fini par isoler tout le monde de tout le monde et par plonger les habitants dans une indifférence ou une malveillance révélatrices de l'in¬tolérable dépersonnalisation du milieu.
Des logis et des quartiers
Les gens appartenaient à des familles et par conséquent ils habitaient dans ce qu'on peut appeler des logis. Montréal était constitué avant tout d'une infinité de logis, qui étaient des demeures, au sens propre, malgré les déménagements, qui ont toujours eu ici quelque chose d'un cas sociologique. La notion de logis, caractéristique d'une ville habitable et vraiment habitée, avait beaucoup d'importance dans la culture des gens. Les conditions des classes sociales étaient fort inégales, comme aujourd'hui sans doute, et peut être même celle des classes les plus défavorisées étaient elles, durant la “crise”, plus désespérantes que maintenant puis¬qu'il n'y avait pas de sécurité sociale. Mais on trouvait partout une ville d'habitations, qui pouvait encore faire penser à l'ancienne civilisation urbaine, et des quartiers véritables, qui avaient un peu d'âge et pouvaient sembler aussi durables que la ville elle même.
Ces quartiers étaient bien assis; ils occupaient leur espace non seulement en étendue mais aussi en hauteur, puisque la construction à l'américaine n'avait pas encore détruit leur ciel, de sorte qu'ils avaient non seulement une vie quotidienne assez pleine de souvenirs et de continuité mais également, à la mesure originelle des lieux, un profil physique qui suivait à peu près les accidents du terrain et la silhouette des pâtés de maisons, dominée seulement par quelques monuments comme les églises, l'ensemble ne présentant pas plus d'élévation artificielle que la popu¬lation elle même vivant sa vie dans l'ignorance des bou¬leversements qui n'allaient pourtant pas tarder à venir.
Traits d'une âme et d'un peuple
C'était avant la guerre. On avait l'impression que Montréal était encore essentiellement peuplé d'une couche familière de population, habituée à ses rues et à ses intérieurs, qui étaient comme ses possessions et comme son paysage; et elle était partie de ce paysage. Cette population, sem¬blable à elle même depuis une souche que l'imagination et un peu de souvenirs situaient dans la dernière moitié du siècle dernier, était canadienne française, tout à fait adaptée à une existence qui n'était plus celle de la terre mais non pas encore celle d'un enfer, et elle constituait un type sociologique assez doux, dont le caractère et les moeurs se mariaient très bien à l'aspect physique de la ville. Le temps, qui jusque là avait été lent et persistait à l'être, avait tranquillement mûri cette ville et ses habitants, qui étaient comme fondus ensemble et paraissaient se convenir réciproquement, et l'on pouvait aisément croire, l'on croyait effectivement, que Montréal avait définitivement établi son style, son apparence, son rythme, et ébauché les traits d'une âme qui resterait la sienne.
Cette ville, par son peuple, par ses habitudes et par son aspect général, bien que grande et déjà engagée dans le mouvement industriel, nous ressemblait. On ne regardait pas Vers l'ouest. Dans l'est, où se concentrait une grande masse de peuple qui, à cause de son nombre, faisait la ville à bien meilleur titre que la riche concession anglaise de l'ouest, Montréal avait l'aspect d'une énorme excroissance urbaine du pays québécois, bien qu'elle se fût développée en grande partie par l'initiative industrielle et commerciale des Anglais. L'histoire classique des Canadiens français ne paraissait pas s'arrêter aux limites de la cité; il n'y avait pas de césure, il y avait extension et simple changement de décor, encore que le décor lui même, si on se mettait à le regarder par l'intérieur, voire dans ses caractéristiques matérielles, ne fût pas terriblement insolite comme il l'est devenu. Nous avions débordé des campagnes dans la ville d'une manière pour ainsi dire naturelle et, jusqu'à un certain point, la ville n'avait encore pris d'accroissement et de figure que sous l'effet de ces alluvions démographiques, eût on cru. Elle s'était étendue d'autant, mais comme on bâtit pour vivre dans un lieu, non comme sous l'effet d'agents extérieurs puissants et n'ayant rien de commun avec nous. C'était une ville qui s'était faite, au petit bonheur peut être, mais selon les besoins de notre établissement, au jour le jour, et les constructions, quoique solides, étaient dénuées d'une gloire surajoutée: elle n'étaient pas ambitieuses et elles avaient notre taille, non celle d'une force étrangère et démesurée.
Un milieu de vie
De ce point de vue, les choses ont commencé de se gâter quand les entrepreneurs eurent grossi en même temps que le capital et se furent mis à construire quelque chose qui n'était plus une ville mais un gigantesque creuset d'acti¬vité économique, d'une part, et, d'autre part, à bâtir en vitesse des dizaines de milliers de boîtes à habiter pour fournir des campements à une migration qui se précipitait vers la ville et vers l'argent sonnant. C'est a peu près l'époque où, après avoir gagné pour vivre, l'on cherche plutôt à gagner pour dépenser, à partir de 1940. La culture changea en même temps, c'est évident, et ce que nous avions gardé d'atavisme paysan
disparut sous l'influence du nouvel emploi de l'argent. Le sens de la ville changea aussi, forcément, car il subit en outre l'action d'une foule d'autres facteurs, dont l'automobile, le travail des femmes, l'affaiblissement de la famille, l'accélération de la vie, la multiplication des divertissements, l'intensification des af¬faires, etc. Les parcs, la promenade, par exemple, avaient jadis une place dans l'économie de la ville, comme on le voit par des estampes anciennes; mais les divertisse¬ments étaient simples et peu nombreux, la vie lente, la besognes dont le centre était dans le lieu même où l'on habitait, et l'automobile n'existait pas. On ne se dispersait pas beaucoup. On vivait dans ce qu'on appelle un milieu. Natu¬rellement, je n'ai pas connu cette époque, mais il en restait quelque chose dans ma jeunesse. Montréal était encore agréable. La ville avait été un lieu qui par lui même présentait un cadre propice à des plaisirs. Elle était avenante. Elle respirait comme les gens, sous un ciel encore découvert, sans trop d'excitations factices, et l'on y trouvait beaucoup d'arbres et de tranquillité relative.
Poésie et harmonie toutes simples
Dans ces conditions, avant la pollution, l'excès de bruit, les automobiles ou du moins le nombre catastrophique de celles ci, avant la mécanisation des services, avant les constructions en hauteur, l'hiver tombait sur Montréal comme sur la campagne et ne s'y dénaturait pas trop. Il y avait une poésie de l'hiver montréalais, aujourd'hui complètement disparue sous la saleté. Les estampes parlent de cette poésie, également. Elles ne pourraient le faire maintenant. Mais il y a, dans ces estampes, non seulement l'image de l'hiver, mais l'illustration du plaisir que le monde y prenait dans les jeux, dans le spectacle de la neige et dans le travail en partie heureux que sa chute imposait. Par conséquent, on y voit aussi des indices probants du sens qu'avait cette manifestation de la nature pour des hommes qui sans doute accueillaient, dans la ville, l'hiver comme une beauté.
L'humain laissé à lui même prescrit sans trop le savoir des mesures à ce que nous faisons. Montréal ne s'était pas édifié d'après un plan savant, mais pendant longtemps n'en demeurera pas moins une ville qui malgré une foule de naïves laideurs possédait quant à l'ensemble et par morceaux une sorte de modeste harmonie. Celle ci était probablement faite en partie de correspondances ou de liens entre des lieux sans prétention mais chaleureux et une humanité restée simple et proche de sa vieille culture, à quoi s'ajoutaient des beautés naturelles, également douces, comme le Mont Royal, le fleuve, des terres encore cultivées aux confins des habitations mais parfois même au milieu de surfaces déjà bâties, sans parier de petites gloires pro¬vinciales ne pouvant parier qu'au coeur des Montréalais d'alors tant elles étaient peu de chose à l'échelle des grandes villes du monde: le parc Lafontaine, les grandes demeures de la rue Sherbrooke, les belles constructions à la française dont des communautés religieuses étaient propriétaires, certains monuments élevés à la mémoire de nos hommes célèbres, célèbres à nos yeux, bien entendu, la rue Saint Hubert, le parc Jeanne Mance, la Croix lumineuse, plus tard le Chalet de la montagne, et d'autres repères qui retenaient, comme une mémoire physique, un peu d'histoire ou plus simplement les souvenirs diffus de notre quotidien collectif et individuel, lequel tissait une certaine culture, avant que cette culture ne fût emportée par l'ouragan qui aujourd'hui nous projette dans un univers physique et moral méconnaissable, auquel nous n'avons nullement con¬tribué pour l'essentiel.
Ce qui s'est rompu, à Montréal, c'est un certain rapport, de peu d'éclat mais authentique et spirituellement vital, entre un peuple et une époque historique, maintenant révolue, qui convenait tout autant à ce qu'il était intérieurement qu'au rythme d'évolution qu'il aurait connu s'il avait pu changer selon ses seules dispositions. Ce peuple et la ville qui l'abritait étaient en juste proportion l'un avec l'autre et cette proportion ne laissait pas d'être sensible. Montréal respirait une certaine quiétude, peut être née de cet accord. Il disait ce que nous étions, pour tout ce qui ne regardait pas les grandes affaires, lesquelles appartenaient aux Anglais et exprimaient leur incessante volonté d'entreprendre. Même l'illusion que l'histoire stagnait transparaissait ici. Nous sommes un peuple assez modeste pour être sympa¬thique; Montréal était sympathique. Ce peuple, sorti de ses terres et transposé dans l'histoire, ignorait encore celle-ci et s'installait à demeure, pour une durée sans histoire. Nous avions imprimé notre modération dans les lieux et pour cette raison Montréal n'avait pas une allure de méga-lopole américaine comme c'est le cas présentement.
Une ville dévastée par le profit
En une quarantaine d'années, les grandes forces économiques modernes, dévoreuses de tout, avalant le capital physique et le capital d'humanité, hypothéquant l'avenir en le faisant, gaspilleuses de toutes les réserves morales et matérielles, ont dévasté la ville de notre habitation, transformée en place forte, en place provisoirement forte, de la folie des échanges et de l'occupation par les guerriers de la finance, en même temps qu'elles bouleversaient aussi, comme partout dans le monde, des façons de vivre et de voir, la composition de la population, notre caractère, nos repères, notre équilibre de peuple.
Il est assez naïf de penser qu'une philosophie quelconque de la ville puisse avoir beaucoup d'influence au milieu d'un tel champ de bataille et jusqu'à ce que, faute de ressources, les conquérants finissent par se modérer à leur tour, ce qui n'est pas pour tout de suite. On pouvait parler de la ville quand il y avait des villes, mais qu'est ce qu'un tel propos lorsque les villes sont devenues des machines à production de guerre économique, aux mains des généraux de la schizophrénie suicidaire capitaliste? Les villes alors sont utilisées à fond, et uniquement comme des bases de plus en plus puissantes d'opération. Que viennent faire l'esthétique et l'humanisme dans ce chaos, ou, pour mieux dire, que peuvent ils? On voudrait civiliser la ville, mais justement la ville, dans le mouvement de cette guerre et dans l'esprit des maîtres de l'économie dévorante, n'existe pas. Ceux ci s'aménagent des sanctuaires pour leur repos, mais ces retraites n'ont rien à voir avec la ville, qui est une fournaise, une superficie industrielle sur laquelle on met en place, selon une rationalité tout utilitai¬re, fortement anarchique d'ailleurs et à courte vue, immeu¬bles monstrueux, passages rapides, signaux du diable, tuyau¬terie et accessoires, sans parier des cabanes érigées en hau¬teur ou en rangées, pour l'efficacité immédiate du plan de chaque surexcité haletant après une piastre. Les grandes villes actuelles, en particulier celles qui ont pris leur essor depuis cinquante ans, ne sont pas des villes dont on pourrait dire qu'elles sont modernes comme s'il s'agissait là d'un caractère ayant un sens, car qu'est ce que la modernité? La modernité peut être n'importe quoi, de bon ou de mauvais, comme l'existence elle même. Moderne, cela ne veut rien dire. Ce qu'il faut observer de Montréal, ce n'est pas que c'est une ville moderne; c'est une ville assaillie, bombardée, labourée, violentée par le capitalisme. Une ville est toujours une résultante et nous avons ici cette résultante. Le capita¬lisme se lit dans l'horreur de la ville; le capitalisme, mais aussi tout socialisme qui, dans sa philosophie du déve¬loppement, prendrait inconsciemment le capitalisme pour modèle, par l'effet de la concurrence ou autrement, par bêtise ou déspiritualisation.
Une lutte pour aujourd'hui et pour demain
Ne croyez pas que des discours d'intellectuels ou même d'artistes auront quelque pouvoir à l'encontre d'une force ainsi déchaînée, si ce n'est pour un avenir situé dans un temps où l'humanité, peut être, se sera ressaisie, ou encore pour obtenir gain de cause sur des détails: sauvegarder des espaces verts, arrêter une construction d'autoroute, épargner quelques belles choses, réduire l'automobilisme, stimuler un peu la conscience civique, etc. Cela est très nécessaire, sans doute. “Sauvons Montréal”. Il ne faut jamais négliger le détail actuel pour un ensemble lointain et problématique. C'est certain. D'ailleurs, il faut toujours, pour l'avenir comme pour le jour même, rompre des lances et lutter dans le présent pour le présent, et cela est une maxime d'action. Néanmoins, il faut bien s'en convaincre, l'urbanisme a relativement peu à voir dans une problématique générale où la destruction, réalisée en construisant tout autant qu'en démolissant, est de rigueur et où les fins terrestres de l'homme sont, pour l'essentiel, aux yeux des entrepreneurs, réduites à un seul projet urbain, qui est de faire servir la ville, le plus vite possible, le plus exclusive¬ment possible, à la production, à la transformation, au transport et à l'écoulement des marchandises, pour la ré¬compense du coffre fort qui est à une des extrémités du processus. Aussi faut il préparer le jour hypothétique où l'homme en sera réduit, par la force des choses, à essayer de voir plus loin que le bout de son nez. La philosophie et les actions auront eu, alors, une essentielle utilité. En atten-dant, il faut tout de même respirer et il n'est pas vain de tout faire pour aménager l'espace le moins mal possible.