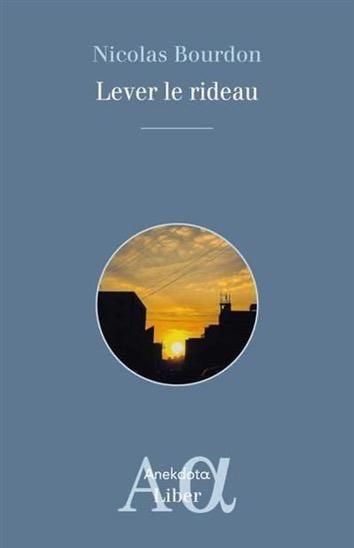La sensibilité de Jules Laforgue
Il est de ceux dont il n'a pas été ridicule de recueillir les œuvres complètes. Il est vrai qu'elles tiennent en trois volumes. Comme il aimait à écrire, s'il eût vécu, ces trois volumes se seraient beaucoup multipliés, et ses contemporains eux-mêmes, en cette année présente, où il aurait quarante-quatre ans y auraient déjà, depuis longtemps, fait un choix sévère. Nous écrivons trop; l'exercice de la pensée est devenu trop facile. Laforgue était enclin à suivre sa facilité : les dieux ont peut-être été cléments pour lui.
Son intelligence était très vive, mais liée étroitement à sa sensibilité. Toutes les intelligences originales sont ainsi faites; elles sont l'expression, la floraison d'une physiologie. Mais à force de vivre, on acquiert la faculté de dissocier son intelligence de sa sensibilité. Cela arrive, tôt ou tard, par l'acquisition d'une faculté nouvelle, indispensable quoique dangereuse, le scepticisme. Laforgue est mort avant d'avoir atteint cette étape.
Plein de bonne volonté, comme ses vers, qui souvent n'ont pas beaucoup d'autres mérites, il cherchait à se libérer de son jeune sentimentalisme. Comme outil, il employait l'ironie ; mais le sentimentalisme résistait et il ne put jamais le vaincre. Au moment où il commençait à entrevoir l'avènement du scepticisme, une rencontre fortuite vint le rejeter parmi le monde des sentiments simples. Lui-même a raconté son aventure. C'est un conte délicieux, auquel la vérité ajoute un certain agrément, mais qui s'en passerait. On le trouvera tout au long dans une des lettres qu'il adressait de Berlin à sa sœur (1). A beaucoup de jeunes gens, cette lettre paraîtrait un enfantillage ; peu de jeunes filles, au contraire la liront sans émotion ; et les hommes qui ont passé l'âge où le sentiment s'exprime avec une telle ingénuité regretteront de n'être plus capables d'une telle candeur.
«T'ai-je parlé cet hiver d'une jeune Anglaise, avec qui j'avais pris quelques leçons de prononciation ? Eh bien c'est avant-hier au soir que je me suis déclaré et qu'elle a dit oui, et que nous nous sommes fiancés. Depuis avant-hier, ma vie ne m'appartient plus seul, et je sens toute la grandeur de cette idée... je ne l'ai pas encore embrassée ; hier j'étais assis près d'elle en voiture, dans la soirée, et en la regardant l'idée m'est venue que je pourrais caresser ses cheveux, –– j'en ai eu le vertige...»
L'amour, du premier coup, a vaincu l'ironie. L'oiseau moqueur des Moralités légendaires est redevenu le touchant petit oiseau bleu. Le conte finit par un mariage, délicieuses noces de deux poitrinaires qui devaient bientôt mourir et buvaient avec ardeur à la source qui allait tarir.
Avant cette crise des plus normales et subie avec tant de joie, Laforgue avait beaucoup rêvé aux femmes et à l'amour, ce qui est toujours fort naturel. Son opinion préventive sur les femmes différait-elle sensiblement de celle que devait lui donner Miss Leah Lee ?
Il disait dans ses Aphorismes et Réflexions :
«Au fond la femme est un être usuel.
«Les femmes, ces êtres médiocres et magiques.
«Une femme aimée qui a la consolation et la distraction d'une magnifique chevelure à soigner est par cela même moins encombrante dans notre vie.
«Les femmes me font souvent l'effet de bébés, de bébés importants, monstrueusement développés.
«La vie a beau être réaliste et train-train, l'argument irrésistible, mais absolument irrésistible pour vaincre une femme, c'est la menace du suicide. Méditez-ça, c'est magnifique!»
Mais il écrivait aussi de menues choses de tendresse toutes pareilles à celles dont est remplie la lettre où il annonce ses fiançailles : «Écarter, caresser ces fins cheveux blonds ... est-ce possible! La nature n'en tressaillera pas? Ça pourrait-il arriver?» Otez l'ironie qui est très sensible surtout dans la fin du paragraphe, que je n'ai pas cité, et c'est la même attitude d'adoration devant le mystère de la pureté virginale. La jeune fille (il s'intéresse surtout aux jeunes filles) est pour lui un être presque surnaturel; il la voit, comme Dante et ses contemporains, dans un rayonnement, dans une atmosphère céleste qui l'isole du monde vulgaire. Mais tout de même ce qui domine dans ces premières notes, c'est l'ironie. Il se moque ou fait semblant de se moquer. Il est peut-être dupe, au fond, mais il ne veut pas le paraître, même à lui-même. A partir de ses fiançailles, ses idées changent; c'est-à-dire elles se résolvent en sentiment. L'ironiste est devenu amoureux. Toute la partie des pensées intitulée Impressions se rapporte évidemment à cette période, quoique l'éditeur l'ait intercalée entre deux chapitres qui sont l'un et l'autre antérieurs. Ces Impressions ne sont plus des pensées «sur la femme», comme le dit un titre général. Avec l'impudeur des écrivains qui font de l'écriture avec tout ce qu'il y a de plus intime dans leur vie, c'est de sa femme à lui que Laforgue nous entretient. Et c'est un hymne :
«Comme elle est pure, absolue, à part ! –– Je l'aime comme la vie. J'oublierais la vie pour elle, ses mains dans les miennes?»
Il est vaincu, et il n'aura pas le temps de se reconquérir.
L'intelligence était d'une belle qualité dans Laforgue; il se serait reconquis, si une longue vie lui avait été donnée. Son ironie serait allée très loin. Il y avait dans ce jeune homme de génie, l'étoffe, peut-être, d'un Jonathan Swift; mais d'un Swift tempéré par le sentiment et par la poésie. Toute sa vie, même si elle avait été très longue, Laforgue l'eût passée à surveiller la lutte perpétuelle qui se livrait en lui entre l'intelligence et la sensibilité, et cela nous eût donné les plus belles œuvres, les plus vivantes.
Il reste de lui les Moralités légendaires, quelques vers, quelques lettres, quelques pensées, et ce sont les assises d'un palais à peine sorti des fondations, mais assez visible déjà pour témoigner du génie de l'architecte. Laforgue manque à notre littérature d'aujourd'hui où il compte tant d'amis, où il aurait eu bien peu d'égaux et où personne ne représente cette extraordinaire ironie sentimentale dont il est le seul maître.
(1) Mélanges posthumes. Paris, Société du Mercure de France.