L'Agora - Textes récents
-
Vient de paraître
Lever le rideau, de Nicolas Bourdon, chez Liber
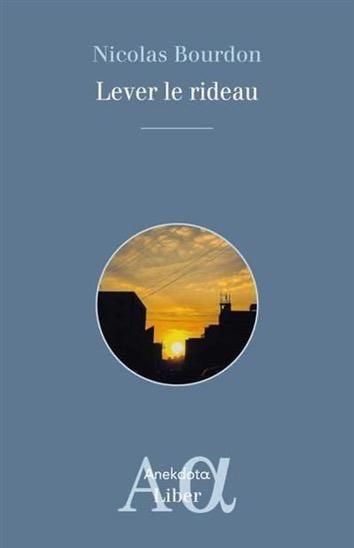 Notre collaborateur, Nicolas Bourdon, vient de publier Lever de rideau, son premier recueil de nouvelles. Douze nouvelles qui sont enracinées, pour la plupart, dans la réalité montréalaise. On y retrouve un sens de la beauté et un humour subtil, souvent pince-sans-rire, qui permettent à l’auteur de nous faire réfléchir en douceur sur les multiples obstacles au bonheur qui parsèment toute vie normale.
Notre collaborateur, Nicolas Bourdon, vient de publier Lever de rideau, son premier recueil de nouvelles. Douze nouvelles qui sont enracinées, pour la plupart, dans la réalité montréalaise. On y retrouve un sens de la beauté et un humour subtil, souvent pince-sans-rire, qui permettent à l’auteur de nous faire réfléchir en douceur sur les multiples obstacles au bonheur qui parsèment toute vie normale. -
La nouvelle Charte des valeurs de Monsieur Drainville
Marc Chevrier
Le gouvernement pourrait décider de ressusciter l'étude du projet de loi 94 déposé par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Le projet de loi 94 essaie d’endiguer, dans l’organisation scolaire publique québécoise, toute manifestation du religieux ou de tout comportement ou opinion qui semblerait mû par la conviction ou la croyance religieuse. -
J'ai peur – Jour de la Terre, le pape François, Pâques, les abeilles – «This is ours»: un Texan à propos de l'eau du Canada – Journée des femmes : Hypatie – Tarifs etc: économistes, éclairez-moi ! – Musk : danger d'être plus riche que le roi – Zelensky ou l'humiliation-spectacle – Le christianisme a-t-il un avenir?
-
Daniel Laguitton
2024 est une année record pour le nombre de personnes appelées à voter, mais c'est malheureusement aussi l’année où l'abstentionnisme aura mis la démocratie sur la liste des espèces menacées. -
De Pierre Teilhard de Chardin à Thomas Berry : un post-teilhardisme nécessaire
Daniel Laguitton
Un post-teilhardisme s'impose devant l'évidence des ravages physiques et spirituels de l'ère industrielle. L'écologie intégrale exposée dans les ouvrages de l'écothéologien Thomas Berry donne un cadre à ce post-teilhardisme. -
Réflexions critiques sur J.D. Vance du point de vue du néothomisme québécois
Georges-Rémy Fortin
Les propos de J.D. Vance sur l'ordo amoris chrétien ne sont somme toute qu'une trop brève référence à une théorie complexe. Ce mince verni intellectuel ne peut cacher un mépris égal pour l'humanité et pour la philosophie classique. -
François, pape de l’Occident lointain
Marc Chevrier
Selon plusieurs, François a été un pape non occidental parce qu'il venait d'Amérique latine. Ah bon ? Cette Amérique se tiendrait hors de l'Occident ? -
L'athéisme, religion des puissants
Yan Barcelo
L’athéisme peut-il être moral? Certainement. Peut-il fonder une morale? Moins certain, car l’athéisme porte en lui-même les semences de la négation de toute moralité. -
Nicolas Bourdon
Une journée d’octobre splendide, alors que je revenais de la pêche, Jermyn me fit signe d’arrêter. « Attends ! J& -
Marc Chevrier
À propos des ouvrages de Yannick Lacroix, Erreur de diagnostic et de François Charbonneau, L'affaire Cannon -
Le capitalisme de la finitude selon Arnaud Orain
Georges-Rémy Fortin
Nous sommes entrés dans l'ère du capitalisme de la finitude. C'est du moins la thèse que Arnaud Orain dans son récent ouvrage, Le monde confisqué