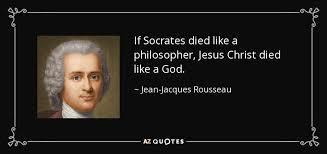Le Nouveau Testament: morale et politique des Évangiles
L'une des causes incontestables de l'originalité et de la force de la morale chrétienne, c'est le dogme sur lequel elle repose: dogme extraordinaire, qui embrasait l'âme en confondant la raison, et qui, plaçant en Dieu même le comble de l'amour et l'idéal du sacrifice, attirait l'homme à une vertu surhumaine par l'exemple du Sauveur, par la vertu d'un sang divin, par l'espérance d'une couronne sans prix.
Si quelque chose peut nous donner l'idée, ou plutôt le sentiment de la morale chrétienne et de sa singulière nouveauté, c'est la vie de son fondateur, vie si simple, si humble, si bienfaisante, si patiente, si éprouvée; mais surtout c'est sa mort, cette mort unique dont le témoignage est encore présent partout dans nos monuments, dans nos tableaux, dans nos maisons, et jusque dans nos ornements et dans nos parures. Je ne voudrais point renouveler le parallèle célèbre de Rousseau entre Jésus et Socrate, mais ce parallèle est si frappant et montre si bien le génie opposé de l'antiquité et du christianisme, qu'on ne peut y échapper. Des deux côtés, un procès inique et une mort injuste: mais ici, une apologie fière et doucement ironique, une captivité facile et presque volontaire, adoucie par la poésie, égayée par la conversation au dernier jour, un paisible débat sur les destinées de l'âme, et enfin, la mort accompagnée de sourire venant comme un sommeil, loin des pleurs de la famille et au milieu des consolations de l'amitié. En face de ce tableau, contemplez maintenant ce repas sévère et taciturne, où le maître se donne en sacrifice à ses disciples, cette nuit d'angoisses et de prière au jardin des Oliviers, ce baiser de la trahison, cet amas d'injures, cette croix sanglante et déshonorante, ce supplice entre deux voleurs, cette mère en pleurs, cette dernière plainte, ce dernier pardon, enfin ce soupir suprême, si lentement et si douloureusement exhalé; scène incomparable, la plus grande sans doute qu'ait vue le monde, et que Platon semble avoir entrevue comme dans un rêve.
La Passion, qui est le mystère suprême dans le christianisme, indique assez que la vie de l'homme n'est qu'une passion, c'est-à-dire une douleur. Tandis que toute l'antiquité faisait consister le bien à ne pas souffrir, et invitait l'homme soit par la vertu, soit par le plaisir, à fuir la douleur, l'Évangile présente à l'homme la douleur comme un bien. La douleur est en quelque sorte divinisée, puisque Dieu lui-même a voulu souffrir, gémir, mourir.
Dans toutes les religions, il y a des préceptes en faveur des faibles, des malheureux, des opprimés. Mais il semble que toute la morale du christianisme soit faite pour ceux-là. «Heureux ceux qui pleurent!» est-il dit: mais ce n'est pas tout: «Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice... vous serez heureux lorsque les hommes vous maudiront et vous persécuteront 1!» Ainsi la douleur et l'injustice ne sont plus des maux qu'il faut écarter ou supporter, ou des choses indifférentes qui ne méritent point qu'on y pense: ce sont des biens qu'il faut rechercher, aimer et savourer; car la même doctrine, qui est une doctrine de douleur, est une doctrine de consolation: «Venez à moi, vous tous qui ployez sous le joug, je vous ranimerai 2.»
L'Évangile a deux sortes de consolations: les unes pour les misérables, les autres pour les pécheurs: «Ce ne sont pas ceux qui sont en santés qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs à la pénitence 3». C'est pourquoi Jésus ne dédaignait pas la société de ceux que l'on méprisait: c'étaient ceux-là surtout qu'il voulait amener à lui; et c'étaient d'eux qu'il espérait le plus: «Je vous le dis, en vérité, les publicains et les courtisanes vous précéderont dans le royaume de Dieu 4»: Voilà ceux qu'il venait consoler et purifier; et l'humiliation du vice et du mépris lui paraissait plus près de la simplicité nécessaire au salut, que l'orgueil de la vertu.
Je répète que ce qu'il y a de nouveau dans la morale chrétienne, c'est l'accent: c'est par là que les paroles du Christ pénétraient jusqu'au plus profond de ces âmes grossières, et les renouvelaient; il savait parler aux misérables soit par le corps, soit par l'âme; il avait des paroles exquises, rafraîchissantes, consolatrices: «Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez du repos à vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger 5.» …»Quiconque donnera seulement à l'un de ces plus petits un verre d'eau froide à boire, il n'attendra pas sa récompense 6.» L'indulgence de coeur ne trouvera jamais de parole plus pure et plus haute que celle-ci: «Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre 7.» L'innocence, la candeur, la simplicité peuvent-elles être recommandées d'une manière plus touchante: «Je vous le dis, en vérité, si vous ne changez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux 8.» L'oubli de soi-même dans la charité, le secret dans la piété ont-ils pu inspirer des paroles plus heureuses et plus vives: «Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre droite 9. Lorsque vous jeûnez, ne soyez point tristes, comme les hypocrites. Parfumez votre tête et votre face 10.» Quelle sagesse dans ce mot admirable: «Demain aura soin de lui-même; à chaque jour suffit sa peine 11.» Ces paroles ne recommandent pas l'oisiveté, mais la quiétude dans le travail on peut en abuser pour recommander l'hypocrisie mendiante et paresseuse; mais bien comprises, elles expriment la confiance et la sécurité de l'âme qui se donne à Dieu. Oublierai-je ces mots où le pardon a trouvé son expression la plus pathétique et la plus déchirante: «Mon Dieu, pardonnez-leur; car ils ne savent ce qu'ils font.» Oublierai-je cette sublime prière, la plus pure qui soit dans aucune doctrine, et si haute qu'elle peut convenir à tous les hommes sans distinction de croyance? Que dire enfin de la parabole de l'Enfant prodigue, de celle du bon Samaritain, de celle du Publicain et du Pharisien, et de tant d'autres récits naïfs et grands qui, de siècle en siècle, ont servi à nourrir les âmes populaires, les coeurs simples, les petits et les innocents de la sainte manne de la parole, tandis que les beaux écrits des philosophes demeuraient le mets réservé des raffinés et des délicats?
L'esprit de la morale chrétienne est de demander à l'homme tout ce que l'on peut lui demander; c'est d'exiger de lui le plus grand effort de dévouement, de sacrifice et d'oubli de soi-même, que l'âme humaine puisse, je ne dis pas exécuter, mais concevoir. C'est pourquoi elle est la plus grande morale qui ait jamais paru. Essayez, en effet, de concevoir une obligation morale qui ne soit point prévue dans les principes de l'Évangile; une prescription à ajouter à toutes celles qu'il contient, un devoir nouveau enfin, vous n'y parviendrez pas. On peut bien dire que l'Évangile demande trop à l'homme, mais non qu'il ne lui demande pas assez. Il n'en est pas non plus de l'Évangile comme du stoïcisme, qui demande trop d'un côté et trop peu de l'autre. Mais l'Évangile nous impose tout l'amour de Dieu; tout l'amour des hommes, tout le courage, toute la patiences toute la chasteté, toute la modestie et l'humilité, en un mot, toute la perfection que l'on peut rêver pour l'homme, et non pour un homme qui n'a jamais existé et n'existera jamais, mais pour l'homme véritable, tel que l'a fait la nature. Cette doctrine me paraît contenir la plus parfaite idée de la vertu humaine, et je ne devine pas quel progrès on pourrait faire sur une telle morale, à la condition, bien entendu, qu'on n'y cherche pas autre chose qu'une morale, c'est-à-dire une doctrine de devoir, et non une doctrine du droit. Une objection s'élève en effet, contre cette admirable morale: c'est qu'en présentant l'idée du devoir dans sa perfection, elle semble sacrifier ou négliger le principe du droit; c'est qu'en exagérant l'obligation, elle ne fait pas la part suffisante de ce qui est permis; c'est qu'elle donne trop à la vertu et pas assez à la nature: disons quelques mots de cette objection.
Le principe suprême de la morale chrétienne et évangélique est l'amour ou la charité. Or, on ne peut douter que ce principe bien entendu et appliqué dans toute son extension ne suffise entièrement et même au delà, pour résoudre tous les problèmes de la vie morale et sociale. Si, par exemple, je fais du bien aux hommes par amour pour eux, il est tout à fait inutile de m'avertir que je ne dois pas leur faire du mal: car le premier contient le second, et si je fais le plus, il va sans dire que je ferai aussi le moins. De même, si c'est par amour des hommes que je ne leur fais pas de mal, il est inutile de m'avertir que je devrais encore ne pas leur faire de mal, lors même que je ne les aimerais pas. En d'autres termes, si je suis disposé à accomplir tout mon devoir et au delà de mon devoir, il m'est indifférent de savoir que les autres ont des droits, puisque je veux faire pour eux bien au delà de ce qu'ils ont droit d'exiger. Supposez maintenant que tous les hommes sans exception soient animés des mêmes sentiments, n'est-il pas évident que tous, faisant les uns pour les autres tout ce qu'ils peuvent faire, n'ont pas besoin de s'opposer les uns aux autres un droit jaloux, puisque le droit n'est qu'une défense, et qu'une défense est superflue entre personnes qui s'aiment? En un mot, la charité parfaite dévore le droit 12: ce n'est point qu'il cesse d'exister; mais il n'est plus qu'en puissance. Tel est l'idéal de la société chrétienne; idéal qui est sans aucun doute le plus pur et le plus élevé qu'ait jamais conçu aucune doctrine philosophique et religieuse. Le christianisme, supérieur en cela à toutes les doctrines modernes de réformation et d'émancipation, a pénétré jusqu'au plus profond principe d'action qui soit dans la nature humaine; il a réveillé ce principe, lui a donné conscience de lui-même, en a tiré les effets les plus admirables; et si prévenu qu'on soit, il faut fermer volontairement les yeux à l'évidence, pour nier qu'aujourd'hui encore, si loin qu'il soit de son origine et de sa première ferveur, le christianisme enfante encore des miracles de charité et de dévouement.
Mais voici maintenant les difficultés que rencontre un tel idéal dans l'application. Comme il est de bien loin au-dessus des forces de la nature humaine, il arrive qu'il n'est pratiqué à la rigueur que par quelques âmes d'exception, ou bien dans de certains moments de ferveur. La véritable piété étant très rare, la vraie charité l'est au moins autant. Mais, comme en demandant aux hommes de faire pour leurs frères tout ce qu'il est possible, on ne s'est pas appliqué à fixer tout ce qui est rigoureusement dû à chacun, cette incertitude sur les limites du droit est très favorable aux lâches interprétations du devoir. Ajoutez que le devoir de charité étant absolu, il est prescrit à ceux qui souffrent d'aimer ceux qui les persécutent: précepte admirable, et vraiment sublime, mais qui fournit malheureusement un aliment à la persécution. Car, remarquez qu'entre ces deux préceptes, faire le bien et supporter le mal, le second est beaucoup plus facile à appliquer que le premier; car la plupart du temps, il s'appuie sur la nécessité même, tandis qu'il faut toujours beaucoup d'efforts pour faire du bien. Supposez maintenant que, entre les forts et les faibles, la patience soit d'un côté, sans que la charité soit de l'autre, ne voyez-vous pas naître de cette inégalité une cruelle et irrémédiable oppression?
C'est ce qui arriva, par exemple, au moyen âge. Les principes chrétiens tombant au milieu d'une société barbare, où la force était tout, ne purent avoir que des effets partiels et très incomplets. Dans le chaos que produisirent la rencontre et le conflit des races vaincues et des races victorieuses, la violence individuelle dut avoir la plus grande part: une société se forma comme elle put; la force eut le dessus, comme il arrive toujours; la faiblesse fut heureuse de se cacher à l'ombre de la force: un ordre artificiel les enchaîna l'une à l'autre; et c'est ce qu'on appela la société féodale. Le christianisme s'accommoda tant bien que mal à cette fausse société: il en adoucit les maux, il en tira quelques grandes vertus, mais il n'en corrigea pas la radicale injustice.
De là vint que les temps modernes se réveillèrent en invoquant une idée toute différente de l'idée chrétienne: l'idée du droit. Ce n'est pas que ces deux idées soient contraires l'une à l'autre; mais elles sont très distinctes. Chrétiennement, je dois supporter l'injustice, et même m'en réjouir; en droit, je n'y suis point tenu. Chrétiennement et religieusement, je dois aimer mes persécuteurs; en droit, je puis m'en défendre, et opposer la force à la violence; ce qui se concilie difficilement avec le principe de l'amour. Sans nul doute, l'idée chrétienne est plus haute et plus divine que l'idée de droit. Mais celle-ci est indispensable pour maintenir l'ordre dans la société et empêcher que les uns n'abusent de la candeur et de la charité des autres.
C'est la confusion de ces deux idées, l'idée chrétienne de la charité, et l'idée philosophique du droit, qui a souvent donné le change de nos jours sur le véritable caractère du christianisme, et lui a fait attribuer un sens politique et social, qu'il n'a jamais eu à l'origine. Rien de plus contraire au bon sens que de transformer Jésus-Christ en une sorte de réformateur philanthrope et socialiste. Jésus n'a jamais voulu qu'une seule réforme: l'amélioration des âmes. La seule société qu'il eut devant les yeux, c'est la société céleste, qu'il considérait comme le renversement de la société terrestre. La richesse et la domination qui assurent la supériorité sur la terre sont, au contraire, pour le ciel une croix et un empêchement. C'est pourquoi il allait s'écriant: «Malheur à vous, riches, qui avez votre consolation!... Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim 13!» C'est pourquoi il dit encore que «les riches entreront difficilement dans le royaume des cieux 14», tandis que ce royaume appartient aux pauvres en esprit, c'est-à-dire à ceux qui supportent la pauvreté religieusement. Il en est de la domination comme de la richesse: «Les princes des nations les dominent; il n'en sera pas ainsi parmi vous.» Dans la cité promise, «les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers 15». Mais un tel renversement n'aura lieu que dans le royaume du ciel; ou s'il peut se réaliser ici-bas, c'est à la condition que les grands se fassent volontairement petits, et non que les petits aspirent à devenir grands: l'égalité chrétienne est une égalité morale, religieuse, volontaire, et non sociale et politique.
Un point qui n'est pas moins certain, c'est que Jésus, qui n'a aucun caractère de réformateur politique, n'a pas davantage de prétentions au rôle de dominateur et de roi. On sait que c'est en cela même qu'a consisté l'aveuglement des Juifs: leur erreur a été de ne pas reconnaître le Messie, dans celui que n'accompagnait aucun signe sensible de la royauté. Or, il est certain que Jésus-Christ n'a jamais réclamé la domination ni pour lui ni pour ses disciples. Comment l'aurait-il fait, lui qui disait: «Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir 16;» et encore: «Mon royaume n'est pas de ce monde 17.» Tous les textes qui, au moyen âge, ont été interprétés dans le sens de la domination ecclésiastique, n'ont qu'un sens religieux et spirituel. «Fais paître mes brebis», disait-il à saint Pierre. Il entendait par là: nourris-les de la parole. Lorsqu'il disait: «Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel; tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel 18», il ne voulait parler évidemment que de la rémission des péchés, et non de la dispense du serment de fidélité envers les puissances. Dans ces paroles: «Allez, enseignez les nations, et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit», il instituait le sacerdoce et la prédication, mais il ne donnait aucun pouvoir temporel à ses disciples. Quant à lui, il rejetait toute fonction qui avait rapport aux intérêts de la vie: «Maître, disait un de ses disciples, dites à mon frère de partager avec moi mon héritage.» Jésus lui dit: «Qui m'a établi juge sur vous ou pour faire vos partages 19?» Enfin, dans le passage le plus célèbre et le plus souvent cité, Jésus fait le partage entre les puissances en disant: «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu 20.» Il est vrai que dans ces termes généraux, la question reste entière, puisqu'il s'agit de savoir ce qui est à César et ce qui est à Dieu. Mais le principe se détermine par l'application particulière qui en est faite. Or, de quoi s'agit-il? de payer le tribut. Ainsi le tribut est à César. Or, le tribut est le signe de la soumission civile; il en résulte que César est le véritable chef de l'union civile, c'est-à-dire de l'État. Ainsi Jésus-Christ a séparé le royaume de Dieu et le royaume de l'État, et il n'a pas voulu que le premier dominât sur le second.
On peut donc rejeter comme fausses les deux thèses soutenues à diverses époques, et à différents points de vue: la première que le christianisme est une doctrine d'émancipation sociale et politique, qu'il est pour les peuples contre les rois, et qu'il met la force au service du droit; la seconde, que l'Église est supérieure à l'État, que l'État lui doit obéissance et hommage, que le chef de l'Église est le chef du monde. Ces deux doctrines sont contraires à la lettre et à l'esprit de l'Évangile. L'Évangile n'est ni démocratique ni théocratique, il ne prêche ni la révolte, ni la domination.
Il est vrai qu'en introduisant un royaume de Dieu dans le royaume de ce monde, le christianisme soulevait, par là même, la question de savoir comment ces deux royaumes pourraient s'unir, s'entendre, se limiter. Mais cette question est à peine indiquée dans l'Évangile; c'est le problème du moyen âge et des temps modernes.
Notes
1. Matth., V. 4, 11; Luc., VI, 21, 22.
2. Matth., XI, 28.
3. Luc, V, 31, 32.
4. Matth., XXI, 31.
5. Matth., XI, 29, 30.
6. Marc, IX, 40.
7. Jean, VIII, 7.
8. Matth., XVIII, 3.
9. Matth., VI, 3.
10. Matth., VI, 16, 17.
11. Matth., VI, 34.
12. Un critique des plus bienveillants et des plus éclairés, M. Adolphe Franck, a combattu cette pensée, en l'entendant comme si j'avais voulu dire que la charité supprime le droit, ce qui n'est, nullement ma pensée. Ce que j'ai voulu dire, et ce que je maintiens, c'est que la charité, si elle est parfaite et éclairée, rend le droit inutile. Par exemple, deux amis liés par la plus tendre amitié ont certainement l'un envers l'autre des droits, comme le droit de propriété; mais ni l'un ne songe à en faire usage pour le défendre contre l'autre, ni l'autre ne songe à respecter un tel droit. Le fait seul d'invoquer le droit entre personnes qui s'aiment est déjà presque une injure. Une femme, que son mari s'abstiendrait de battre, uniquement parce que c'est son droit de ne pas être battue, aurait déjà le droit de s'offenser. L'amour s'élève donc au-dessus du domaine du droit; il l'absorbe sans le détruire, bien entendu, à la condition de ne pas agir contre lui. Un autre critique, également bienveillant, M. D. Nisard, nous a fait une objection en sens inverse. Il s'est étonné de nous voir dire que le christianisme n'a pas fait une part suffisante à l'idée du droit. Mais il nous semble que cette vérité ressort très évidemment de tout ce que nous disons plus loin sur la propriété, sur l'esclavage, sur la liberté de conscience. Sans doute, l'idée de droit est implicitement dans le christianisme, comme l'idée de charité est implicitement dans la morale de Socrate ou de Platon; nil sub sole novum. Mais, dans l'histoire des idées, c'est le développement qui constitue l'invention. Or, à ce point de vue, il est difficile de nier que l'idée de droit ne soit la découverte des temps modernes, et en particulier du XVIIIe siècle
13. Luc, VI, 24, 25.
14. Marc, X, 23-25.
15. Matth., XX, 25-27; Luc, XXII, 25-27.
16. Matth., XX 28.
17. Jean, XVIII, 36.
18. Matth., XVIII, 18.
19. Luc, XII, 14
20. Matth., XXII, 17, 21; Luc, XX, 22, 25; Marc, XII, 14, 17.