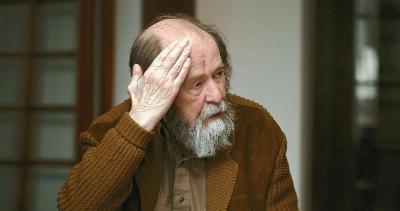L'université et le réel
Où il est question du mépris de l’élite pour le peuple, ce qui aide à comprendre le mépris actuel du peuple pour l’élite, mépris souvent caricaturé sous le nom de populisme. Article paru dans Au secours des évidences, Mame, 2022.
Tout a été dit sur l’abîme qui sépare l’enseignement universitaire de la vraie vie. Cet abîme, j’en ai mesuré toute la profondeur en lisant les admirables Souvenirs du temps des morts de M. Bridoux. L’auteur, un universitaire de grande classe, nous y apprend qu’il a attendu la guerre de 1914 et l’intimité forcée des tranchées pour savoir que des êtres aussi « incultes » que les paysans et les ouvriers possédaient souvent une compréhension des êtres et des choses, une finesse d’esprit et une ouverture de cœur, pour tout dire une sagesse qui dépassait de beaucoup, en délicatesse et en profondeur, celle de l’intellectuel moyen. Ainsi donc, en ces temps de démocratie et d’égalité, il n’a fallu rien de moins qu’une catastrophe universelle pour que fussent révélées à un représentant de l’élite les grandes vertus populaires : personne ne lui avait parlé de cela ! Rien n’illustre mieux que cet humble fait le divorce entre l’Université et le monde réel.

Je vois autour de moi quelques vieux paysans qui n’ont jamais reçu d’autres leçons que celles de la vie et de la nécessité. Leurs fils ont fait des études ; ils sont fonctionnaires ou ils occupent une profession libérale. Il suffit de causer un moment avec ces derniers, quand ils reviennent aux vacances prendre l’air du pays, pour avoir l’impression, en dépit de toute leur science, d’un aplatissement de l’esprit, d’une perte irréparable de substance humaine.
Ils savent certes beaucoup de choses, ces jeunes gens que l’Université lance chaque année à travers le monde. Mais ils en ignorent d’autres, plus élémentaires peut-être, mais plus essentielles aussi : ces vérités qui sont comme le prolongement intellectuel des échanges vitaux, comme la concrétion de l’observation et de l’expérience directes. Les uns connaissent les moindres faits de l’histoire, mais que savent-ils de l’âme des temps passés et des fils ténus et infrangibles qui relient les jours d’hier à ceux d’aujourd’hui ? D’autres connaissent la philosophie, mais ils ignorent la sagesse; ou tous les secrets de la médecine, mais les lois les plus simples de la vie leur échappent.
Et même ce qu’ils savent, comment le savent-ils ? Comme ces choses apprises restent, pour la plupart, loin de la vie du corps et de l’âme ! Voici de jeunes têtes qu’on a farcies durant de longues années de philosophie et de morale : pour combien d’entre elles cette philosophie est-elle autre chose qu’un pâle jeu de l’esprit : une raison intime de vivre et d’agir, un ensemble de vérités confirmées par l’expérience intérieure et le spectacle du monde ? Ils ont lu, commenté, trituré l’œuvre de Virgile ou de Racine. Mais les vers des Géorgiques les ont-ils emportés jusqu’à la source de la communion avec la nature ou ceux de Phèdre jusqu’au centre des passions ? Que vaut donc ce savoir qui ne les pénètre pas, qui ne se mêle pas à leur vie ? La vraie culture ne ressemble pas à un harnais posé sur nous, elle accroît et dilate l’homme intérieur, elle intéresse l’être plus que l’avoir. Or le phénomène par lequel l’avoir se transforme en être, le phénomène qui assure la croissance, s’appelle assimilation. Dans ce domaine, il ne suffit pas d’acquérir, il faut encore digérer. Si l’Université n’a rien négligé pour favoriser la culture en tant qu’avoir, qu’a-t-elle fait pour la culture en tant qu’être ?
Ces vues peuvent paraître sévères et même injustes. Nous n’ignorons pas qu’il existe dans l’Université des maîtres et des étudiants pour qui la culture est un principe de vie et de liberté. Mais nous savons aussi qu’ils doivent sans cesse réagir contre la pesanteur d’une tradition sclérosée et étrangère à la réalité. C’est contre cette culture de vitrine et d’isoloir que nous nous insurgeons.
Le mot culture a un sens très net. Une terre cultivée produit de plus belles fleurs et de meilleurs fruits, mais ces fleurs et ces fruits font corps avec la terre : ils sont tirés d’elle et nourris par elle. De même pour la culture de l’esprit. Il n’est pas vraies floraisons intellectuelles sans un engagement et une participation de l’homme tout entier : la science, hors de cette fécondation de l’abstrait par le concret, du cerveau par les entrailles, n’est qu’un assemblage d’éléments inanimés : seules les fleurs artificielles se passent de racines. Certains cerveaux encombrés de connaissances font songer à un entrepôt encombré de marchandises plutôt qu’à un beau jardin fertile.
Cette absence de liens vitaux nécessaires entre l’Université et les diverses formes du réel explique le règne de « l’idée pure » et le culte des nuées qui ont sévi si longtemps dans l’enseignement. Là où il y a vraiment culture, participation du terrain à la vie des plantes, on sait distinguer la bonne semence de la mauvaise, l’idée vraie de l’idée fausse : l’inflexible critère de l’incarnation départage l’étroite zone du possible et le royaume illimité de l’utopie. Mais là où le terrain humain ne collabore pas tout entier à la genèse des œuvres de l’intelligence, toutes les illusions, toutes les folies deviennent possibles : il n’est pas d’idée qui ne puisse être admise dans cet univers désincarné. A des fleurs en papier, on peut donner toutes les formes, toutes les couleurs concevables. Croit-on, par exemple, que si l’Université du XIXème siècle avait gardé le moindre sens de l’âme humaine, une doctrine aussi stérile, aussi étrangère à la vie que la morale de Kant aurait pu y être enseignée si longtemps ?
Le problème qui se pose aujourd’hui à l’Université est celui de toutes les valeurs spirituelles : c’est un problème d’incarnation. Il s’agit de briser le vase clos où l’intelligence s’étiole en se nourrissant exclusivement d’elle-même : il faut que la culture jaillisse du réel et débouche sur le réel.
Aucune culture ne saurait être authentique si elle n’est pas en grande partie la décantation de l’âme, de la sagesse, des réflexes vitaux d’un peuple. Nous avons failli mourir de trépidation et d’anémie cérébrale. Il est temps que notre tête se ressoude au corps qui la nourrit et qu’un sang riche et jeune irrigue notre cerveau. Nous avons souligné ailleurs que beaucoup de « progrès » de l’humanité ressemblent à une construction dont les étages supérieurs seraient construits avec des pierres arrachées aux fondements. Nous n’avons que faire d’une culture dont la chair, le sang et l’âme seraient la rançon ; nous avons soif pour nos enfants d’autre chose que de cette science tatillonne, orgueilleuse et sclérosée pour qui l’éloignement de la vie et l’inefficacité dans l’action sont des gages de supériorité. Comme tous les fruits de la civilisation, le savoir ne doit pas s’acheter trop cher ! Nous préférons une terre inculte où poussent des herbes sauvages mais vivantes à l’herbier le mieux ordonné où gisent des fleurs desséchées. Et nous avons besoin de savants qui restent des hommes.