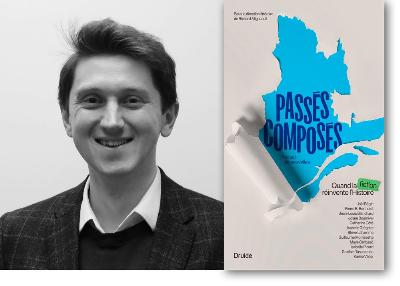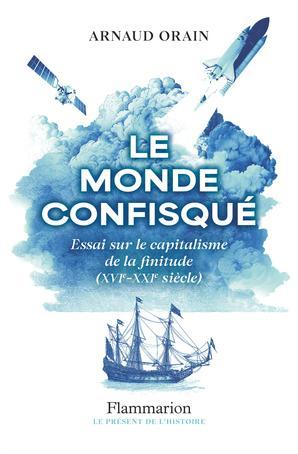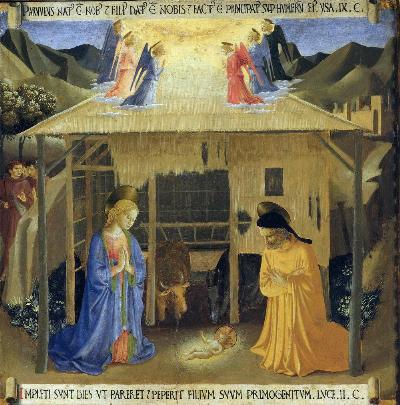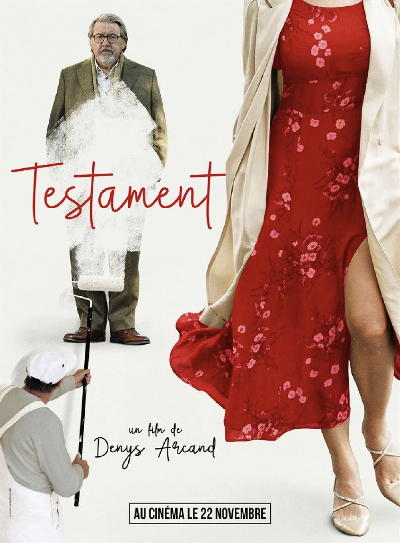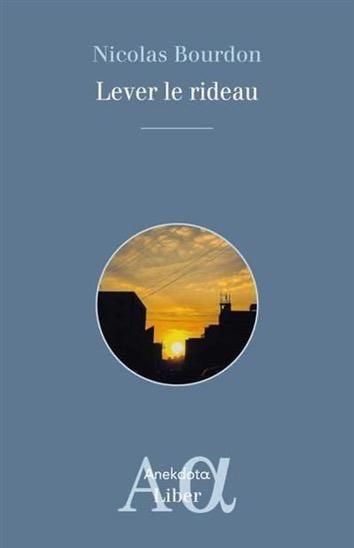Charles De Koninck, penseur du Québec moderne
La pensée de Charles De Koninck est bien vivante. Du 1er au 3 octobre 2025 a eu lieu à Québec un colloque intitulé Bien commun et fédéralisme chez Charles De Koninck. Le constitutionnalisme entre philosophie et politique. Le colloque a été entièrement consacré à la philosophie pratique de Charles De Koninck. Il a été organisé par Maxime St-Hilaire, professeur à l’Université Sherbrooke, Kevin Bouchard, professeur à l’Université Laval, avec l’aide de Jérémy Elmerich, chargé de cours à l’Uqam et chercheur postdoctoral à l’Université de Sherbrooke.

Une allocution du ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barette, a précédé le colloque. Le ministre a notamment parlé de son projet de constitution québécoise. L’inauguration a ensuite eu lieu avec une conférence du constitutionnaliste américain Adrian Vermeule de Harvard, auteur notamment de l’ouvrage Common Good Constitutionalism. Vermeule nous a entretenus d’une comparaison entre la conception de la tyrannie de De Koninck et celle de Montesquieu. Un point de recoupement entre les deux est notamment l’idée que la soumission d’une nation à un tyran peut rendre les citoyens eux-mêmes tyranniques.
La philosophie québécoise : un dialogue entre philosophie, droit et science politique
Ce colloque montre que la philosophie québécoise existe bel et bien et qu’elle est de plus en plus reconnue. Des experts du Québec, du Canada anglais, des États-Unis, du Royaume-Uni, de France et d’Italie ont pris la peine de réfléchir sur l’œuvre de Charles De Koninck. Les discussions ont pu porter sur Aristote et Thomas d’Aquin, mais aussi sur la façon dont De Koninck s’est approprié leur pensée. En effet, De Koninck n’a pas été seulement un interprète de ces grands auteurs, mais également un penseur au sens fort du terme. En outre, sa pensée est véritablement pratique, et non « théorique », dans la mesure où il a pris en compte la réalité politique de son époque, dans ses dimensions aussi bien nationale qu’internationale.
Ce caractère pratique se manifeste notamment dans sa fameuse participation à la Commission Tremblay sur l’avenir constitutionnel du Québec, instituée en 1953. Ce texte a été l’un de ceux qui ont été le plus commentés lors du colloque, afin d’en dégager une pensée constitutionnelle. On a pu ainsi de demander qui est le véritable sujet politique pour De Koninck : plutôt l’État central d’une fédération, ou plutôt les États fédérés ? On sait que De Koninck considère que selon le pacte fondateur canadien de 1867, les états provinciaux sont des sociétés politiques à part entière, qualité que nie cependant ce qu’il appelle le Grand État, auquel tend à se confondre l’État fédéral canadien de plus en plus centralisateur, dès avant les années 1960. De toute évidence, de Koninck préfère un pouvoir politique près des citoyens.
Selon Marie-France Fortin (Ottawa), le principe de subsidiarité de De Koninck s’inscrit davantage dans la lignée du fédéralisme américain, qui considère comme meilleur le palier de gouvernement le plus près des gens, que dans celle de la pensée sociale de l’Église. Elle a aussi souligné que, pour De Koninck comme pour Montesquieu, le droit doit être adapté à la réalité concrète des sociétés. Elle a conclu en soulignant l’évolution de la pensée de De Koninck à propos de la laïcité, à mesure que le Québec a évolué vers celle-ci. Elle a aussi suggéré que le grand intérêt théologique de De Koninck pour Marie Mère de Dieu pourrait nous inciter à repenser l’antique piété filiale des Romains dans le sens d’une déférence envers les générations de femmes canadiennes-françaises grâce auxquelles notre société actuelle existe.
Une contribution philosophique remarquable fut celle de François Daguet (Toulouse), éminent spécialiste de la pensée politique de saint Thomas d’Aquin et auteur de l’ouvrage Du politique chez Thomas d’Aquin. Il a présenté le grand débat entre De Koninck et Maritain sur ce qui doit avoir la priorité, entre le bien commun et la dignité de la personne. Daguet reconnaît qu’il est difficile trancher, le bien commun ayant pour Thomas d’Aquin une claire priorité dans l’ordre naturel, tandis que le bien de la personne a priorité dans l’ordre surnaturel, puisque la personne est directement en relation avec Dieu. Il a ensuite exposé les positions de Charles De Koninck et celle Maritain, pour montrer que le premier a pu montrer comment les arguments personnalistes de Maritain négligent des passages essentiels de Thomas d’Aquin et aboutissaient à subordonner le bien de la cité à la transcendance de personnes qui existent en dehors du tout de la cité.
Il est intéressant de constater que l’importance de la philosophie est pleinement reconnue par les juristes et les politicologues. Eux-mêmes contribuent fortement à la réflexion philosophique par le caractère concret de leur expertise. Certains juristes ont critiqué la suprématie contemporaine des droits individuels, souvent conçus en dehors de toute prise en compte du bien commun, en montrant certaines incohérences ou absurdités qui en découlent dans les cours de justice d’Amérique du Nord et d’Europe. Si le bien commun se présente pour plusieurs comme un principe qui n’élimine pas les droits individuels, il en éclaire également la signification et les enracine dans un cadre plus large.
Collaborateurs de L’Agora présents au colloque

Deux collaborateurs de L’Agora ont présenté une conférence au colloque, soit Marc Chevrier et moi-même. La conférence de Marc Chevrier avait pour titre « Charles de Koninck dans l’univers du néo-thomisme politique nord-américain ». Pour Marc Chevrier, Charles De Koninck est un penseur qui a exercé une certaine liberté. La philosophie politique n’était d’ailleurs pas son principal champ de réflexion, ce qui a pu laisser penser que ses écrits en la matière, qui remplissent pourtant plus de trois volumes, ne formulent pas de pensée achevée. Bien au contraire, soutient Chevrier, ces écrits, dispersés en articles et conférences, élaborent une pensée politique originale, dont les axes principaux sont une défense de l’idée du bien commun en tant que notion anti-totalitaire et opérable par des agents libres, une défense de la loi naturelle, comme vérité pratique susceptible d’évolution et d’enrichissement par l’expérience, une critique des pensées de l’histoire totalisantes et substituant l’art — la science et la technique — à l’activité pratique, une critique des dérives impériales du fédéralisme sous la forme du Grand État et une conception originale de la laïcité axée sur la primauté de la liberté de conscience. Ma propre conférence s’est intitulée « Quel rôle une constitution peut-elle jouer pour prévenir la violence politique du point de vue du néo-thomisme québécois ? Les réponses de Charles De Koninck et de Louis Lachance. » J’y ai aussi abordé les points de vue de Martin Blais et Félicien Rousseau. J’ai discuté du rôle de la prudence politique, selon ces penseurs, et de l’importance de réaffirmer sa primauté sur la technique, de même que son usage général par l’ensemble des citoyens.
Mentionnons que quatre enfants de Charles De Koninck ont assisté au colloque. L’un deux, Rodolphe, géographe, a dialogué avec Marc Chevrier lors de la période de questions. Il est ressorti de leur échange que De Koninck, père, est un penseur que l’on ne peut réduire à une étiquette, comme celle de « néo-thomiste », étiquette que de Koninck refusait d’endosser pour lui-même. J’ai eu moi-même le plaisir de discuter avec Maria De Koninck qui m’a expliqué en quoi son père a contribué à sa propre évolution intellectuelle, professionnelle et même existentielle. Il en ressort le portait d’un penseur profondément humain, qui était à la fois un catholique non dogmatique et un philosophe capable de donner un sens moderne à la pensée classique.
Conclusion
En guise de conclusion, je résumerai quelques éléments qui sont ressortis de la table ronde finale du colloque. Pour Maxime St-Hilaire, la pensée du bien commun permet de dépasser l’alternative entre le positivisme juridique, qui ne fait que confirmer l’ordre établi, et le cynisme des Critical Legal Studies. Le bien commun permet de soumettre le droit à l’éthique, sans rejeter la rigueur méthodologique du positivisme. Jean-Christophe Bédard-Rubin (Toronto) a soulevé une question à propos de la relation entre le bien commun et le les droits individuels : dans le souci d’éviter le contrôle bureaucratique excessif par le Grand État, comment peut-on poser une limite à ce contrôle qui ne consiste pas en droits individuels, mais sur laquelle les droits individuels peuvent se fonder ? François Daguet a rappelé que le bien commun est la recherche d’une vie collective heureuse. Comment pouvons-nous vivre sans une telle finalité ? Dwight Newman (Saskatchewan) s’est demandé comment il était possible de mieux faire connaître la pensée de De Koninck. Il a notamment suggéré de traduire en anglais certaines œuvres de De Koninck qui sont peu connues dans la sphère anglophone.
Je termine sur une belle réflexion de Marc Chevrier, qui a posé cette question toute simple : « qui était Charles De Koninck ? » Il s’agit en effet de ne pas s’arrêter aux idées préconçues et à l’image qui est restée d’un personnage historique. Pour Marc Chevrier, De Koninck est entre autres choses quelqu’un qui a vu des choses commencer, mais pas se poursuivre. La Commission Tremblay est souvent présentée comme ayant contribué à préparer la Révolution tranquille. On sait aussi que De Koninck est décédé prématurément en 1965 tandis qu’il participait comme consultant au Concile Vatican II. Puisque De Koninck s’est penché sur Aristote, le premier penseur de l’histoire occidentale à avoir pensé la notion de constitution, retourner à De Koninck est aujourd’hui une façon d’envisager la suite des choses à partir de leur origine.