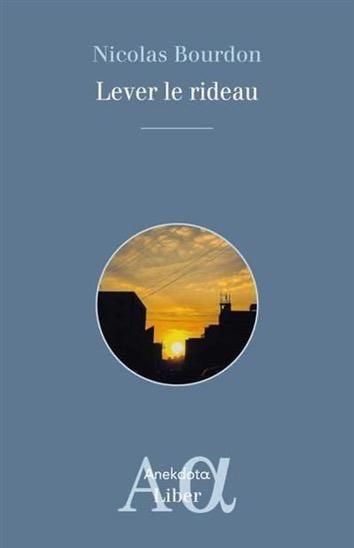Essentiel
Les personnes les plus gravement handicapées, souvent r/duites à l'immobilité et au silence peuvent-elles accéder a la philia, sont-elles des citoyens?
Extrait d'une conf/rence de Jacques Dufresne dans le cadre du XIIe colloque thématique annuel de l’Institut québécois de la déficience intellectuelle.
«Je m’adresse à ceux et celles, parents ou professionnels, qui consacrent une partie de leur vie à des personnes gravement
handicapées. Que sont-elles donc ces personnes pour que vous leur accordiez une telle importance? Ne les aurait-on pas exclues jadis parce qu'elles ne correspondaient pas à la définition de l'homme: animal raisonnable?
Ne me répondez pas: vos actes sont la plus belle et la plus vraie de toutes les réponses possibles. Vos actes ont devancé les théories des savants et des philosophes.
Je connais au moins une conception de l’être humain qui est à la hauteur de vos actes et qui mériterait d’être à la source de nos lois et des décisions de nos juges. Elle est de
Simone Weil. Je dois d’abord la situer dans son contexte, par-delà l’intelligence.
Quand Simone Weil annonça son intention de travailler comme ouvrière agricole, certains de ses amis la mirent en garde contre le risque qu’elle courait d’hypothéquer à jamais son génie en se livrant à des activités physiques qui dépassaient ses forces. Il faut ici préciser que Simone Weil était de santé fragile, qu’elle était depuis longtemps victime de migraines qui paraissaient incurables. Sa réponse à ceux qui se faisaient du souci pour l’avenir de son génie est l’un des passages les plus révélateurs de son œuvre: «Je m’attends aussi à assister à l’extinction de ma propre intelligence par l’effet de la fatigue. Néanmoins je regarde le travail physique comme une purification – mais une purification de l’ordre de la souffrance et de l’humiliation. On trouve aussi, tout au fond, des instants de joie profonde, nourricière, sans équivalent ailleurs. Pourquoi attacherai-je beaucoup de prix à cette partie de mon intelligence dont n’importe qui, absolument n’importe qui, au moyen de fouets et de chaînes, ou de murs et de verrous, ou d’un morceau de papier couvert de certains signes, peut me priver? Si cette partie est le tout, alors je suis tout entière chose de valeur presque nulle, et pourquoi me ménager? S’il y a autre chose d’irréductible, c’est cela qui a un prix infini. Je vais voir s’il en est ainsi.» 1
Simone Weil aura par diverses expériences la preuve qu’il en est ainsi. Elle pourra donc écrire ces lignes où je vois l’ébauche de la vision de l’homme et du monde dont nous aurions besoin pour respirer à l’aise sur les sommets où les idéaux modernes nous ont conduits. Je cite : «Il y a depuis la petite enfance jusqu’à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l’expérience des crimes commis, soufferts et observés, s’attend invinciblement à ce qu’on lui fasse du bien et non du mal. C’est cela avant toute chose qui est sacré en tout être humain. »
S’il n’a pas l’intelligence du bien et du mal, il a la sensibilité à ce qui lui fait du bien ou du mal. Par delà la raison des modernes, nous retrouvons l’âme qui fonde la compassion au cœur des plus grandes religions.
Texte complet de la conférence.
Enjeux
Extraits d'un
article publié dans cette Encyclopédie.
Les milliers de personnes âgées, mortes en cet été 2003 en France, de silence, de solitude et de chaleur auront été l’une des manifestations d’un désordre dont il existe plusieurs autres symptômes dans nos sociétés riches. Il y a désordre, nous rappelle Simone Weil, lorsque se multiplient les situations où il faut choisir entre deux obligations également fondamentales : par exemple, dans le cas d’un couple d’âge moyen, veiller sur ses vieux parents ou offrir à ses enfants des vacances qui leur permettront de relever le défi des études sans mettre leur santé en péril. En France, cet été, trop de couples ont négligé leurs vieux parents.
Au moment où ces mauvaises nouvelles venant d’Europe se multipliaient, on apprenait qu’au Canada 46% des médecins sont dans un état de
burnout avancé et que parmi ces gardiens de la santé personnelle et publique, le taux de suicide était deux fois plus élevé que dans la moyenne de la population. La même étude nous rappelait que 40% de la population active souffre du même mal, associé au travail et plus précisément à la difficile conciliation des exigences du travail et de celles de la vie de famille. Pendant la même canicule, les corps rassemblés sur les plages du Pacifique et de l’Atlantique rendaient manifeste le fait que l’obésité est une catastrophe nationale aux États-Unis. Derrière ces maux visibles, la souffrance des personnes handicapées, des malades mentaux et de leur famille, qui trouvent rarement autour d’eux le soutien dont ils auraient besoin. Les itinérants sont l’aspect visible de ce problème.
Chacun de ces symptômes a ses causes particulières, mais il en est une générale qui est commune à tous :
le système technicien. On peut diviser la société en trois sphères : le marché, l’État et la sphère du don, que nous appellerons la philia, à l’instar de Philippe Chanial 2. Bien que l’on n’en tienne pas compte dans la plupart des analyses, cette dernière a conservé une grande importance même dans les sociétés où l’État et le marché semblent se partager tout l’espace.
L’État, le marché, et dans une moindre mesure la philia sont sous l’empire du système technicien, qui fut si bien analysé par Jacques Ellul. [...]
Nous nous épuisons nous-mêmes à épuiser notre habitat, compromettant ainsi l’avenir de nos enfants. Nous nous rendons malades, nous nous brûlons, littéralement, nous et nos communautés, pour soutenir la croissance d’une efficacité, dont les effets pervers, la dilapidation du capital naturel, sont devenus plus importants que les bienfaits. C’est là une situation idéale en un sens : les remèdes a nos maux sont aussi les remèdes aux maux de la nature
Une croissance qui conviendrait à la fois aux hommes et à la nature serait caractérisée par un renversement de la tendance actuelle : au lieu d’être envahie par les sphères du marché et de l’État, et d’être considérée comme négligeable, la philia serait considérée comme la plus importante des trois et servirait de modèle aux deux autres. À noter que je parle de croissance. Dans l’état actuel des choses, un idéal de croissance zéro serait désespérant. Et de même qu’il faut éviter le rejet simpliste de l’efficacité, il faut pour les mêmes raisons continuer de miser sur l’État et le marché. [...]
Choisir la philia
Choisir la philia comme fondement d’une politique, c’est donner raison à Aristote pour qui l’homme est un
zoon politikon, un animal naturellement sociable, contre Hobbes pour qui l’homme est un loup pour l’homme. Cette sombre idée sert de fondement à notre marché, centré sur le calcul et les intérêts de chacun. C’est le règne de la méfiance, par opposition à celui de l’amitié.
Choisir la philia c’est s’engager à faire le nécessaire pour que les personnes handicapées, les malades mentaux et leur famille reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Notre honneur en tant que membres d’une société moderne est en cause. Jadis la vie des personnes handicapées était généralement brève et leur exclusion de la société était admise, les Églises leur offrant des refuges. Au moment précis où la science rendait possible pour les personnes handicapées une vie plus longue et meilleure, on jugea les refuges qui leur étaient offerts indignes d’elles. Ce fut le début de la désinstitutionnalisation. Les familles naturelles ou les familles d’accueil allaient devoir prendre le relais des refuges. Si ces personnes ne reçoivent pas de leur communauté et indirectement de l’État le soutien dont elles ont besoin, il faudra bientôt ouvrir de nouvelles institutions. Pour assurer ce soutien, il conviendrait si nécessaire de renoncer à la gratuité de certains services médicaux dont l’efficacité est douteuse.
Choisir la philia c’est aussi choisir d’accorder la primauté dans l’État et dans le marché à l’accomplissement des personnes. Il ne s’agit pas là d’une résignation suicidaire à l’inefficacité mais d’un pari sur cette efficacité d’un autre ordre qui est souvent donnée par surcroît dans les situations où existent les conditions de la créativité et de la responsabilité. Bien qu’elle n’échappe pas toujours à une naïveté frôlant le ridicule, la littérature actuelle sur les organisations apprenantes mérite toute notre attention. Qui donc n’a pas eu l’occasion de s’émerveiller des résultats obtenus par une équipe d’êtres libres et amis les uns des autres travaillant à leur rythme et en réseau à une oeuvre qui a un sens?
Choisir la philia c’est inviter les États et les entreprises à accorder plus d’importance à la confiance. Un responsable du service des achats surveillé par une personne plutôt que par cinq comme c’est le cas dans les hôpitaux du Québec, sera plus tenté de tirer des avantages personnels de son poste, mais pour un qui succombera à cette tentation, et qu’il sera facile de congédier, neuf seront plus heureux et plus productifs.
Choisir la philia c’est s’engager à substituer l’humanité des choix amicaux à la rectitude des choix bureaucratiques. Quel directeur d’école, quelle directrice d’hôpital, quel chef de département dans un Ministère n’ont pas rêvé de former de bonnes équipes en retenant comme critère d’embauche principal les affinités avec le groupe déjà formé plutôt que l’ordre déterminé par l’ancienneté.
Choisir la philia c’est inviter les syndicats et les associations patronales à subordonner la communauté de ressemblance à la communauté de solidarité. La communauté de ressemblance est celle qui réunit soit des personnes ayant une activité semblable, soit des personnes du même âge, quel que soit le lieu où elles habitent. La communauté de solidarité est celle qui réunit toutes les personnes, si différentes soient-elles, vivant dans un même lieu. Plutôt que de s’enraciner dans le milieu où vivent leurs employés, les patrons préfèrent souvent se réfugier dans les beaux quartiers et cherchent la compagnie de leurs homologues plutôt que celle de leurs voisins. La mondialisation aura aggravé ce problème. Les employés à leur tour se rapprochent de leurs semblables, ce qui contribue à dissoudre les communautés de solidarité. C’est l’une des causes de la solitude de bien des gens. Dans le même esprit, les autorités politiques devraient favoriser un développement qui favorise les communautés de solidarité.
Choisir la philia c’est miser d’abord sur les réseaux naturels plutôt que sur les services rendus par des professionnels, sans toutefois renoncer à la compétence de ces derniers, ce qui suppose qu’on ait d’abord recours à eux pour soutenir la résilience des réseaux naturels, là elle est encore possible, ou pour susciter l’apparition de réseaux artificiels légers, là où il n’y a pas d’autres solutions possibles.
Choisir la philia c’est inviter les gens à organiser leur temps privé de façon à ce qu’il y ait place pour le dialogue et la réflexion sur le sens de la vie. C’est inciter l’État à organiser le temps public selon les mêmes principes. L’ouverture des commerces jour et nuit toute la semaine n’est pas une décision heureuse de ce point de vue. La semaine sans télévision, organisée chaque année par des groupes de parents et d’élèves dans de nombreux pays, est un bel exemple des efforts qui peuvent être faits pour organiser le temps privé de façon à ce que l’âme puisse y respirer.
Choisir la philia c’est inviter les fondations et les autres groupes privés de bienfaisance à jouer un rôle accru dans les communautés en évitant toutefois d’imiter l’État ou le marché, en favorisant au contraire les initiatives qui auront pour effet de faire pénétrer l’esprit du don et les règles de l’amitié dans le marché et dans l’État.
Choisir la philia c’est veiller à ce que la règle de droit ne nuise pas à la vie sociale, c’est faire en sorte, par exemple, que la crainte d’une poursuite en responsabilité n’incite les gens à refuser de pratiquer l’hospitalité. Combien de gens s’abstiennent d’offrir leur aide à des familles hébergeant une personne handicapée parce qu’ils s’estiment incompétents et que pour cette raison ils craignent d’être tenus responsables d’un accident. (J.D)