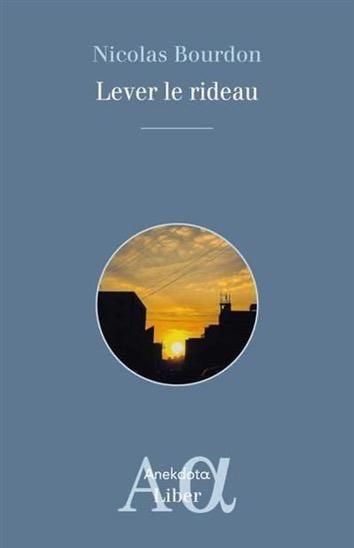La bourse ou la vie
Deux visions du monde s’affrontent à l’heure actuelle sur la planète, d’où une polarisation de plus en plus manifeste. La première tend à nous rapprocher du vivant, alors que l’autre nous en éloigne au profit de la technologie.
 Je venais de participer à un sommet organisé par madame Lucie Sauvé et le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ÉRE), lorsque j’ai pris connaissance du nouveau budget du Québec. Le contraste entre les deux visions du monde ne m’a semblé que plus marqué. Or, si nos jugements et nos actions reflètent notre façon de comprendre le monde dans lequel nous vivons, il en est de même pour les politiques adoptées par nos élus, y compris dans le domaine économique.
Je venais de participer à un sommet organisé par madame Lucie Sauvé et le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ÉRE), lorsque j’ai pris connaissance du nouveau budget du Québec. Le contraste entre les deux visions du monde ne m’a semblé que plus marqué. Or, si nos jugements et nos actions reflètent notre façon de comprendre le monde dans lequel nous vivons, il en est de même pour les politiques adoptées par nos élus, y compris dans le domaine économique.
Le site du sommet nous accueillait avec la question suivante : « Saviez-vous que 25 ans après les premiers États généraux de l’éducation relative à l’environnement, le Québec ne possède actuellement aucune politique ou stratégie formelle pour favoriser l’intégration de cette dimension fondamentale de l’éducation ? Certes, poursuivait-on plus loin, il y a eu des avancées en ce domaine, dues en grande partie au travail des organisations de la « société éducative » qui œuvrent dans différents secteurs et qui accompagnent l’école dans cette mission. Malheureusement, le soutien politique et les possibilités de financement de ces initiatives ne cessent de diminuer au fil des années. Plusieurs organisations non gouvernementales et diverses structures de soutien mises en place depuis les États généraux de 1991 (comme l’AQPERE, les Amis de la Montagne, GUEPE, la Fondation Monique-Fitz-Back et bien d’autres) ont vu leurs moyens d’action diminuer ou ont progressivement disparu ». Toutes ces initiatives ont (ou avaient) pour objectif de mettre les jeunes en contact avec le vivant.
Le récent budget du Québec indique que le gouvernement libéral a pris la direction opposée. La vision du monde des élus se révèle dans leurs choix d’investissement des deniers publics. Or, l’écrasante majorité des mesures budgétaires sont consacrées à la technologie. Ainsi, 830 millions de dollars seront investis sur six ans en recherche et innovation, dont 100 millions « pour l’établissement de Montréal comme « supergrappe » dans le monde de l’intelligence artificielle, ce qui fait écho aux intentions du gouvernement fédéral de miser sur ce modèle de regroupement géographique de compétences afin de donner l’élan à l’économie canadienne » (Le Devoir, 29 mars 2017), et 118 millions de dollars sont accordés aux sciences dites « de la vie », qui concernent principalement les biotechnologies placées sous la responsabilité de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique… Rien de spécifique sur l’éducation à l’environnement.
« Pourtant, la recherche et l’expérience montrent que l’ancrage et les diverses formes d’engagement des jeunes dans leur environnement, leur milieu de vie, sont une très grande source de motivation qui favorise leur réussite au sein d’une école où se forge une société qui apprend à mieux relever les défis de notre monde contemporain » (site du sommet). Alors, permettez-moi de faire appel aux parents qui n’hésiteraient pas à acheter une assurance pour garantir l’avenir de leurs enfants. En cette époque où les conditions essentielles à la vie sont constamment fragilisées, apprendre à se familiariser avec les milieux naturels et à interagir avec eux de manière à les préserver devient une stratégie de survie. C’est cette « assurance sur la vie » qu’offrent les différents intervenants en éducation relative à l’environnement. Ne devrait-on pas exiger de notre gouvernement qu’il accorde autant d’importance à la promotion de la vie qu’à celle des hautes technologies ?
Andrée Mathieu